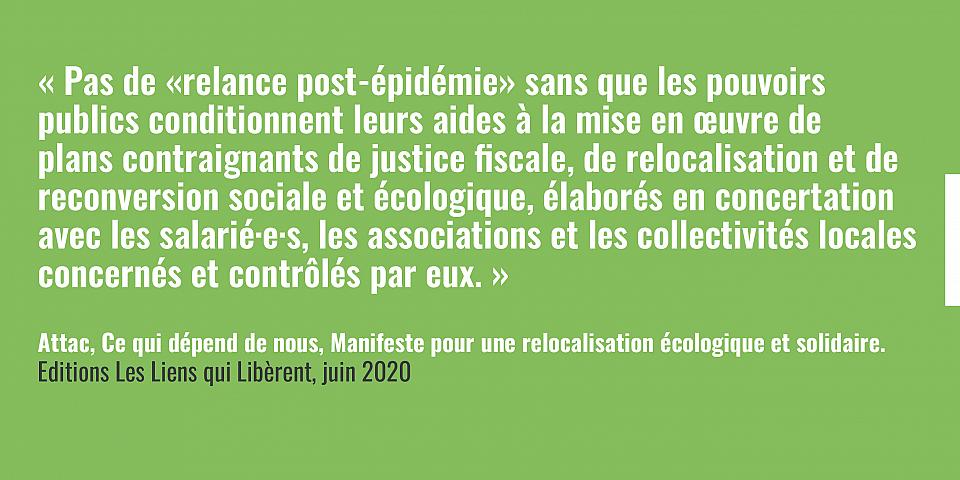« La vraie "folie" dont il nous faut guérir, c’est celle du tout-marché, qui détruit le travail, la Terre et la vie. » C’est ainsi que débute Ce qui dépend de nous. Manifeste pour une relocalisation écologique et solidaire qui parait ce 5 juin aux éditions Les Liens qui Libèrent. Rédigé à partir de multiples contributions de chercheur.ses et de militant.e.s, ce manifeste traduit la force de proposition des mouvements sociaux et altermondialistes, mettant en débat des solutions appuyées sur la recherche scientifique et les expérimentations sociales [1]. « Les partager et les bonifier avec le plus grand nombre pour les imposer aux dominants. Voilà ce qui dépend de nous » écrivent-ils.
Ces alternatives sont fondées non seulement sur la relocalisation de l’économie – objectif désormais incontournable, bien que ses formes et ses implications restent ambiguës –, mais aussi sur la redéfinition des richesses (qu’est-ce qu’une bonne vie ? que voulons-nous vraiment produire, et comment ? ), leur redistribution (quel partage ? quels sont les niveaux d’inégalité acceptables ?), la démocratisation de la démocratie (comment ne plus « déléguer à d’autres » le cours de nos vies et faire refluer les inégalités, le patriarcat et le racisme ?), la réinvention de nos relations à la Terre et au vivant (comment vivre avec, et non plus contre ? comment faire corps, et non plus masse ?), la refondation de la coopération internationale (comment décolonialiser nos rapports aux populations pauvres, au Sud comme au Nord, pour que chacune puisse bien vivre ?).
La démarche proposée par le chercheur Bruno Latour – « imaginer les gestes “barrière” contre le retour à la production d’avant crise » [2] – inspire leurs réflexions dans le chapitre 3 dont voici un extrait.
Repenser les besoins
Jamais un débat sur l’utilité sociale du travail n’avait eu une telle ampleur : de l’accent mis sur les « invisibles » à l’exercice du droit de retrait, le sens du travail a été au cœur des discussions depuis le début du confinement. Appelés par l’État ou les dirigeants d’entreprise à reprendre le travail, nombre de salariées ont eu conscience de risquer leur vie, même quand leur activité n’était pas vraiment « essentielle ». Malgré la demande des syndicats, le gouvernement a d’ailleurs refusé que soit établie une liste des activités essentielles.
C’est pourtant un débat sur les activités et besoins essentiels, mais hors épidémie, et d’une tout autre ampleur, qu’il est urgent d’ouvrir pour au moins tenir les objectifs de l’accord de Paris sur le climat. Ces objectifs imposent de réduire fortement notre empreinte écologique. À supposer même que toutes les habitantes des pays développés ne consomment que l’équivalent du minimum décent, les émissions associées resteraient – dans l’état actuel de nos modes de production – bien supérieures aux objectifs climatiques (de près de 40 %). Il va donc falloir faire le tri dans nos consommations.
Il faut d’abord, évidemment, faire décroître l’industrie publicitaire, qui pèse aujourd’hui bien trop lourd dans la furie consumériste et le formatage des besoins. Les fournisseurs d’accès à Internet devraient, par défaut, bloquer la publicité : libre ensuite à leurs clientes d’activer le déluge publicitaire, qui surcharge la bande passante du réseau et coûte à chaque consommatrice 480 euros par an (c’est ce que déboursent les annonceurs du Web). Cela affaiblirait Google et Facebook et donnerait un gros coup de pouce aux réseaux sociaux alternatifs libres. Le volume de publicité dans l’espace public devrait aussi être limité, et un financement public non publicitaire être garanti pour les médias indépendants, comme le propose la Convention citoyenne pour le climat.
Pour faire émerger des besoins non manipulés, il n’y a pas de solutions « clés en main », mais une nécessité de mobiliser à la fois l’expertise concrète des citoyennes et les savoirs « experts ». L’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale a expérimenté des procédures de délibération collective pour établir des budgets de référence permettant de satisfaire les besoins essentiels et d’accéder à un statut de citoyenne à part entière [3]. Cette délibération doit être engagée à une échelle bien plus vaste afin de faire le tri entre le superflu et le nécessaire. De quelles ressources a-t-on besoin pour se nourrir, se loger, se vêtir, se déplacer, mais aussi se cultiver, faire preuve d’autonomie et de créativité manuelle et intellectuelle, prendre part à la vie de la cité, contempler la nature ? La culture est un droit au même titre que la satisfaction des besoins physiologiques ; il importe qu’elle soit accessible à chacune, et non assujettie à la logique du profit.
Le débat sur la redéfinition des besoins compatibles avec la biosphère pourra déboucher sur des décisions politiques mettant en place des formes de rationnement individuel pour certains biens ou services particulièrement polluants (voyages en avion, croisières motorisées, résidences ou véhicules individuels...) ou certaines ressources en voie d’extinction.
Sauver les entreprises : oui, mais !
Redéfinir les besoins ne sert à rien si l’on ne transforme pas en même temps l’appareil productif. La crise ouvre à cet égard une fenêtre inédite. Au nom de la sauvegarde de l’emploi, les pouvoirs publics sont sur le pied de guerre pour tenter de sauver les entreprises : prise en charge des salaires (chômage partiel), garanties bancaires, facilités de paiement, annulation de créances... Pour certains « fleurons » en situation extrêmement difficile – l’industrie aéronautique et automobile notamment –, ils injectent de l’argent frais avant d’éventuelles recapitalisations. En contrepartie, la seule exigence est de « modérer » le versement de dividendes et la rémunération des dirigeants pendant la crise sanitaire.
Mais voulons-nous vraiment soutenir les entreprises du CAC 40, dont les profits cumulés atteignent plus de 260 milliards d’euros sur les trois dernières années et qui détiennent 2500 filiales dans des paradis fiscaux ? Sauver Air France et le secteur aérien, dont les émissions de CO2 connaissent une croissance exponentielle ? Relancer l’industrie automobile, qui a massivement délocalisé ses usines et multiplié les modèles polluants ? Renflouer l’industrie parapétrolière – Vallourec, CGC ou Bourbon – pour qu’elle continue à explorer de nouveaux gisements pétroliers et gaziers aux quatre coins de la planète ? Évidemment non. L’urgence ne peut servir de prétexte à l’inertie : pas de « relance post-épidémie » sans que les pouvoirs publics conditionnent leurs aides à la mise en œuvre de plans contraignants de justice fiscale, de relocalisation et de reconversion sociale et écologique, élaborés en concertation avec les salariées, les associations et les collectivités locales concernées et contrôlés par eux.
Au moment où les multinationales se précipitent au guichet de l’État pour quémander des aides publiques, le législateur se trouve en position de force pour leur imposer des efforts inédits. Il est temps de les soumettre enfin à l’accord de Paris en leur fixant des objectifs contraignants de réduction des émissions de GES sur une base annuelle de –7 % pour répondre aux dernières recommandations scientifiques. Celles qui dérogeraient à ces objectifs se verraient interdire de verser des dividendes à leurs actionnaires. Il faut rompre le lien d’intérêt lucratif entre les marchés financiers et les industries polluantes, ce lien qui entrave aujourd’hui l’émergence d’une économie décarbonée. Le partage de l’effort vers la sobriété doit en effet commencer par l’appareil de production et s’en prendre au nerf de la guerre : le capital financier.
Planifier la (dé)croissance
Que signifie la neutralité carbone, affichée comme le Graal de l’ambition climatique, dans des activités comme l’extraction d’hydrocarbures, la chimie, l’automobile, l’aéronautique ? Certains secteurs à l’empreinte écologique intrinsèquement excessive doivent décroître et leurs entreprises se reconvertir. Au-delà de l’actuelle crise, il va falloir inventer un processus démocratique de planification écologique pour rendre soutenable notre système productif : quelle décroissance pour certains secteurs, quelle croissance pour d’autres ? [4] Quelle croissance ou quelle décroissance, selon les secteurs ?
Le débat aura lieu à tous les niveaux territoriaux, dans les entreprises et les branches professionnelles. Quelles sont les activités néfastes pour la biosphère, et à quel rythme les faire décroître ? Quels désinvestissements des secteurs nocifs et quels investissements privilégier pour faire des économies d’énergie et réduire les importations de gaz et de pétrole ? Quels montants débourser, quelles coopérations mettre en œuvre pour relocaliser et développer la production de générateurs d’énergie renouvelable, les moyens de transport collectifs, l’agriculture paysanne, la production de biens et services essentiels ? Rien que pour la France, il faut rapidement faire décroître les investissements nocifs pour les faire tendre vers zéro et, en parallèle, augmenter les investissements « climat » en les faisant passer de 50 milliards par an actuellement à un minimum de 100 milliards.
Sur la base de ces débats décentralisés, des instances nationales – voire européennes, si possible – devront arbitrer. Le Parlement, sous le contrôle d’une conférence de citoyennes tirés au sort, et donc collectivement indépendants de tous les lobbies, fixera des objectifs d’investissement qualitatifs et quantitatifs dans les différents secteurs stratégiques. Des conférences régionales et de branche auxquelles participeront les directions d’entreprise, les syndicats, les associations environnementales et les collectivités publiques déclineront ces objectifs au plus près des unités productives et des territoires, en prenant en compte les équilibres écologiques et sociaux. Les banques publiques d’investissement fourniront les crédits nécessaires.
Reconvertir l’insoutenable
La décroissance de certaines activités nuisibles pose des défis sociaux majeurs. Deux conditions sont absolument décisives. D’abord, reconvertir au maximum les équipements et les emplois existants dans de nouvelles productions utiles pour préserver les qualifications et l’expérience des travailleurs. Et, quand cela n’est pas possible – il peut s’avérer difficile de reconvertir une raffinerie de pétrole en usine d’éoliennes –, garantir des formations professionnelles et le maintien intégral du salaire et de la protection sociale aussi longtemps que nécessaire. Il s’agit donc de mettre en place une sécurité sociale professionnelle financée par des cotisations sociales.
L’une des victimes collatérales du Covid-19 est l’industrie des transports. Comment sauver l’emploi et les savoir-faire sans relancer la prolifération insoutenable des avions-cargos, des SUV et du tourisme mondialisé de masse ? Il y a 45 ans, les ouvrierères de l’usine d’armement britannique Lucas Aerospace, confrontées à des suppressions d’emplois massives et aspirant à un travail socialement utile, ont imaginé une démarche de reconversion qui demeure plus que jamais inspirante [5]. Les syndicats ont adressé un questionnaire aux 13 000 salariées, toutes catégories confondues, pour faire l’inventaire des qualifications et des savoir-faire et susciter des propositions de transformation de la production. Le débat s’est ensuite engagé dans les comités d’atelier, ainsi qu’avec les organisations féministes et le mouvement écologiste.
En janvier 1976, le contre-plan ouvrier émit 150 propositions de productions alternatives : énergie (éoliennes, pompes à chaleur, solaire, carburants alternatifs...), santé (reins artificiels, instruments d’optique, véhicules pour la mobilité des personnes handicapées...), transports collectifs (bus hybrides pétrole-électricité, véhicules route-rail...). Il fut partiellement mis en œuvre, mais finit par être mis en échec par la résistance patronale et la reprise du marché des armements avec l’élection de Reagan aux États-Unis.
Socialiser les grands groupes
L’expérience historique enseigne qu’on ne peut espérer modifier durablement les trajectoires des grands groupes industriels et financiers en laissant le pouvoir de décision aux seuls actionnaires. On sait aussi ce que donnent les nationalisations classiques, généralement éphémères, dans lesquelles les inspecteurs des finances de Bercy désignent un PDG pour qu’il redresse l’entreprise en l’obligeant à se conformer aux exigences de rentabilité financière, avant de la restituer assainie aux actionnaires privés. Pour démocratiser la gouvernance des entreprises, certains proposent une codétermination entre capital et travail (50/50) ou bien une coexistence à parité dans les conseils d’administration d’une chambre du capital et d’une chambre du travail. Ce serait déjà un progrès, mais le pouvoir du capital risque fort de rester prédominant et de bloquer les reconversions qui ne seraient pas suffisamment profitables, d’autant plus que l’entreprise dépendrait de financements privés, voire des marchés financiers.
Le modèle des coopératives est beaucoup plus prometteur pour faire de l’entreprise un bien commun. De nombreuses études montrent que les coopératives sont au moins aussi productives que les entreprises classiques, avec de meilleures conditions de travail et un emploi plus stable. Les avantages sont encore supérieurs dans le cas des sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC). En effet, leurs choix stratégiques résultent d’une délibération approfondie mobilisant les diverses parties (salariées, investisseurs, clients, fournisseurs, collectivités locales, associations...) intéressées à la bonne marche de l’entreprise, à la qualité de sa production et à son impact environnemental.
Le travail est organisé en fonction non plus du seul profit des actionnaires, mais de l’utilité sociale, sanitaire et environnementale. Les personnes ne sont plus assujetties à un management financier qui rend leur travail de plus en plus abstrait et dénué de sens à leurs yeux. Elles co-décident des conditions et des finalités de leur travail. La présence d’autres acteurs représentant les usagers, la défense du vivant ou des générations futures facilite la mise à distance des logiques productivistes et oriente le travail dans une logique de care pour mieux prendre soin du monde.
Pourquoi ne pas transformer Air France, Renault et Airbus, et même la SNCF, EDF ou la Poste, en SCIC nationales capables d’assurer l’installation et la gestion des équipements nécessaires aux mobilités douces et aux transports collectifs réinventés dont nous avons besoin ? Pourquoi ne pas reprendre le contrôle d’une industrie pharmaceutique qui vit largement sur les deniers publics (Sécurité sociale, crédit d’impôt recherche, CICE...), y compris Sanofi et Servier en France, en visant la constitution d’un puissant secteur socialisé du médicament qui servirait l’intérêt général ?
Attac, Ce qui dépend de nous, Manifeste pour une relocalisation écologique et solidaire. 96 pages, 10 euros. Sortie en librairie le 24 juin. Ce manifeste est disponible gratuitement sous forme électronique dès ce 5 juin, en suivant ce lien. « Il constitue dès maintenant un bien commun, à la disposition de toutes celles et ceux qui veulent bloquer le "retour à l’anormal" et construire un "monde d’après" solidaire et désirable », précise Attac.
De nombreux contributeurs et contributrices ont souhaité apporter leur expertise et leur soutien à cet ouvrage collectif, et notamment : Dominique Méda, Claire Hédon, Mathilde Larrère, Nicolas Girod, Jean-Baptiste Fressoz, Marie-Hélène Bacqué, Pablo Servigne, Guillaume Faburel, Geneviève Azam, François Gemenne, Laurence de Cock, Txetx Etcheverry, Amélie Canonne, etc.