– Comment les lobbys industriels ont saboté les réformes voulues par les citoyens de la Convention climat
– Promesse d’un avion vert et défense de la liberté : la stratégie du secteur aérien pour contrer toute régulation
Basta! : Vous décrivez dans votre livre une mutation des stratégies de lobbying concernant l’utilisation de la science. Les industriels ne se contenteraient plus seulement de l’instrumentaliser en fabriquant leurs propres études – une stratégie désormais bien connue – mais ils cherchent également de nouveaux relais, notamment sur internet, à travers des influenceurs ou des citoyens lambdas qui vont ainsi contribuer à diffuser leurs messages, toujours sous couvert de l’ « autorité » de la science. Comment fonctionne ce mécanisme ?
Sylvain Laurens [1] : Il faut imaginer deux planètes qui s’aligneraient : la première, ce sont les stratégies du lobbying industriel, dont la trajectoire consiste à se donner toujours plus l’apparence d’un soutien d’ « en bas ». Ils vont aller chercher des soutiens au plus près des citoyens, notamment grâce à la technique de « l’astroturfing » [méthode consistant à simuler un mouvement de masse, spontané et populaire, qui est en réalité créé de toutes pièces, orchestré et coordonné par un groupe de personnes aux intérêts commerciaux, ndlr]. Appliquée à la science, cela donne des ONG comme Sense About Science qui offrent l’illusion d’une association d’amateurs de science, qui se lèveraient spontanément pour la défendre, alors qu’ils sont en réalité payés par l’industrie…

La deuxième planète, c’est celle des mouvements rationalistes et des organisations de défense de la science, telles que l’Afis (Association française pour l’information scientifique) ou les mouvements zététiques [2]. Depuis les années 1980, ces associations ont connu une évolution importante avec la prise de pouvoir progressive des ingénieurs en leur sein. Dès lors, la défense de la science a de plus en plus consisté à défendre l’innovation. Autrement dit, tout ce qui pourrait entraver les applications techniques de la science, telles que les OGM ou les antennes-relais par exemple, devenait de « l’anti-science ». Aujourd’hui, il devient compliqué de distinguer ce qui est véritablement de l’ordre d’une association d’amateurs de science portée par des ingénieurs, et ce qui est de l’ordre des stratégies d’industrie. Ce sont deux phénomènes qui se rencontrent. Au final, on se retrouve avec les mots d’ordre de Monsanto ou d’autres industriels inscrits dans les bulletins d’associations bénévoles de défenseurs de la science… Les réseaux sociaux facilitent cette connexion, puisqu’on y met en circulation des argumentaires qui peuvent alors se voir repris et démultipliés.
Stéphane Horel [3] : Ce relais peut se faire de façon tout à fait inconsciente, sans intention particulière. C’est justement ce que recherchent les firmes. Lorsqu’on travaille sur les stratégies dites de « manufacture du doute », autrement dit de manipulation de la science par les firmes, la question de l’intentionnalité est toujours centrale – on cherche à ce que l’étude produise des résultats à même de défendre le produit. Là, c’est beaucoup plus compliqué : le pari consiste à rendre publics des éléments d’informations en espérant que ce soit repris, ou plutôt, en faisant en sorte que ce soit repris par des personnes qui ne sont ni payées, ni forcément exactement au courant de ce qu’elles relaient, parce que c’est plus efficace pour persuader le citoyen moyen. On est dans le domaine de la psychologie : l’influence repose aussi sur des mécanismes qui misent sur l’inconscient des gens.
– avec Stéphane Foucart : Comment les industriels utilisent la science comme un instrument de propagande
– avec Stéphane Horel : « À Bruxelles, la vie des personnes est moins prioritaire que la bonne santé de l’industrie chimique »
L’ « innovation » est une rhétorique très forte dans les milieux économiques et industriels : est-ce aussi une façon de renouveler tout ce discours autour du progrès scientifique et technologique ?
SH : On peut vraiment parler d’une propagande sur l’innovation, qui a un but bien précis : délégitimer le principe de précaution et empêcher son application. On peut identifier assez clairement le point de départ de ce travail de sape, avec la création à Bruxelles du think tank European Risk Forum, à la fin des années 1990. C’est le groupe British American Tobacco qui en est à l’origine, dans le but d’empêcher la règlementation du tabac dans les lieux publics, après qu’on a découvert les mécanismes du tabagisme passif. L’industrie du tabac est une des pionnières de l’astroturfing, elle est très forte pour se trouver des alliés afin de ne pas avancer seule hors des fourrés – en l’occurrence, elle est allée chercher des alliés auprès des autres industriels de produits réglementés (la chimie, les pesticides, l’alimentation animale, etc) pour créer ce think tank.
On peut vraiment parler d’une propagande sur l’innovation, qui a un but bien précis : délégitimer le principe de précaution et empêcher son application.

Le European Risk Forum a ensuite poussé au fil des années une propagande continue sur le principe d’innovation, et a réussi à faire implanter dans la règlementation européenne un certain nombre de fusibles pour empêcher le recours au principe de précaution. Ce qui a participé d’un phénomène assez étrange : aujourd’hui, dans l’opinion publique, le principe de précaution est plutôt perçu comme quelque chose de nocif pour les gens… quel renversement fantastique, tout de même ! C’est donc une stratégie extrêmement payante.
SL : Des gens sont intimement convaincus que la science et l’innovation, c’est la même chose. Que si on veut aller dans le progrès, il faut enlever toutes les entraves à l’innovation technique, et que si le relais de cette innovation aujourd’hui, c’est le secteur privé, ce n’est pas grave. C’est ce qu’on apprend dans les écoles d’ingénieur, il y a une filiation. Prenez une école comme Télécom ParisTech, elle préparait à des débouchés publics, il y a 30 ans. Mais avec la semi-privatisation d’Orange et le déplacement des débouchés vers des entreprises innovantes privées, de type start-up, le discours a considérablement changé, et on se retrouve à y défendre l’innovation industrielle comme on défendait la science en tant que bien commun.
SH : Tout cela est aussi rendu possible par l’image que la science a, dans notre société. Pour l’opinion publique, un scientifique dit forcément la vérité. Comme si la Science était « la Comté » dans le Seigneur des Anneaux, ce pays des Hobbits au cœur pur, drapés dans leur blouse blanche, qui travailleraient de façon complètement détachée des conflits et des intérêts qui traversent la société… Ce n’est pas du tout le cas.
Ce discours sur l’innovation imprègne la question écologique : on a pu voir à travers la Convention Citoyenne pour le Climat comment le secteur privé s’attachait à défendre une transition écologique basée sur des solutions techniques, faisant appel aux nouvelles technologies ou à l’ingénierie...
SL : En France, il y a par exemple un lien très fort entre les mouvements rationalistes et l’industrie du nucléaire. À partir de la création du parc nucléaire dans les années 1970, on a vu beaucoup d’ingénieurs s’investir dans les associations de défense de la science. Le président de l’Union rationaliste était jusqu’il y a peu Haut-commissaire à l’énergie atomique. Jean-Paul Krivine, qui a dirigé l’Afis, était un ingénieur EDF. Ces acteurs-là ont pris le tournant du discours environnemental, en reconnaissant l’importance du changement climatique et en proposant dès lors le nucléaire comme première solution, au motif qu’il émet très peu de CO2 ! C’est devenu le premier argument des rationalistes sur ces questions-là : « Si on est vraiment écolo, il faut défendre le nucléaire »…
SH : C’est parfaitement reflété par la tribune de « No Fake Science », qui pose le nucléaire comme une évidence et un consensus scientifique. Le changement climatique devient un enjeu d’instrumentalisation important pour les firmes qui causent justement des dégâts à l’environnement et à la santé humaine. Une entreprise comme Syngenta (spécialisée dans les pesticides) a développé tout un programme de communication et d’action sur le changement climatique, alors qu’on attendrait peut-être d’abord qu’elle retire du marché ses produits trop dangereux ou qu’elle respecte la règlementation ! Ce consensus sur le changement climatique leur est finalement utile : ils l’utilisent pour prétendre s’y conformer et refaire leur image, en évitant de régler les problèmes qu’on leur demande de traiter.
Vous soulignez que la défense de la science était historiquement une valeur brandie par la gauche. Elle est désormais revendiquée par des courants politiques libertariens, transhumanistes ou ultralibéraux : cela dit-il quelque chose sur la façon dont les clivages politiques se recomposent ?
SL : Historiquement, les rationalistes défendaient l’idée que la science avait une utilité pour tout le monde, qu’elle devait servir la collectivité et le bien commun pour obtenir un mieux. C’est en ça que c’était vu comme quelque chose de progressiste, et donc plutôt de gauche. C’est tout l’inverse de dire « je vais utiliser mon savoir pour prouver que mon produit n’est pas toxique »… Une vraie posture rationaliste, sur le nucléaire par exemple, serait de dire : comment peut-on trouver une autre forme d’énergie qui permettrait à la fois de réduire les émissions de CO2 sans pour autant se retrouver avec des déchets dont on ne sait pas quoi faire, ou dépendre d’une filière extractiviste au Niger ou au Kazakhstan ? Avant, le rationalisme cherchait à comprendre comment la science du futur pourrait venir aider la société dans une perspective commune et humaine. Aujourd’hui, c’est défendre le statu quo au nom du fait qu’on ne peut pas faire autrement… c’est donc devenu une forme de conservatisme, en tout cas sur les questions du nucléaire par exemple.
On peut être contre les technologies sans être anti-science : on peut s’opposer au compteur Linky, non pas par peur des ondes, mais parce qu’on n’a pas envie de fabriquer de la data à partir d’un tel instrument.
C’est un vrai glissement : on ne peut plus critiquer le nucléaire, sauf à être anti-science… Sauf qu’on peut être contre les technologies sans être anti-science : on peut s’opposer au compteur Linky, non pas par peur des ondes, mais parce qu’on n’a pas envie de fabriquer de la data à partir d’un tel instrument, ou qu’on supprime les postes de ceux qui relevaient les compteurs. La critique de la technologie est un ensemble de critiques. Ça aussi, c’est un point de vue d’ingénieur : avec le compteur Linky, on ne critique pas simplement le produit fini ou l’application industrielle, on critique aussi tout le système de relations sociales qui peut aller avec, dont la marchandisation des datas personnelles. Il ne suffit pas d’avoir une innovation technologique, il faut aussi voir au service de quoi on va la mettre. Je ne donnerais donc pas forcément l’étiquette de « rationalistes » à des libertariens ou des ultrascientistes qui essayent de nous démontrer qu’on peut détruire la planète parce qu’on pourra la quitter en vaisseau spatial pour aller ailleurs.
SH : On en revient toujours à cette même question : qu’est-ce que c’est le progrès ? Est-ce que c’est mettre des pesticides sur le marché et attendre 30 ans de voir si ça tue des gens ou détruit les écosystèmes ? Maîtriser une technologie est-elle une raison suffisante pour l’employer ? La question n’est jamais posée dans ce sens-là, de cette façon-là. L’une des rares questions technologiques sur lesquelles il y a eu un vrai débat de société, ce sont les OGM. Et la société a opposé une fin de non-recevoir : le recours aux OGM a été bloqué à l’échelle de tout un continent.
Ceux qui tiennent ces discours associant technologie et environnement sont aussi souvent les mêmes qui s’attaquent aux féministes ou insistent sur l’Islam et l’immigration…
SL : C’est l’une des découvertes de notre enquête : effectivement, ce sont souvent les mêmes qui prônent le glyphosate et qui s’emportent contre l’écriture inclusive ou qui défendent le néo-darwinisme version Peggy Sastre. Il y a un continuum, on les retrouve dans les mêmes revues, Le Point, Valeurs actuelles, etc., avec une sorte de socle théorique commun, basé sur un usage conservateur de la notion d’universalisme – avec l’idée que les antiracistes nieraient l’existence d’une humanité commune ou que les féministes nieraient l’existence d’une forme de combat de gauche émancipatoire et universel. Cela peut être une stratégie délibérée pour fracturer la gauche, car ce genre de discours, accroché aux valeurs républicaines face à l’idée d’un « séparatisme », trouve un écho auprès de certains militants, à gauche.
Mais c’est intéressant de constater que de leur côté, les libertariens passent leur temps à faire des alliances avec des gens qui ont des contradictions tout aussi fortes. Dans l’extrême droite américaine, il y a des créationnistes jusqu’au bout des ongles, et des libertariens profondément athées qui pensent que Darwin est la réalité à défendre… Ces mêmes acteurs qui brandissent des contradictions pour fracturer la gauche sont, eux, tout à fait capables de lever leurs propres contradictions théoriques quand il s’agit de faire des alliances allant de l’extrême droite religieuse américaine à l’ultralibéralisme de campus classique.
Dans ces nouvelles stratégies de lobbying, les réseaux sociaux jouent également un rôle prépondérant : en quoi représentent-ils un terrain de jeu particulièrement propice ?
SL : Les réseaux sociaux permettent de porter un argument scientifique de façon « dégriffée », sans la marque, en faisant du ghostwriting ou en faisant en sorte que des chercheurs reprennent les arguments. Surtout, ils permettent de diffuser très loin ces mêmes arguments, en les voyant repris par des personnes ordinaires, et repris tels quels, sans que cela coûte spécialement plus cher. Les réseaux sociaux, et leurs communautés virtuelles, sont des démultiplicateurs de messages, d’autant plus puissant qu’ils sont portés par « en bas » : plus les chaînes de légitimation sont éloignées, plus le message sera fort au final, puisqu’on a l’impression que les gens qui relaient n’y ont pas d’intérêts financiers. Avec simplement deux ou trois consultants bien positionnés dans une communauté sur Twitter, les effets d’entraînement peuvent être très importants : pas besoin de créer 150 faux comptes avec des mots-clés pour troller toute la journée, seuls quelques relais efficaces suffisent. Cela permet d’abaisser les coûts d’achat d’espace.
C’est comme ça que tout un marché de la micro-influence s’est développé. Plutôt que payer des vues ou de l’espace publicitaire sur des plateformes comme Youtube, les agences proposent désormais aux entreprises de payer dix youtubers qui auraient chacun leur communauté d’abonnés un peu spécialisées. Double-bénéfice : ça coûte moins cher, et c’est potentiellement porté plus loin… Ce sont des techniques de relations publiques qui se sont déployées massivement sur les réseaux sociaux et qui ne sont pas propres à la science. Mais appliqué à ce domaine, cela explique qu’on se retrouve avec d’un côté des youtubers qui lancent leur chaîne de vulgarisation scientifique, et de l’autre, des agences qui proposent à leurs clients de payer du contenu sur ces chaînes. On voit également de plus en plus d’anciennes gloires de télé se recycler sur Youtube et proposer ce même genre de services : c’est le cas de Michel Cymes, qui est directement partie-prenante de Webedia, la plus grosse plateforme française de micro-influenceurs, ou encore de Jamy, l’ancien animateur de « C’est pas sorcier », également sur Webedia. Tout cela représente un peu le nouvel écosystème de l’influence, qui tend à brouiller toujours plus le repérage des stratégies de lobbying.
Cela fonctionne aussi lorsqu’il s’agit de réagir, ou de créer la polémique : c’est ce que vous appelez la « trollisation du débat public ».
SH : J’ai récemment publié une enquête sur la cigarette électronique et les stratégies de l’industrie du tabac autour de ces nouveaux produits dits « à risque réduit ». Or il se trouve que la communauté des vapoteurs s’avère extrêmement bien structurée sur les réseaux sociaux, résultat : ça a été un déluge de trolls, à la publication de l’article. Je pense que c’est à rapprocher des stratégies des industriels depuis plusieurs décennies : ils attaquent ad hominem les scientifiques qui produisent des études montrant les dangers de leurs produits. Il faudrait faire le « Hall of Fame » de ces chercheurs attaqués par de grandes firmes, comme Tyrone Hayes par Syngenta au sujet de ses travaux sur l’atrazine. Cette décrédibilisation des scientifiques indépendants est très présente, par exemple sur le débat de la perturbation endocrinienne autour de la réglementation européenne ou autour du glyphosate. Or quand vous écoutez les scientifiques parler de l’énergie et du temps perdu à devoir gérer ça, et y répondre, cela ressemble assez à ce dont on parle, nous, à propos des harcèlements sur les réseaux sociaux. Je suis convaincue qu’il y a une intention réelle de faire perdre un temps précieux, quand on attaque des journalistes ou des scientifiques.
Les lobbys ont intérêt à polariser le débat : ils ne cherchent pas forcément à gagner sur le fond, mais à montrer que ce n’est pas consensuel.
SL : En fait, les lobbys ont intérêt à polariser le débat : ils ne cherchent pas forcément à gagner sur le fond, mais à montrer que ce n’est pas consensuel. Or si ce n’est pas consensuel, c’est que « la vérité est quelque part au milieu » se dit-on souvent, en réaction : plusieurs études ont montré qu’à partir du moment où un sujet devient polémique et conflictuel, les gens vont avoir spontanément tendance à se placer dans l’entre-deux, comme par l’effet d’un habitus démocratique qui nous encouragerait à mettre sur le même plan les arguments des deux côtés, quitte à les renvoyer dos-à-dos… Et c’est comme ça qu’on se retrouve à penser que « le glyphosate est peut-être un petit peu dangereux, mais pas trop », et c’est bien le but premier. Dès que vous parvenez à créer un effet de polarisation, vous avez déjà gagné.
Vous concluez votre livre sur un propos d’actualité, plutôt optimiste : « Si l’on peut attribuer un mérite à la crise du Covid-19, c’est sans doute celui d’avoir subitement levé le voile sur les usages les plus opportunistes de l’autorité scientifique par ses libéraux déguisés en rationalistes. De quoi remettre au centre du débat public les scientifiques compétents ? », écrivez-vous. On pourrait aussi vous objecter que le débat public a vu l’émergence du Docteur Raoult et la profusion de nombreuses thèses complotistes…
SL : Certes, mais il y a aussi eu une forme d’élévation générale des compétences sur les questions de virologie – on sait ce qu’est un taux d’incidence, on s’est documenté, on a peut-être appris à mieux croiser ses sources, ou à réfléchir à leur provenance… Au fond, c’est sain que la population doute de la parole des experts : pas pour alimenter le « Tous pourris », mais plutôt pour nourrir un rapport plus réflexif et critique sur ce qu’est la science. Le Docteur Raoult, certains l’ont vu comme un personnage crédible, mais beaucoup d’autres ont aussi considéré qu’il ne suffisait pas d’avoir une blouse blanche pour dire la vérité ! Pour moi, cette crise nous fait évoluer sur notre rapport à la science, et plutôt dans le bon sens, en tout cas avec peut-être une moindre dépendance aux « experts » des plateaux TV, qui était tout de même très forte avant la crise…
SH : Je suis d’accord, mais je crains que ce phénomène reste contenu à la question du Covid-19. Je doute que cela puisse véritablement contaminer la réflexion sur les autres sujets qui touchent à la science. Avec Raoult, c’est aussi la question de la responsabilité du politique, qui s’est posée : pourquoi diable Emmanuel Macron lui a-t-il rendu visite ? Le problème de la crédibilité de la science dans ce genre de crise, c’est aussi la façon dont les politiques se servent de la science ou l’instrumentalisent pour justifier des erreurs, a posteriori !
Propos recueillis par Barnabé Binctin et Olivier Petitjean
Depuis la fin de la Convention Citoyenne, dont il aura été l’une des figures les plus médiatiques en tant qu’initiateur et « garant » de la démarche, Cyril Dion est régulièrement victime sur Twitter des phénomènes précisément décrits par les auteurs de Les gardiens de la raison. Il témoigne.

« A partir de cet été, plusieurs comptes que je ne connaissais pas se sont mis à réagir au moindre tweet. Les arguments étaient toujours les mêmes : « Quelle blague cette Convention Citoyenne, ces gens n’ont pas été tirés au sort, de toute façon c’est piloté en sous-main par des militants, etc. ». Ensuite pendant plusieurs mois, dès que je postais quelque chose, j’avais droit à des escadrons de trolls, particulièrement sur les questions d’agriculture ou de nucléaire. Je n’avais jamais vécu ça jusqu’à présent, mais c’est assez violent, il y a vraiment l’idée de te démolir et te décrédibiliser dans l’opinion publique. J’ai régulièrement droit aux critiques de gens comme Géraldine Woessner (journaliste au Point), Emmanuelle Ducros (journaliste à L’Opinion), Mac Lesggy (ancien présentateur d’E=M6). Je vois le même phénomène avec François-Marie Bréon, le président de l’AFIS. Qui préside donc une asso censée dénoncer la fausse-science, mais qui tweete qu’il est impossible de faire pousser des légumes sans pesticides ou qui n’hésite pas à glisser quelques contre-vérités sur les énergies renouvelables…
Aujourd’hui, on constate bien la puissance de ces nouveaux éléments de langage, très orienté sur la technologie : si tu te dis écolo, tu dois être pour le nucléaire, le glyphosate et les OGM. Sinon, tu es un obscurantiste. Et avec cette même mise en scène d’un grand combat sur l’écologie : eux, l’écologie pragmatique, de la raison, et nous, l’écologie dogmatique, de l’injonction, quand on n’est pas taxé d’« hystérique ». Or ce qui est fou, c’est que désormais j’ai même le droit à des tweet-clash de ministres ou de députés ! Comme avec Julien Denormandie, au sujet d’une tribune sur l’agriculture… Difficile, dans ce cas, de ne pas imaginer qu’il relaie des éléments de langage. »
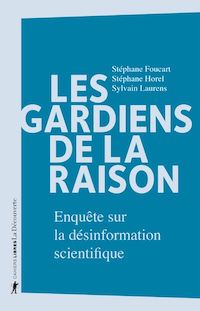
Les Gardiens de la raison. Enquête sur la désinformation scientifique, de Stéphane Foucart, Stéphane Horel et Sylvains Laurens (La Découverte, 2020)








