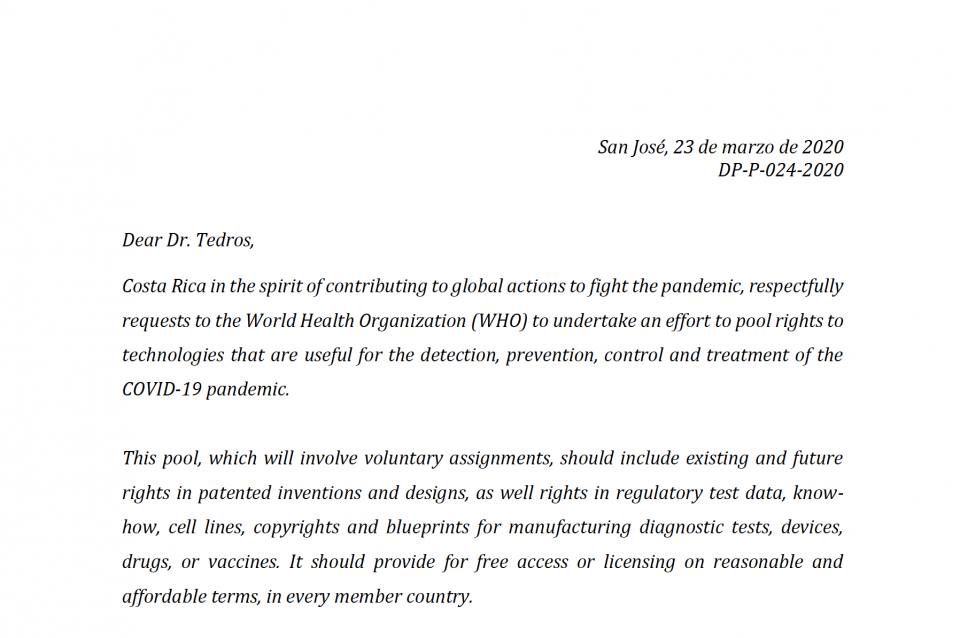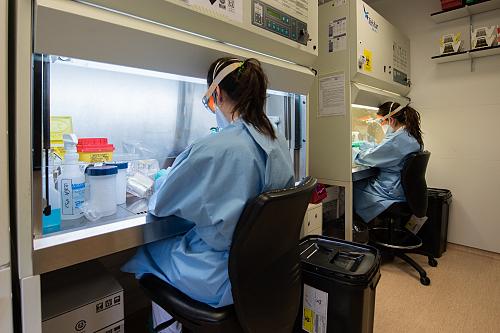Sanofi, Novartis, Bayer… Ces multinationales pharmaceutiques promettent d’offrir des millions de doses de chloroquine, l’un des traitements à l’étude contre le Covid-19. « Big Pharma » serait-elle en train de remiser au placard sa soif de profits, pour lutter solidairement contre le coronavirus ? « Il faut vraiment observer le geste soi-disant philanthropique de Sanofi avec méfiance. Pour Sanofi, 300 000 boîtes de chloroquine, ce n’est rien en termes financiers », tempère Jérôme Martin, ancien président d’Act Up-Paris et cofondateur de l’Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament.
Fin mars, la firme californienne Gilead a tenté d’obtenir, pour l’un de ses anti-viraux recyclés contre le Covid, le statut de « traitement contre une maladie rare », statut qui ouvre droit à des crédits d’impôts et des avantages commerciaux (lire notre enquête). Cette tentative, contrée par la société civile, fait redouter le pire en matière de pratiques sans scrupules de la part des labos pharmaceutiques. Elle a ravivé les craintes chez ceux qui se battent pour un accès de tous, et dans le monde entier, aux médicaments.
Parmi eux, Patrick Durisch, chargé des questions de santé pour l’ONG suisse Public Eye : « Quelle entreprise aurait le culot aujourd’hui de dire “on profite de cette crise pour renflouer nos caisses" ? interroge-t-il. Est-ce que le secteur pharmaceutique dans son ensemble va prendre acte que cette crise est exceptionnelle et qu’il faut qu’il renonce à ses droits exclusifs sur les traitements ? » Ces droits exclusifs peuvent être des brevets, des exclusivités de commercialisation pour plusieurs années, ou bien des secrets de fabrication… « Si les entreprises pharmaceutiques veulent vraiment associer la pratique aux discours, il faut qu’elles lâchent du lest. »
Poser des conditions pour les recherches financées par l’argent public
Comment obliger l’industrie pharmaceutique à « lâcher du lest » sur ses intérêts financiers ? Tout d’abord en posant des conditions aux programmes de recherche financés par l’argent public. « La Commission européenne et les États investissent depuis janvier de grosses sommes pour les recherches sur le Covid », souligne Viviana Galli, qui suit le dossier à l’Alliance européenne pour des médicaments accessibles [1]. 47,5 millions d’euros ont par exemple été alloués via le programme européen Horizon 2020. Lorsque des molécules efficaces sont identifiées dans le cadre de ces programmes de soutien à la recherche, les traitements sont généralement brevetés par des entreprises privées, qui en détiennent ensuite le monopole de production, pour les vendre cher, très cher. En sera-t-il autrement pour lutter contre le Covid-19 ?
L’Europe a aussi investi 45 millions d’euros via un partenariat public-privé, « Innovative Medicines Initiative ». 45 autres millions doivent être abondés par les entreprises. Le programme est cogéré par la Commission européenne et le groupement européen de l’industrie pharmaceutique [2]. Les autorités européennes ont aussi prêté 80 millions aux entreprises qui travaillent sur un vaccin, via la Banque européenne d’investissement.
Est-il possible d’intégrer à ces financements des obligations, par exemple un plafonnement du prix de vente ? « Légalement, tout est possible, cela dépend de la volonté politique, répond Viviana Galli. Quand des équipes qui allient recherche publique et entreprises pharmaceutiques gagnent un appel pour recevoir de l’argent européen, un contrat est signé avec la Commission européenne. C’est envisageable d’inscrire dans ces contrats des clauses sur les licences des futurs traitements, sur la transparence de toutes les données des essais, ou sur l’accessibilité des médicaments, même si les prix restent une compétence nationale des pays membres. » Pour l’instant, aucun des programmes lancés par l’Union européenne ne fait clairement mention de ces garanties.
Un autre outil pour peser sur les prix serait une obligation de transparence sur les fonds publics qui ont contribué à développer un traitement. Une même entreprise pharmaceutique peut recevoir des fonds de la France, de l’Allemagne, de l’Union européenne pour développer une même molécule. Résultat : il est très compliqué d’avoir une vision exhaustive de tout l’argent public investi dans une recherche donnée. « Or, si vous avez ces infos, vous avez plus de poids pour négocier les prix », explique Viviana Galli.
Ouvrir les licences pour fabriquer des médicaments génériques
Autre levier : prévoir des licences « non-exclusives » dans les contrats de financement. Le marché du médicament est régi par les règles de la propriété intellectuelle : les traitements et les vaccins sont couverts par des licences, un peu comme des logiciels ou les œuvres culturelles. Des licences exclusives assurent à une entreprise un monopole sur un traitement. Dans une situation de pandémie, alors que tous les pays auront besoin en même temps des mêmes traitements et vaccins, il semble évident qu’une seule entreprise ne pourra pas produire assez pour tout le monde.
Les entreprises qui détiennent des droits exclusifs peuvent certes distribuer des licences « volontaires » à d’autres producteurs de leur choix. Mais cela ne sera pas suffisant, avertit Patrick Durisch. « Si on pense qu’un grand groupe pharmaceutique, quel qu’il soit, va pouvoir, en distribuant lui-même des licences à qui il veut, répondre aux besoins mondiaux, on se trompe. Ils n’y arriveront pas. Pour y parvenir, il faut permettre à d’autres acteurs d’entrer en jeu. »
C’est tout l’enjeu d’une initiative lancée par des ONG et des pays, dont le Costa Rica, qui demandent à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) d’œuvrer « pour mettre en commun les droits sur les technologies utiles pour la détection, la prévention, le contrôle et le traitement de la pandémie de Covid-19 » [3] En clair, le petit État d’Amérique centrale demande à ce que les traitements potentiels contre le Covid, les produits nécessaires aux tests de dépistage, et le futur vaccin éventuel, soient mis en commun à toutes les nations, et non détenus au profit exclusif d’intérêts privés.
« Le Costa Rica se fait ici le porte-parole des pays émergents qui voient ce qui se passe actuellement en Europe, où chacun essaie de sécuriser son approvisionnement au niveau national sans se préoccuper de ses voisins. Mis à part les États-Unis, l’Europe, et le Japon, les autres pays n’ont en général pas voix au chapitre en matière d’accès aux traitements, rappelle Patrick Durisch. Cela s’est vu lors de la pandémie de grippe H1N1 en 2009 : les pays riches se sont réservés des quantités de vaccins pour leurs propres besoins, et les autres ont eu des miettes, voire rien du tout. »
La démarche du président du Costa Rica est soutenue par des dizaines d’ONG [4]. Elle s’appuie sur une expérience lancée en 2010, les communautés de brevets – appelées « medecines patent pool ». L’initiative, coordonnée par l’organisation internationale Unitaid, visait à améliorer l’accès aux traitements antirétroviraux, contre le sida, dans les pays à faibles revenus, puis s’est élargie aux traitements contre l’hépatite C et la tuberculose. Dans ce cadre, les entreprises pharmaceutiques détentrices des brevets (en général des multinationales implantées dans les pays riches) donnent leur accord pour que des fabricants de médicaments génériques de pays du Sud puissent produire et distribuer les traitement localement. « Le "medicines patent pool" négocie avec les détenteurs de brevets l’octroi de licences pour des médicaments », explique Juliana Veras, de Médecins du monde.
Socialiser la production de traitements au niveau mondial
La proposition du Costa-Rica ambitionne d’aller plus loin. « L’idée, c’est que pour assurer une production suffisante et un prix abordable, il faut un mécanisme de mutualisation au niveau de l’Organisation mondiale de la santé. L’OMS pourrait redistribuer les droits de licence ou les secrets de fabrication à d’autres producteurs là où il y en a besoin », détaille Patrick Durisch. Ce serait finalement comme une socialisation globale de la production de traitements.
« Quand vous détenez un brevet, vous êtes le seul à pouvoir produire le traitement. Si d’autres le produisent, ils peuvent être saisis devant un tribunal. Mais le détenteur du brevet peut autoriser de lui-même quelqu’un d’autres à produire en son nom le traitement. Si cela se passe comme cela, c’est une licence volontaire. Le mécanisme au niveau de l’OMS serait un mécanisme commun mondial de licences volontaires, et qui inclurait aussi d’autres aspects menant à des monopoles comme les secrets de fabrication. »
Pour mettre en place ce mécanisme, il y aurait autour de la table à la fois l’OMS, les États qui en sont membres, les entreprises pharmaceutiques, et des organisations de la société civile. « Ce projet est une mobilisation ancienne, ajoute Juliana Veras. La crise du Covid met aujourd’hui en lumière que nous en avons vraiment besoin. »
Ultime recours : casser les brevets des entreprises
Une telle mutualisation des droits de production serait, à ce niveau, inédite. Tout comme la crise sanitaire du Covid-19. Sans mise en commun, le risque est grand que l’accès aux médicament dépende des capacités financières des pays, et des malades. Si ce projet échoue, les États pourront aussi opter pour des licences « d’office » ou « obligatoires ». Si un labo refuse de distribuer de son plein gré des licences pour permettre à d’autres producteurs de fournir des traitements génériques, les pays peuvent décider que l’accès à ces médicaments est d’intérêt général. L’État casse alors le brevet, lève le monopole détenu par l’entreprise, et autorise d’autres producteurs à fabriquer le médicament.
Plusieurs pays du Sud ont utilisé cette possibilité depuis le début des années 2000. Le Brésil et son président d’alors, Lula, ont par exemple cassé le brevet de Merck sur l’antirétroviral Efavirenz en 2007. Des entreprises brésiliennes ont ainsi pu produire des versions génériques, et moins chères, du traitement. En 2012, l’Inde a émis une licence obligatoire pour passer outre un brevet de Bayer sur un anticancéreux, et pouvoir ainsi en produire des versions génériques localement. En 2016, la Colombie a annoncé vouloir émettre une licence obligatoire sur le traitement contre la leucémie Glivec, un médicament de l’entreprise suisse Novartis. Par la suite, Novartis a exercé des pressions à répétition sur le gouvernement colombien pour protéger son brevet, en le menaçant de porter l’affaire devant un tribunal international d’arbitrage (ces ISDS devant lesquels les multinationales demandent des milliards de compensation aux États) [5].

Dans les pays du Nord, la procédure de « licences d’office » sert plus d’épouvantail pour faire pression sur les entreprises. Et parfois, ça marche. En 2001, il a suffi aux États-Unis d’évoquer la possibilité de la licence obligatoire pour pousser Bayer a réduire le prix de son antibiotique contre l’anthrax [6]. Les États-Unis faisaient alors face à une série d’attaques via des lettres contaminées par le bacille.
En France, cette possibilité a été évoquée en 2014 pour le traitement contre l’hépatite C de l’entreprise Gilead, commercialisé à un prix exorbitant, mais sans suite. « L’État français n’a jamais utilisé de licence d’office », note Juliana Veras. « En fait, les États, en particulier du Nord, ont plutôt tendance à protéger les grands groupes pharmaceutiques, surtout les États qui les hébergent. Émettre une licence obligatoire, c’est une déclaration hostile, précise le suisse Patrick Durisch. En Europe, c’est un tabou. Mais le jour où il y aura des traitements officiellement homologués pour le Covid, et qu’il n’y en aura pas assez ou qu’ils seront très chers, c’est possible que même des pays européens choisissent cette voie. »
L’Allemagne et le Canada se préparent à passer outre les brevets
La crise du Covid-19 pourrait en effet changer la donne, une fois que les traitements seront homologués et commercialisés. L’Allemagne a déjà fait modifier sa loi en mars pour permettre au ministre de la Santé de décider de telles licences. Selon Médecins sans frontières, le Canada, l’Équateur et le Chili sont aussi en train de prendre des mesures pour faciliter les licences obligatoires [7].
Ces démarches sont du ressort de chaque pays. Or, pour Juliana Veras, « ce qu’il faudrait surtout éviter, ce sont les initiatives protectionnistes. On le voit avec les masques, si on ne pense pas la coordination et la solidarité en amont, on se retrouve avec des États qui ne cherchent qu’à protéger leur intérêts nationaux. » Sans mécanisme global de solidarité, difficile d’éviter que chaque État ne se réserve des traitements en masse au détriment des autres. Déjà certains pays font des stocks de chloroquine. Ce qui pourrait faire augmenter les prix, même si la molécule n’est pas protégée par un brevet (elle a été créée dans les années 1930).
« La chloroquine est un produit utilisé par les malades du paludisme, rappelle Jérôme Martin, de l’Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. Comme c’est un possible traitement contre le Covid, la demande augmente. Si la production ne suit pas au niveau mondial, les malades de paludisme pourraient se retrouver, eux, sans traitement. Car les fournisseurs vont préférer vendre à des pays riches plutôt qu’à des pays pauvres. » Sans mécanisme de solidarité au niveau mondial, les inégalités dans l’accès aux traitements risquent bien de se perpétuer.
Rachel Knaebel
Photo de une : State Public Health Laboratory, Exton, Pennsylvanie (États-Unis) / CC Tom Wolf