Cet entretien est également disponible en intégralité à l’écoute :
Basta! : Au 19e siècle, la consommation de drogues n’était pas vraiment interdite. Quand débute la politique prohibitionniste sur les drogues ?
Alexandre Marchant [1] : C’est le tournant de la guerre à la drogue des années 1960-1970, quand les usages se massifient un peu et que l’on durcit partout la législation. Aux États-Unis, les autorités déclarent la guerre à la drogue et invitent leurs pays « partenaires » à combattre les trafiquants. Avant le début du 20e siècle, il n’y avait pas de prohibition forte. Les substances psychotropes circulaient plus ou moins librement. Ce n’est qu’au début du 20e siècle, quand on a vu qu’il y avait des usages non médicalement contrôlés qui se diffusaient en Occident, avec la situation en Chine où l’ouverture du marché chinois à l’opium produit par les Anglais fait des ravages terribles, que l’on s’est dit qu’il fallait peut-être contrôler. C’est alors que la prohibition se met en place, peu à peu. Il s’agit d’abord plus d’une régulation que d’une interdiction. Des conventions internationales définissent un marché mondial légal de l’opium et de ses dérivés. La coca et ses dérivés y sont ensuite intégrés, pour limiter la vente de ces produits à un marché pharmaceutique légal, contrôlé par les médecins, les pharmaciens, les industries... Tout ce qui est en dehors de ce marché était interdit. Le trafic, alors, ressemblait davantage à de la contrebande.
En France, de quand datent les premières lois sur les drogues ?
La toute première loi en France date de 1916. C’est alors simplement la traduction de cette grande convention internationale qui vient d’être signée avant la Première Guerre mondiale. Dans cette première loi française, on interdit la cocaïne et l’héroïne, et on introduit au passage le cannabis. Puis, il y a une loi en 1953. C’est à cette période que les autorités commencent à démanteler des laboratoires clandestins dans le sud de la France. La loi de 1953 est un peu plus répressive par rapport à celle de 1916. Cette nouvelle loi envisage aussi la création d’un secteur de soin spécialisé pour les toxicomanes. Le vœu est énoncé, mais n’est pas alors suivi d’effets. 15 ans après, le règlement qui devait créer ce secteur de soin n’existe toujours pas.
Dans quel contexte social, médiatique, politique, la troisième loi, celle de 1970, qui est toujours en vigueur, est-elle été adoptée ?
Nous sommes à la fin des années 1960, c’est le grand moment de la contre-culture, qui se diffuse depuis les États-unis. Plein de mouvements contestataires divers font l’apologie du plaisir, de la libération des mœurs et entre autres, de l’usage de drogues sur un mode récréatif, du cannabis et, surtout, du LSD. Ce sont les grandes années du LSD. L’héroïne est alors marginale. Mais cela inquiète l’opinion publique. Par ailleurs en France, avec mai 68, surgit une crise « de civilisation », disait le Premier ministre Pompidou, que les adultes, que les politiciens gaullistes, ne comprennent pas. Cela leur fait peur, ils amalgament la question de la drogue et de mai 68. Dans ce contexte, un fait divers est fortement médiatisé. Il s’agit de l’overdose d’héroïne d’une jeune fille, Martine, à Bandol, à la rentrée 1969. Ce fait divers déclenche un vaste débat public, des auditions parlementaires, le gouvernement veut déposer un projet de loi... La loi est finalement adoptée en décembre 1970.
Quel est le contenu de cette nouvelle législation ?
Elle durcit énormément la répression. On passe à des peines de prison qui étaient de 5 ans pour des activités de trafic ou de transformation chimique de morphine, à des peines de 10 ans, 20 ans pour les récidivistes. C’est une loi très dure qui va placer derrière les barreaux quelques acteurs de la « French connection », ce réseau de trafic d’héroïne du sud de la France. Ils avaient déjà été arrêtés par le passé, mais ressortaient de prison avant la fin de leur peine de cinq ans. Concernant l’usager, la loi en fait une victime qu’il faut sauver. Elle met donc en place un secteur de soin spécialisé. Le psychiatre Claude Olievenstein devient très médiatique et crée l’hôpital Marmottan. On crée le principe de l’injonction thérapeutique : l’usager simple, interpellé, peut se voir prescrire par le juge une cure. S’il la suit, il échappe à toute poursuite judiciaire.
Mais cette loi définit également l’usager, le consommateur, comme un délinquant ?
C’est toute l’ambiguïté et la contradiction de la loi de 1970. Elle affirme que le trafiquant est un marchand de mort, qu’il faut le punir sévèrement, mais que l’usager est une victime, qu’ il faut le comprendre et le sauver. Donc, il faut le sevrer. L’abstinence devient une norme. Le problème, c’est que dans la réalité, les usagers et les trafiquants se mélangent. Les usagers-revendeurs sont légion. Faut-il les traiter comme des usagers ou comme des revendeurs ? C’est le problème posé par cette loi dès les premières années. Elle a dressé un tableau trop simpliste de la situation. Dans le temps long, circulaire après circulaire, l’habitude va être prise de traiter l’usager-revendeur comme un revendeur avant tout. Donc, de l’envoyer en prison. Cet équilibre entre le trafiquant et l’usager bien différencié, entre le soin et la répression, ne tient pas dans la réalité. L’habitude va être prise de privilégier plutôt la répression.
Même si la loi de 1970 est toujours en vigueur, n’y a-t-il pas eu dans la politique française des vagues plus répressives, et d’autres qui sont allées vers une approche plus sanitaire ?
Il y a des pics répressifs, et des moments où on déverrouille un peu, avec davantage de réduction des risques. Cela dépend aussi des ministres qui sont aux postes clés. En 1978, par exemple, Monique Pelletier, secrétaire d’État auprès du garde des Sceaux, incarne un peu l’esprit du centre-droit giscardien. Elle lance une commission qui ouvre un débat sur une éventuelle modification de la loi, et sur une possible dépénalisation du cannabis. Finalement, la loi restera intouchée. Mais Pelletier rédigera une circulaire pour dire de ne pas poursuivre les usagers de cannabis au-delà d’un simple rappel à la loi.
La loi de 1970 n’a jamais été changée. Mais la manière d’appliquer cette loi peut varier. En 1986, il y a un pic répressif parce que la droite arrive au pouvoir dans le cadre de la cohabitation, et Jacques Chirac avait fait de la drogue son cheval de bataille. Au milieu des années 1990 au contraire, il y a une généralisation de la politique de réduction des risques, avec la possibilité de prescrire la méthadone et le subutex, la reconnaissance des associations d’usagers, les programmes d’échange de seringues. C’est un véritable assouplissement. Mais la politique se durcit à nouveau dans les années 2000, notamment en 2007 avec l’arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy.
Vous disiez que dans la première loi française de régulation des drogues, de 1916, le cannabis avait été introduit parmi les substances prohibées alors que les conventions internationales ne le mentionnaient pas. Qu’en est-il dans la loi de 1970 ? Comment cette loi définit-elle les substances qui vont être considérées comme des drogues ?
Pour la loi de 1970, toutes les substances inscrites dans les conventions internationales sur les drogues sont interdites, quel que soit le type d’usage, ponctuel, de long terme, ou de dépendance. Et il n’y a pas de différence faite entre drogues douces et drogues dures. Au même moment aux Pays-Bas, on réfléchit également à durcir la loi. Mais la loi néerlandaise de 1976 fait la différence entre d’une côté les drogues douces, hallucinogènes et cannabis, et de l’autre les drogues dures. Elle dépénalise l’usage des premières et est plus sévère sur les secondes. Dans la loi française de 1970, tout est interdit.
Le cannabis reste un cas particulier, parce qu’il entre par la petite porte. On l’a dit, les toutes premières conventions sur les drogues, au début du 20e siècle, n’en parlent pas. En 1916 en France, on le met quand même dans la loi, alors qu’il n’y a pas du tout d’usage massif de cannabis à l’époque. Je pense qu’on l’a alors prohibé parce que les médecins y pensent à ce moment-là. Il y a déjà des travaux médicaux sur la clinique de l’intoxication au cannabis. Et il y avait une consommation de la part d’écrivains au 19e siècle en France.
De plus, le pays a des colonies en Afrique du Nord, où il y a une consommation traditionnelle de cannabis. Ce sont ensuite certains États des États-Unis qui vont criminaliser le cannabis, dans un but de contrôle des minorités hispaniques. Il y a alors beaucoup de Mexicains qui vivent dans le sud des États-Unis, qui sont venus après la Révolution mexicaine [1910-1920, ndlr]. Ils consomment traditionnellement de la marijuana. Plusieurs États l’interdisent ainsi dans les années 1920. Puis, dans les années 1930, l’interdiction devient fédérale. Ensuite, sous pression des États-Unis, le cannabis intègre les conventions internationales sur les drogues, mais par la bande. Il n’est pas, alors, perçu comme un problème prioritaire. Il le devient dans les années 1960, parce que dans ces nouveaux usages des jeunes qui inquiètent tant, le cannabis est assez largement consommé.
La différence faite entre médicaments et drogues est-elle mouvante ?
Très mouvant. Les grandes drogues, à l’origine, ont toujours été des médicaments. Freud prescrivait de la cocaïne à ses patients. En 1898, l’héroïne a été commercialisée par Bayer comme sirop contre la toux. On l’a vite retirée du marché, vu ses effets. De plus, les effets pharmacologiques de certains médicaments ne sont pas vraiment différents de ceux des drogues. Des médicaments sont ainsi devenus des drogues. Dans les années 1960 en France, énormément d’amphétamines étaient en vente libre, ou disponibles sur prescription médicale. C’étaient de véritables amphétamines qui créaient, surtout chez les jeunes, des dépendances. Il a fallu les interdire au début des années 1970. Souvent, des molécules sont mises sur le marché, commercialisées, puis on découvre qu’il y a des effets secondaires inattendus et qu’il en existe des usages détournés.
Dans les années 1960 se développe ainsi une consommation massive de Préludine, un anorexigène qui peut faire planer à hautes doses. Un usage toxicomaniaque se crée. Du coup on contrôle, on réduit à la prescription médicale, ou on interdit carrément. Le Corydrane, un mélange d’aspirine et d’amphétamine, était en vente libre dans les années 1960. Les étudiants en consommaient beaucoup pour accroître leurs performances durant les examens. Puis on l’a interdit. C’était devenu une drogue.
La frontière entre drogue et médicament est arbitraire, il n’y a pas de frontière pharmacologique. C’est la loi qui la définit, et elle se déplace selon les circonstances et les usages constatés. On voit aussi que les toxicomanes, parfois en manque de drogues obtenues sur le marché illégal, se tournent vers les pharmacies. Dans les années 1970, quand la French connection est officiellement démantelée, il y a une baisse de l’offre d’héroïne illicite. Les cambriolages de pharmacies explosent alors.
L’image du toxicomane, dans les débats médiatiques et politiques que vous avez étudiés, a-t-elle évolué depuis les années soixante-dix ?
À cette période, le toxicomane, du point de vue de ceux qui font voter la loi, c’est le hippie, les « cheveux longs », le beatnik, le contestataire. Ensuite, dans les années 1980, l’opinion publique commence à associer la drogues aux immigrés, puis apparaît l’image du toxicomane malade du sida. Plus récemment, l’image qui prédomine est celui du dealer issu des banlieues. Ce sont des clichés qui se construisent. Ils sont étayés par quelques faits, mais la réalité et la palette des situations toxicomanes sont beaucoup plus larges. Même lorsque l’on parlait du toxicomane « à cheveux longs » dans les années 1970, il y avait déjà tous les accros aux médicaments qui obtenaient de leurs médecins des prescriptions de complaisance : les toxicomanes mondains. Ils sont toujours là, et jamais pointés du doigt.
Vous décrivez les circuits de trafic, celui de la French connection, de la connexion chinoise, la Colombie, le Pakistan… Ils évoluent très vite. De l’autre côté, les usages aussi changent rapidement, avec la cocaïne qui revient dans les années 1980, le crack qui apparaît dans les années 1990, les vagues d’usage de l’héroïne. On a l’impression que par rapport à ces deux phénomènes, les autorités ont toujours un temps de retard…
C’est toujours le chat qui court après la souris. Les usages sont pluriels, avec une multiplicité de trajectoires individuelles. L’offre aussi évolue à une vitesse considérable. Et la répression active le marché clandestin, elle le dynamise. Les économies liées au trafic sont toujours très décentralisées. Ce sont des réseaux plus que des entreprises pyramidales. Donc, quand la répression tape quelque part, elle coupe quelques têtes, met derrière les barreaux quelques trafiquants, mais le reste du réseau se dilate. C’est comme un ballon : quand on tape dedans, il se déplace ailleurs. C’est ce que l’on voit à la fin des années 1970.
La French connection était un équilibre entre plusieurs groupes criminels : des Français, des Italiens, des Libanais. La répression accrue du début des années 1970 fait éclater cet équilibre entre plusieurs cellules trafiquantes. Elle détruit quelques cellules, mais les autres se sont installées ailleurs, tout simplement. Quelques chimistes et commanditaires marseillais ont été arrêtés. D’autres sont partis à Naples, en Asie, en Amérique latine, pour rejoindre les cartels naissants de la cocaïne. Et l’activité s’est poursuivie.
Vous parlez de la persistance en France, jusqu’à aujourd’hui, d’un « consensus médico-répressif ». C’est-à-dire ?
La loi de 1970 est toujours là. On parle souvent de la remettre en question, mais ce n’est jamais le cas. Cette loi, si elle ne rend pas totalement impossible une approche en termes de réduction des risques, met tout de même de sérieux bâtons dans les roues d’une politique de soin efficace, qui accepte qu’il y ait des drogues dans la société, que l’on ne peut pas faire autrement et qu’il faut limiter la casse. La réduction des risques a entraîné une baisse du nombre d’overdoses, une baisse des contaminations par le sida, une stabilisation sociale de plein d’usagers. Or, ce n’est qu’en 2004 que le terme de réduction des risques a été intégré dans une loi de santé publique. La loi de 1970 interdit tout type de drogue, tout type d’usage, interdit toute incitation. Or, la réduction des risques, c’est accompagner l’usager dans sa démarche. C’est donc une forme d’incitation.
C’est pour cela que la salle de consommation à moindre risque [ou « salle de shoot »] de l’hôpital Lariboisière a eu beaucoup de mal à légitimer son projet. Quand elle a été créée, elle est restée bloquée pendant trois ans, parce que le Conseil d’État a dit que l’existence de cette salle était en contradiction avec la loi de 1970. Il a fallu trouver des subterfuges, passer par des textes législatifs périphériques pour que tout de même, la salle puisse ouvrir. Mais c’est toujours à titre expérimental. Le tournant de la réduction des risques n’est donc pas totalement assumé. Il conserve un aspect semi-expérimental parce qu’on est toujours en train d’essayer de le faire à la marge de ce pilier prohibitionniste qu’est la loi de 1970.
Quelles sont les lois et les politiques menées ailleurs ?
Il n’y a pas vraiment de pays qui légalisent. Si ce n’est le Canada, quelques États des États-Unis, l’Uruguay – et uniquement pour le cannabis. Il y a toujours une norme prohibitionniste dominante qui empêche la politique de réduction des risques de progresser. Ailleurs, il y a peu cependant moins de tabous qu’en France. Aux Pays-Bas, les associations d’usagers ont été associées dès le départ à la politique de santé publique sur les drogues. Les Portugais ont dépénalisé toutes les drogues [2]. Certains avancent que la dépénalisation est un bon dispositif pour soulager les usagers. Mais cela ne règle qu’une moitié du problème : le trafic, lui, est toujours criminalisé. L’autre possibilité est donc la légalisation. La prohibition ne marche pas, la dépénalisation est une demi-solution. La légalisation peut régler des problèmes. Mais elle en créera aussi d’autres. Attention, donc, de ne pas y voir une solution miracle.
Le titre de votre ouvrage est L’impossible prohibition. La légalisation aussi est-elle impossible ?
Il faudra juger à partir de l’expérience d’États qui ont fait le saut de la légalisation du cannabis. Jusqu’ici, en France, la politique des drogues se fait dans l’idéologie. Jugeons plutôt sur l’expérience. Ce que l’on voit au Colorado et dans l’État de Washington [au Colorado et dans l’État de Washington, le commerce et la l’usage de cannabis sont légaux depuis 2014, ndlr], par exemple, n’est qu’une demi-réussite, en tous cas si l’objectif était d’en finir avec le marché clandestin. Car ce marché y existe toujours, parce que le cannabis y est moins cher. Donc, les populations les plus fragiles sont toujours dans la rue, avec les dealers, pour acheter du cannabis et d’autres substances. Les toxicomanes pauvres ne vont pas dans les boutiques légales.
Propos recueillis par Rachel Knaebel
Photo : plant de cannabis / CC David Marco Busto
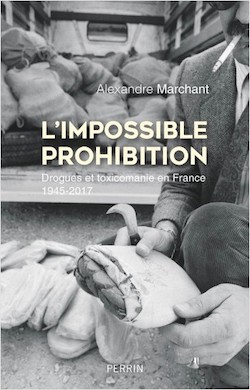
L’Impossible prohibition. Drogues et toxicomanie en France 1945-2017, Alexandre Marchant, Éditions Perrin, 2018.
Lire aussi : La Catastrophe invisible. Histoire sociale de l’héroïne (France, années 1950-2000), Michel Kokoreff, Anne Coppel, Michel Peraldi (dir.), Éditions Amsterdam, 2018.








