Ce texte est extrait de l’ouvrage Les néo-paysans, Éditions Seuil-Reporterre.
Sur les crêtes rocailleuses des montagnes ardéchoises, au détour d’une route capricieuse qui fait tanguer la voiture, une grappe de maisons en pierres grises s’accroche à la pente. Des cheminées fument et emplissent les narines d’une épaisse odeur de feu de bois. Nous voilà arrivés à Blaizac (Ardèche). Le village, qui compte une dizaine d’âmes, sort à peine du froid de l’hiver, ses habitants se dégourdissent d’un mois sous la neige où une enveloppe délicate les avait momentanément extraits du monde.
Nono est accoudé à la fontaine municipale. Son regard domine une vallée peuplée de châtaigniers et de genêts, il plisse un œil derrière ses lunettes rectangulaires. C’est que le soleil pique, à Blaizac. À côté, l’eau coule dans le lavoir. « Ah, ma foi, si ce n’est pas beau ici ! », s’exclame l’homme de 85 ans, la mine joyeuse. Des rides creusent son visage. Quand il prend la parole, une digue se rompt, un flot s’échappe de ses lèvres. « Le retour à la terre, c’est un refrain qui a traversé les âges. Votre histoire de néo-paysans, moi je vous le dis, ce n’est pas nouveau ! »
« Peut-être que je parle comme un Parisien, mais j’ai l’âme paysanne. »
Nono s’est installé dans les années soixante. « Je revenais de vacances à la mer avec ma femme et je ne suis jamais reparti », dit-il. À l’époque, le couple se cognait les ailes au quatrième étage de leur appartement parisien. Lui était peintre en bâtiment, elle comptable, ils rêvaient ensemble de quitter cette « vie de fou » à la ville. « Il fallait toujours aller plus vite, on se marchait dessus dans le métro, tu ne pouvais pas descendre de l’immeuble sans ton porte-monnaie. »
Quand les deux citadins débarquent, leur bateau de plaisance tiré par la voiture, les montagnards rigolent, « Eh l’étranger, la rivière, elle est en bas ! » La cabine leur servira d’abri, le temps de retaper une ruine achetée 5 000 francs où il pleuvait « dedans comme dehors ». « On voulait simplement vivre dans la nature, raconte Nono, on a vite compris que l’agriculture était le meilleur moyen pour subsister ici. » Il compte sur ses doigts : « On a commencé par le mouton, le chinchilla, le lapin puis le bœuf aux hormones... On a tout essayé avant de se lancer dans la chèvre. »
Il porte son regard dans le vague, comme pour délier un passé enfoui. « Ah ça franchement, on n’a pas été aidés ! » Dès qu’il avait le dos tourné, les gens du village dispersaient son troupeau sur les sommets, comme la bourrasque les feuilles d’automne. « Quand je passais dans le hameau, le rideau de la voisine se fermait. Au battage des céréales, je mangeais seul et les autres fêtaient ensemble. » Le vieil homme se lève péniblement avec sa canne et nous invite chez lui dans la pénombre de sa maison. Il est 11 heures, il nous sert le canon. « Tu vois, les gens d’ici ont toujours refusé d’entrer chez moi boire un coup. Même le jour du mariage de mon fils avec la fille des voisins. » Une larme perce l’homme endurci. Il la réprime. Un silence passe. « Peut-être que je parle comme un Parisien, mais j’ai l’âme paysanne. »
« A défaut d’avoir changé le monde, on a au moins pris en main notre existence »
Nono est maintenant à la retraite. Il a cédé sa chèvrerie à d’autres « bourdigas », les « mauvaises herbes » en patois local, un terme qui désigne les hommes et femmes venus d’ailleurs. En Ardèche, ils ont pris racine. Aujourd’hui, 70% de ceux qui deviennent paysans dans le département ne sont pas issus du milieu agricole. Nono se sent pionnier. « J’ai ouvert les portes de Blaizac », dit-il sans manières.
Au bord du village, à la lisière de la broussaille, Monique et Jo habitent une grande maison en bois qu’ils ont construite eux-mêmes lorsqu’ils ont repris la ferme de Nono dans les années 1990. Comme lui, ils ont acquis le savoir-faire à la force du poignet, leur sueur s’est mêlée à la sève de Blaizac avant qu’ils ne transmettent à leur tour la chèvrerie, vingt ans plus tard. Deux autres néo-ruraux, Émeline et Valère, ont alors pris la relève. C’était en 2012. Ici, la terre change de mains, les générations passent, mais le rêve s’accroche, il donne à la chair de ces alpages une couleur vive et claire.
Monique ne connaissait rien aux chèvres lorsqu’elle est arrivée. Elle était coiffeuse, étouffait dans une famille qui ne la comprenait pas, et cachait « au fond du ventre une folle envie de vivre pleinement ». À l’entendre, le paysage est un ensorcellement « avec ses reliefs, ses pierres, avec le soleil et le vent qui entrent dans les corps et les cœurs ». Devenue chevrière sur le tas, elle a gardé le troupeau de Nono et continué de vendre les fromages au mont Gerbier, le site touristique des sources de la Loire, situé à une trentaine de kilomètres. « Notre idéal, avec nos trente chèvres, ce n’était pas de gagner des sous mais d’en dépenser le moins possible », dit-elle avec le recul, alors qu’elle approche ses soixante-cinq ans. Dans son salon aux larges baies vitrées donnant sur une forêt abrupte qui flirte avec le vide, elle lâche un soupir et retrace le destin d’une génération marquée par le cri libertaire de mai 68. « Tu sais, à défaut d’avoir changé le monde, on a au moins pris en main notre existence. »
La venue de jeunes saluée, dans des campagnes qui se vident
Jo est moins bavard que sa femme. Cet ancien artisan du cuir, qui vendait ses cartables dans les foires, a la carrure du paysan, son côté taiseux. Lui et Monique ont été bien accueillis au village contrairement à Nono. Jo est même devenu maire de la commune au tournant des années 2000. Leur successeur à la ferme, Valère, a été élu président du comité des fêtes, une association qui réunit les habitants des hauteurs. Autour du cochon à la broche, le premier repas qu’il organise, « des personnes qui ne s’étaient pas croisées depuis dix ans, se sont retrouvées », nous dira-t-il avec fierté.
C’est que le village a bien changé depuis l’arrivée de Nono, il y a cinquante ans. La communauté rurale auquel il s’était confronté s’est peu à peu disloquée, laissant place à des relations de voisinage plus éclatées. On pestait hier contre l’étranger, on salue à présent la venue des jeunes dans une population vieillissante. Seuls quatre Ardéchois se cramponnent encore à leur origine parmi les seize habitants, les autres sont descendus à la ville, prenant un aller simple de la ferme à l’usine.
Blaizac s’est progressivement transformé en villégiature. L’été l’abreuve de vacanciers fuyant le brouhaha des centres urbains, les granges rénovées deviennent des gîtes d’étape tandis que l’hiver la moitié des maisons demeure volets clos. Près de chez Monique et Jo, un couple de Lyonnais a fait construire sa résidence secondaire : un pavillon en crépi blanc, bordé d’une haie de thuyas, avec vidéo-surveillance et piscine, on se croirait sur la côte d’azur.
La campagne abandonnée par les cultivateurs s’enfriche, les pâtures se couvrent de genêts et si les arbres donnent, les châtaignes pourrissent au sol faute de ramasseurs. À peine dix tonnes sont récoltées chaque année dans les bois aux alentours, 80 fois moins qu’un siècle plus tôt ! Émeline et Valère sont les derniers éleveurs du village. En ce mois de mars, leurs filles, Margot, 7 ans, et Olivia, 6 ans, détalent entre les ruelles à grands éclats de voix, elles sont les seules enfants de Blaizac.
Tout à apprendre
C’est au-dessus des maisons, à 730 mètres d’altitude, que l’on trouve la chèvrerie perdue dans les bourrelets de la montagne. Quand on y parvient ce jour-là, une bête est au centre de toutes les attentions. Une flaque de sang et de liquide amniotique vient de se déverser sur la paille, la chèvre perd les eaux et bêle à n’en plus finir. Accroupi, Valère passe une main sur son flanc secoué par les contractions. Quelques minutes passent, il se tourmente : « Tu crois qu’il est mal placé le petit ? » « Y a qu’une seule façon de vérifier », réplique Émeline qui se retrousse les manches. D’un geste ferme et dans un flot de jurons, elle plonge ses doigts dans le corps de l’animal, attrape puis tire les pattes du chevreau, qui s’étale par terre encore tout gluant du ventre de sa mère. Le petit gagne son premier bol d’air dans le jour de midi qui baigne la chèvrerie de lumière.
Émeline souffle un coup et s’assied sur un tabouret au milieu de ses biquettes. « C’est notre quatrième mise bas qui commence, quatre ans en agriculture, c’est peu. On a tout à apprendre. » La jeune trentenaire a le caractère bien trempé, les pommettes rouges et les yeux en amande, presque bridés. Il y a quelques années, elle alternait boulots alimentaires et périodes de chômage. Parmi les multiples va-et-vient entre pôle emploi et « les putains de contrats à la con », elle se souvient d’un passage éphémère dans un jardin d’insertion sociale où elle prend goût à la terre. Un petit frisson dans un univers de béton. Ce n’était pas acquis d’avance. « On habitait avec Valère et notre premier enfant dans un HLM à Voiron près de Grenoble. On était complètement déconnectés », dit-elle avec franchise. « Sûr qu’on n’y connaissait rien à l’agriculture, on ne se préoccupait pas de la malbouffe ! »
C’est au bord de la crise qu’ils prennent un virage serré. « Avec Valère, on explosait, on s’engueulait pour rien. Si ça n’évoluait pas, on était bons pour se séparer. » Ils se projettent alors dans une ferme, Émeline se lance dans un brevet professionnel et ils font route ensemble vers l’Ardèche. Sans aucun regret. Ils ont 35 et 41 ans, la vie devant eux.
« Être chevrier, plus qu’un boulot, c’est une présence, une attention permanente »
Ils louaient un appartement. Arrivés sur place, ils s’installent dans une maison de 3 000 m2 sans cloisons, aux conditions bien plus spartiates. Une yourte leur sert de chambre à coucher et, quand la nuit tombe, c’est toute la famille, avec les deux filles, qui s’y glisse. Cinquante mètres plus loin, une caravane est utilisée comme bureau, au milieu d’un amas de tôles, de parpaings et de bric à brac. En guise de salle de bain, ils construisent une cabane de jardin dont la vitre donne directement sur les étoiles. Si par malheur le vent du nord se lève, on ne dort pas, on s’accroche aux parois de la yourte pour éviter qu’elle ne s’envole. L’hiver, on vit sur un récif. Sauf qu’ici la mer, ce sont les châtaigniers qui secouent les branches comme la houle.
À l’entrée de la chèvrerie, Valère contemple cette nouvelle vie en suivant de loin la quarantaine de bêtes qui parcourt les sommets pour la première fois de l’année. Quelques nuages narguent les cimes, la neige éparse étincelle et brûle sous le soleil. Là-haut, Ganache broute sans lever la tête, Chacal, la doyenne du troupeau, affronte Jalouse la dominante aux cornes arquées. Valère les connaît toutes par leur nom. « Tu vois, c’est ça que je suis venu chercher ici, l’élevage c’est un lien qui libère. » Le grand brun a la tchatche facile, et le sourire dans une bouille de gamin. « Moi, je n’ai pas l’impression de travailler. Être chevrier, plus qu’un boulot, c’est une présence, une attention permanente. » Il soigne son troupeau lui-même, par l’homéopathie et à base de plantes médicinales.
Un avenir incertain
Avec les mises-bas, la traite va bientôt recommencer, et avec elle la vente de fromages, mais elle risque de prendre cette année une tournure particulière. L’administration française leur a retiré les aides PAC (politique agricole commune), soit 8 000 euros de subvention annuelle, une perte équivalente à 30 % de leur chiffre d’affaires. Le couple le dit avec inquiétude, « l’avenir de notre ferme est en danger. » Valère explique : « On a refusé de pucer électroniquement notre troupeau, on en paye aujourd’hui les conséquences. »
La puce RFID (Radio frequency identification) est obligatoire sur chaque animal depuis 2013, « elle émet par radiofréquence des données transmises directement à l’ordinateur : date de naissance, géniteur, vaccinations… » Pensée à l’origine pour améliorer la traçabilité, elle provoque la consternation de l’éleveur. « Je ne veux pas gérer mon troupeau derrière un écran. Mes bêtes, je les reconnais du bout du champ, je sais de quelle lignée elles sont issues et quel est leur état de santé.… Cette norme a été créée pour l’élevage industriel. » Valère tire le tabac de son jean pour se rouler une cigarette. Ses nerfs se tendent : « Les chevaux ont été les premiers à avoir des puces électroniques, ça ne les a pas empêché de terminer en lasagnes ! »
Sa colère est nourrie par son histoire personnelle. Une enfance passée à côtoyer le bitume et les cours d’immeuble dans les quartiers difficiles, l’arrêt de l’école à 14 ans puis l’usine comme seul horizon. « Je sais ce que ça veut dire les 3-8, le vide de sens, le standardisé… J’ai quitté l’usine parce que j’en avais assez de pointer, de me faire fliquer. Ce n’est pas pour pucer mes animaux aujourd’hui. » Des volutes de fumée s’échappent vers le ciel, Valère consume sa cigarette avidement. Derrière lui, dans la paille, le chevreau tout juste né s’essaye à une marche un peu brouillonne. Comme pour empêcher le silence de parler à leur place, Émeline poursuit : « Mais où est ce que l’on va ? Électroniser nos chèvres, ne plus les faire sortir, les écorner, leur donner de l’ensilage ? Quel intérêt ? martèle l’éleveuse. On n’a pas choisi ce métier pour devenir des techniciens ! Avec une gestion électronique, on perd la communication qui existe avec les animaux, on perd le plaisir de travailler avec le vivant. »
« Devenir paysan, c’est entrer en résistance »
Le couple a rejoint récemment le bureau de la Confédération paysanne, un syndicat agricole fortement mobilisé contre les dérives de l’agro-industrie. À l’assemblée générale, Émeline se présente comme une « chevrière en colère », heureuse « d’arrêter de ruminer toute seule et de donner à sa lutte une dimension collective ». Les agriculteurs du mouvement bloquent la préfecture, envoient des pétitions, se relient aux militants du massif alpin. « Quand on est seul, on souffre car on est toujours ramené à son anormalité. Être anormal à plusieurs, ce n’est plus seulement de l’anormalité, c’est un acte politique, ça change le rapport de force. »
Dans ces montagnes ardéchoises, le paradoxe culmine : alors que les deux néo-paysans accompagnent leurs chèvres dans les prairies attaquées par les ronces, abandonnées par les hommes, leur élevage est plus que jamais contrôlé et soumis au diktat de normes industrielles qui détruisent l’essence de leur profession. « À l’époque de Nono, on pouvait s’installer à l’arrache, se débrouiller dans son coin, un peu comme le déserteur chanté par Renaud : “On a une vieille bicoque / on la retape tranquillement / on fait pousser des chèvres...” Aujourd’hui c’est impossible, devenir paysan, c’est entrer en résistance. »
Texte : Lucile Leclair et Gaspard d’Allens
Aquarelle : Dominique, qui a accompagné une partie du périple de Lucile et Gaspard (voir ici)
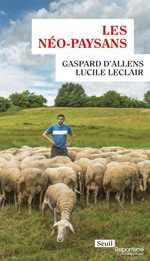
Les néo-paysans, écrit par Gaspard d’Allens et Lucile Leclair, ed. Seuil-Reporterre, février 2016, 144p, 12 euros.
En savoir plus sur les néo-paysans sur le site Reporterre.








