basta! : En lisant votre ouvrage Inutilité publique, on peut arriver à la conclusion que les enquêtes d’utilité publique, conduites pour tout « grand projet » d’infrastructure et d’aménagement, ne servent à rien puisque les projets se font de toute façon. Les enquêtes d’utilité publique ne seraient-elles que des farces ?

Frédéric Graber : C’est plutôt un rituel. Les enquêtes d’utilité publique ont une fonction politique importante dans notre société : elles sont là pour dire que quelque chose est juste, même quand c’est en fait très problématique. C’est une manière de solder un débat qui n’a pas vraiment lieu. Pour chaque projet d’infrastructure, il va y avoir des gagnants et des perdants. D’une certaine manière, il faut justifier que, même s’il y a des perdants, au moins c’est juste. C’est à cela que sert l’utilité publique. Ce sens de l’utilité publique vient de l’Ancien Régime, où les projets se faisaient selon des privilèges, c’est-à-dire des droits que certains ont et d’autres pas.
On peut avoir l’impression que c’est grotesque, mais je ne crois pas que ça soit le cas. Nous vivons avec beaucoup de fictions politiques, c’est assez normal. Ensuite, c’est une question de degré. Est-ce que cette fiction tient un peu, beaucoup, pas du tout ? Je crois que dans le cas de l’utilité publique, elle a tenu très longtemps, mais dans le contexte de crise environnementale actuelle, elle ne tient plus du tout.
Vous dressez une continuité entre ce type d’enquêtes telle qu’elles pouvaient avoir lieu sous l’Ancien Régime et la situation actuelle. À partir de quand est apparue cette « fiction politique » selon laquelle l’enquête d’utilité publique est un lieu de débat ?
La question du débat va se régler dans les années 1820, après la chute du régime napoléonien. Il y a deux moments de restructuration de l’enquête publique avant ce moment-là. Le premier est lié à la Révolution française. Après la Révolution, on ne peut plus justifier les projets par des privilèges car, en théorie, on a une égalité civile, on ne peut donc pas continuer à accorder des droits plus grands à certains qu’à d’autres. On est alors au décollage de la révolution industrielle, avec le démarrage de grands projets d’infrastructure et d’industrie. La période napoléonienne est ainsi un moment de développement de l’industrie chimique en France. Il y a alors le besoin d’imposer ce genre de projets, contre ceux qui vont en supporter les conséquences négatives.
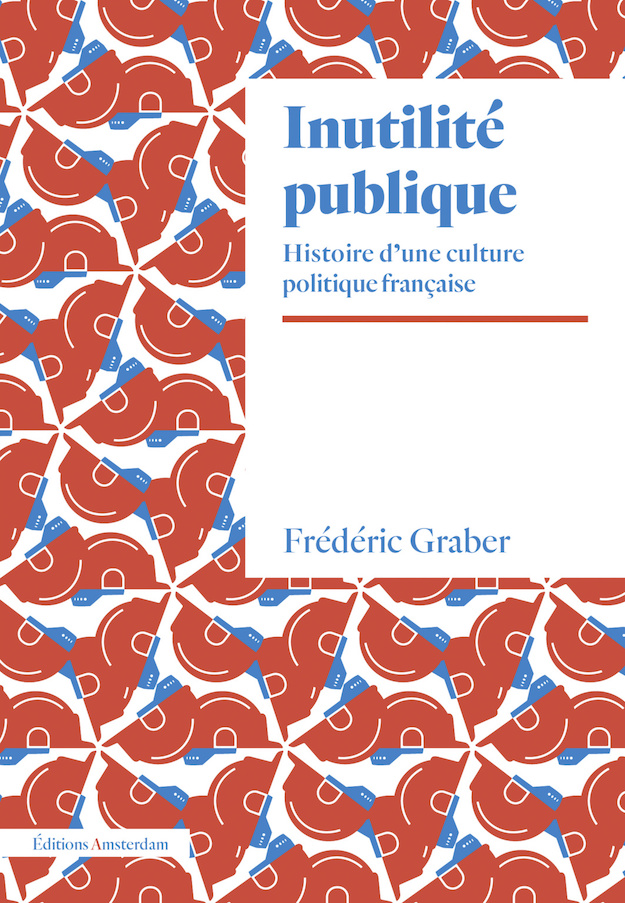
Donc, on crée un dispositif qui reprend énormément de traits à celui de l’Ancien Régime, notamment la notion d’utilité publique tout en la déclinant d’une nouvelle manière. Sous l’Ancien Régime, on réunissait quelques témoins consentants qui disaient que tout allait bien. Au 19e siècle, il faut mettre en scène l’égalité. On invente alors l’enquête publique qui est l’appel à tous : tout le monde peut en principe venir s’exprimer sur le projet. C’est quelque chose d’assez radical qui met en scène l’égalité.
Que fait-on ensuite de ces observations, c’est la question. Sous la période napoléonienne, grande productrice de ce genre d’enquêtes publiques, on n’en fait pas grand-chose. On referme le registre dans lequel les gens se sont exprimés et on réalise le projet en disant qu’on a tout entendu, qu’on a un point de vue surplombant sur la question et que malgré toutes les objections, le projet va dans le sens de l’intérêt supérieur.
Après la chute du régime napoléonien, ce comportement d’une administration qui décide sans contestation possible est assimilé à un comportement dictatorial. En plus, à partir des années 1820, il y a des scandales dans les travaux publics qui remettent cette procédure en question. Les acteurs politiques libéraux les instrumentalisent pour dire : « Vous voyez bien que l’administration fait des erreurs, qu’elle décide de projets qui posent des problèmes de long terme ».
Donc, on accepte qu’il faille discuter de ces projets pour les mettre à l’épreuve, mettre à l’épreuve l’administration, les porteurs de projets et les parlementaires, qui peuvent eux aussi œuvrer dans leur propre intérêt plutôt que dans l’intérêt général. Dans ce but, il faut une enquête et un débat qui confronte les arguments, de sorte que la décision soit bien formée et qu’on n’ait plus de soupçon de favoritisme envers certains intérêts plutôt que le bien commun.
À la fin des années 1820, des débats vont amener à des réformes de l’enquête publique qui introduisent les commissions d’enquête et la figure de l’enquêteur, qui a le rôle de mettre en scène le débat. On arrive toutefois rapidement à la construction d’une nouvelle fiction. On met en scène un débat qui n’a aucun impact sur les projets.
La contestation des grands projets comme on la connaît en France, des mégabassines, de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, n’est pas nouvelle, soulignez-vous. N’a-t-elle jamais pu se faire dans le cadre de l’enquête d’utilité publique ?
De l’Ancien Régime jusqu’au 20e siècle, vous avez toujours des contestations des projets d’infrastructures. L’enquête publique a largement permis d’invisibiliser cette contestation, car elle permet de dire qu’on a tout bien fait, tout bien discuté, que tout a été fait dans les règles, qu’on a entendu tous les points de vues, mais qu’à la fin, on a réussi à établir cette utilité publique, que c’est donc dans l’intérêt de tous. Cette fiction ne marche plus du tout aujourd’hui, parce que le caractère inégalitaire des projets est plus visible. On voit bien qu’ils se font pour la défense de certains intérêts contre d’autres, et que ce déséquilibre n’est pas remis en discussion. La crise environnementale rend cet aspect inégalitaire des projets beaucoup plus frappant et inacceptable qu’il ne l’était auparavant.
En quoi la crise environnementale rend-elle cette inégalité plus visible ? Les enjeux des grands projets sont-ils différents aujourd’hui, dans le cadre de la crise climatique, que l’enjeu des grands projets industriels ou d’aménagement des 19e et 20e siècles ?
Je ne pense pas que les enjeux soient si différents. Quand vous regardez comment on fait des projets, la plupart vont servir un certain type d’acteurs ; en France, des entreprises de travaux publics, ou les investisseurs lorsque que ce sont par exemple des projets d’éoliennes. Il y a des gens qui vont profiter directement de ces projets. Ce profit se fait parce que des personnes vont soit être expropriées, soit subir des nuisances. À un autre niveau, le profit se fait par la destruction de l’espace, d’espèces, par la réduction de surfaces disponibles des habitats et éventuellement par des pollutions. Ces différentes formes de dégâts sont généralement tout à fait articulées les unes aux autres. C’est en même temps qu’on détruit l’environnement et que l’on fait perdre certains acteurs.
Par exemple, dans le cas des projets d’éoliennes aujourd’hui, vous avez souvent une série d’oppositions liées, au niveau local, principalement à des questions de propriété. Dans une commune, il y a ceux qui vont profiter de l’installation des éoliennes, généralement les propriétaires du sol, qui n’habitent pas nécessairement dans l’endroit, et des gens qui vont vivre avec ces objets et ne vont pratiquement rien en recevoir comme profit. Ces objets sont présentés comme des objets du futur et comme des objets environnementaux.
On voit bien ici comment on définit les enjeux environnementaux aujourd’hui dans les mêmes termes que l’industrialisation au 19e siècle. On dit qu’il faut faire ces projets, à n’importe quel prix, qu’il faut laisser les investisseurs investir, qu’il ne faut pas rediscuter les enjeux de propriété, qui sont en fait au cœur des inégalités territoriales qu’on est en train de créer. Ces projets se font de manière presque extractive, le capital arrive dans un endroit, va en tirer tout le profit, et le local n’en aura aucun, sauf quelques emplois parfois.
Il y a une inégalité dans la répartition des gagnants et des perdants sur laquelle aucun débat n’a lieu. C’est ce qui fait, selon moi, que ces projets d’éoliennes sont aussi choquants pour les populations. Ils se font au nom de quelque chose qu’une part importante de la population aurait envie de faire, à savoir se lancer dans la transition énergétique, changer de direction au niveau des énergies fossiles, mais c’est réalisé selon un modèle de développement qui est exactement le même qu’au 19e siècle.
Comment expliquez-vous alors qu’il n’y a pas plus d’appels à supprimer ce dispositif de l’enquête d’utilité publique qui est manifestement inopérant ? Quand il est envisagé de le supprimer, même des ONG comme Greenpeace s’y opposent...
L’enquête publique n’est pas le cœur du problème. Par ailleurs, je pense qu’elle pourrait fonctionner si vous aviez des commissaires enquêteurs formés différemment, d’autres administrations, d’autres faiseurs de projets et d’autres décideurs, avec des valeurs qui ne considèreraient plus le développement économique comme la seule valeur absolue et qui prendraient en compte les conséquences sociales et environnementales. Ces conséquences ne sont à aucun moment sérieusement prises en compte. Les enquêtes sont là pour, pratiquement toujours, conclure à un avis favorable. Ce n’est pas forcément l’institution même de l’enquête qui est responsable de cela. C’est plutôt l’idéologie dominante en faveur du développement économique qui a été définie il y a deux siècles.
On fonctionne avec un logiciel très vieux qui dit que tous les projets sont bons, qu’il faut tous les faire parce qu’ils vont profiter à la société, sans s’occuper sérieusement de savoir à qui ils profitent et si on en a vraiment besoin. Tout est fait encore aujourd’hui pour qu’on n’en discute pas. Alors, si on supprime l’enquête publique, on en discutera encore moins. Les derniers gouvernements tentent depuis 2009, par petits bouts, de réduire l’enquête publique pour diminuer encore l’espace de discussion et en l’occurrence le rôle des commissaires enquêteurs.
Manque-t-on d’autres véritables espaces de débat pour discuter de ces projets, et peut-être plus largement de la politique énergétique et d’aménagement française ?
C’est un problème de concevoir l’aménagement par projets, par petits bouts, en se disant que chaque projet est isolé. Qu’ils soient conçus au niveau local, c’est une bonne chose, mais qu’on les conçoive comme des isolats, c’est un problème, car ces projets ont des effets cumulés. Quand on construit un rond-point, cela s’inscrit dans une démarche dans laquelle on construit une multitude de ronds-points qui s’ajoutent à des autoroutes, des voies de chemin de fer, des contournements. Tout cela a des effets cumulés extraordinaires en matière d’artificialisation des sols. Les projets, isolément, ont l’air de faire sens économiquement, mais ils posent des questions globales. Cela légitime que des citoyens puissent se sentir concernés par des projets qui ne sont pas forcément près de chez eux, mais qui sont en train de transformer le territoire à l’échelle nationale.
Ceci dit, il existe des espaces de discussion. Pour les très grands projets, on a depuis les années 1990 la Commission nationale du débat public, qui organise de véritables débats. Il y a des gens des deux points de vue représentés, et le public peut poser des questions. Mais ces espaces de débats sont déconnectés de la prise de décision. Il n’y a aucune obligation de prendre en compte ce qui a été débattu, même si autorités publiques, quand elles prennent leur décision, affirment avoir pris en compte les objections.
L’autorité publique se présente comme quelqu’un qui voit les choses de tout en haut. C’est un héritage monarchique. Cette notion de dire le juste par en haut est liée à la position du monarque surplombant la société et qui a, comme on disait dans l’Ancien Régime, « une parfaite connaissance des choses ». Il sait tout. L’autorité publique se présente comme omnisciente.
Nous avons besoin de dispositifs comme l’enquête publique, mais qui rendent possible d’interdire les projets. Une fois que l’autorisation ne sera plus automatique, une fois que vous aurez un dispositif qui peut aboutir à une interdiction, vous aurez beaucoup plus de bonne volonté de la part de tous les acteurs pour discuter, pour faire des compromis, éventuellement même pour comprendre qu’un projet n’a aucune chance de passer. Il y a derrière les outils participatifs actuels une faiblesse fondamentale qui est l’articulation à la décision. C’est une faiblesse structurelle, en particulier en France. On l’a vu encore avec la Convention citoyenne sur le climat, qui avait fait un certain nombre de suggestions. Le gouvernement avait bien dit qu’il les mettrait en application, mais à la fin, il n’a pris que ce qu’il a voulu.
Est-ce que vous liez cette faiblesse structurelle à la multiplication de mouvements de contestations de projets en France, comme récemment sur les mégabassines ?
L’absence de tout espace de débat peut créer non seulement une frustration, mais aussi une forme de désespoir qui peut amener à ne plus accepter la limitation du cadre légal. Si vous contestez un projet et que vous faites les choses dans un cadre légal, vous devez savoir que vous n’obtiendrez rien ou pas grand-chose, et que vos arguments ne porteront pas. Les mouvements comme les Zad (« zone à défendre ») ou d’autres mouvements sociaux autour des projets apparus dans les dernières décennies témoignent aussi de l’intensification de l’inquiétude autour des crises environnementales et du changement climatique en particulier. On vit dans une urgence, des choses devraient changer. Mais on continue comme avant, rien ne change, et on ne peut pas accepter ça.
Recueilli par Rachel Knaebel
Photo : À Aubervilliers en 2021/©Anne Paq.








