« Nous n’avons jamais eu d’exercice d’évacuation, ni jamais entendu une sirène. Nous savions qu’il y a avait un barrage, mais jamais on ne nous a dit qu’il y avait un risque. Quand c’est arrivé, l’alarme, ça a été le bruit, le bruit de l’eau qui arrivait. Alors, nous nous sommes mis à courir en criant pour avertir les autres. » Dans son village de Bento Rodriguez, dans l’état brésilien du Minas Gerais, José de Nascimento, 72 ans, avait des poules, des vaches, produisait du lait, des œufs, du fromage. Tout cela a disparu dans la coulée de boue contaminée par les rejets miniers qui a déferlé sur sa communauté le 5 novembre 2015 (lire notre article : Tragédie écologique et boues toxiques au Brésil : pourquoi les autorités ont tardé à réagir).
Ce jour-là, le barrage du Fundão s’est rompu. C’était l’un des trois barrages que l’entreprise minière Samarco a sur cette zone où elle extrait du fer. Des dizaines de millions de mètres cubes de boues toxiques ont alors envahi le village de José, huit kilomètres plus loin. Bento Rodriguez est entièrement détruit. 19 personnes meurent dans la catastrophe, dont 13 travailleurs de l’entreprise Samarco. Deux autres villages, Paracatu de Baixo et Gesteira, sont aussi en grande partie dévastés. Puis, les rejets miniers ont pollué le fleuve Rio Doce sur plus de 600 kilomètres, tuant des tonnes de poissons, avant d’arriver à l’océan, le 21 novembre 2015. Le fleuve est durablement pollué par les métaux lourds. La pêche y est encore en partie impossible. Au moins 250 000 personnes ont été affectées par des pénuries d’eau dues à la catastrophe, selon les données même de l’entreprise.
« Nous avons totalement perdu notre mode de vie »
« Nous avons vu la boue, et nous avons couru. S’il y avait eu une sirène, au moins, personne ne serait mort. Nous aurions pu sauver nos documents », regrette Keila, productrice de gelée de piment au sein d’une coopérative de 11 personnes. Leurs plantations ont disparu sous la boue. Son association, essentiellement des femmes, continue pour l’instant la production avec les réserves de piments séchés qui subsistent. « Nous ne savions pas que le barrage représentait un tel danger ; nous ne pouvions même pas le voir. Mais nous avions des réunions régulières avec les responsables de Samarco, et ils disaient qu’il n’y avait pas de risque, que c’était surveillé 24 heures sur 24… Nous les croyions. »
José et Keila habitent aujourd’hui de petits appartements du centre de Mariana, une ville de 60 000 habitants, où tous les sinistrés des villages frappés ont été relogés. Mariana est l’une des cités « historiques » du Brésil colonial, comme Ouro Preto, toute proche : elle est née il y a trois siècles, a grandi avec l’activité minière, et abrite un patrimoine laissé par les Portugais – églises, prison, collèges religieux, et même un train touristique. Keila y partage trois pièces avec son mari, ses deux enfants et sa grand-mère. Dans son village, elle avait une maison de quatre chambres, une salle, une cuisine, une petite piscine, une cour avec des manguiers, des orangers, des mandariniers, des arbres à goyaves…
Keila reçoit dans un petit salon meublé de deux canapés et d’une télévision. « Ici, ce n’est pas une grande ville, mais pour nous qui vivions dans un village, c’est très différent, dit-elle. J’ai toujours vécu à Bento, depuis ma naissance. » « Nous avons totalement perdu notre mode vie. Du lever au coucher, tout est différent ici. Là-bas, nous cultivions, il y avait des fruits partout. Ici, on doit tout acheter », déplore aussi le retraité José qui, depuis qu’il habite à Mariana, a troqué les cultures pour la vente ambulante de biscuits dans les rues de la ville.

Comme tous les autres « réfugiés », leur loyer est payé par l’entreprise Samarco et ils reçoivent, en compensation des sources de revenus disparus, le salaire minium et une allocation de base, soit environ 340 euros en tout. Comme eux, plus de 8000 personnes, dont de nombreux pêcheurs, touchent cette aide d’urgence dans les deux États du Minas Gerais et d’Espírito Santo. Mais ce que José et Keila veulent avant tout, c’est la reconstruction du village, prévue à quelques dizaines de kilomètres de Mariana, plus loin des barrages, en zone sûre.
Indemnisations et relocalisations n’ont pas avancé
Pour l’instant, aucun chantier n’a démarré. Seul le terrain a été choisi. Sur place, il n’y a qu’une forêt touffue. La zone n’a été ni déboisée, ni aplanie. « Rien n’avance », se plaint Manoel Marcos Muniz, travailleur retraité de Samarco et ancien habitant de Bento Rodriguez. « Je pensais que ce serait plus rapide, concède aussi José, qui représente les habitants de l’ancien village aux multiples réunions qui se sont tenues, depuis la catastrophe, avec l’entreprise et la municipalité. Notre lutte est difficile. Nous avons deux ou trois réunions chaque semaine. Nous devons tout négocier, il faut que tout soit écrit sur le papier. »
L’entreprise annonce un début des travaux pour mars 2018 et une livraison l’année suivante. Les responsables veulent toutefois rester prudents : les délais seront difficile à tenir, avertissent-ils. Pour expliquer ces retards, l’ingénieur en charge de la relocalisation accuse la bureaucratie – les normes visant à prévenir des inondations par exemple... – ou les changements d’avis des habitants, mais jamais les obstacles dressés par l’entreprise.
Un processus dominé par les entreprises minières
Une fondation coordonne aujourd’hui l’indemnisation et la relocalisation des sinistrés. Nommée Renova, elle est créée en août 2016 suite à un accord entre l’entreprise Samarco, ses actionnaires – Samarco est une joint-venture de l’entreprise minière brésilienne Vale et le groupe anglo-australien BHP Billiton –, les autorités locales, l’État fédéral, et plusieurs administrations. L’accord définit les modalités d’indemnisation, de relocalisation, et établit des amendes que l’entreprise devrait payer pour les dommages. Samarco a d’abord fait appel de la quasi-totalité de ces amendes.
En attendant, aucun des habitants de Bento Rodriguez n’a encore reçu d’indemnisation. Pour cela, l’enregistrement des dossiers et des questionnaires doit commencer en ce début d’année 2018. « Le problème de cet accord, c’est que ce sont les entreprises, Samarco, Vale et BHP Billiton, qui l’interprètent et qui mettent en œuvre les actions, critique Leticia Jocelli, du « Mouvement des personnes atteintes par les barrages » (Movimento dos atingidos por barragens, MAB). La jeune femme est installée à Mariana depuis la catastrophe et tente de mobiliser sur place. Il y a bien un comité inter-fédéral, les autorités des États, qui doit contrôler les actions de la fondation, mais il n’a pas de pouvoir réel ». Les organes de décision de la fondation sont en fait essentiellement composés de personnes placées par les entreprises. Les représentants des populations sinistrées en sont exclus. « Aucune des communautés affectées n’a participé à l’établissement de cet accord », souligne Tchenna Maso, du secrétariat général du MAB.
Priorité aux reliques religieuses plutôt qu’aux êtres humains
La conclusion de l’accord entre les entreprises et les autorités a aussi conduit à la suspension de la procédure judiciaire civile que le gouvernement fédéral avait d’abord lancée contre l’entreprise. Il reste toutefois celle, pénale, initiée par le ministère public fédéral. Celle-ci a été brièvement suspendue cet été avant de reprendre fin 2017. Aucun des 22 responsables mis en cause pour la mort des 19 victimes et les dégâts causés par la rupture du barrage n’a été jugé pour l’instant.
De son côté, la fondation Renova, qui emploie 460 personnes, ne cesse de vanter ses actions. Si la responsabilité de Samarco est pointée du doigt pour la pêche toujours impossible sur une partie du fleuve, Renova réplique que l’eau du Rio Doce n’a jamais été aussi propre, et qu’elle est d’abord polluée par le rejets d’eaux usées, bien plus que par les boues minières.
À Mariana, les responsables de la fondation font fièrement visiter le bâtiment construit tout spécialement pour conserver les objets religieux et pièces de mobiliers des églises des villages détruits qui ont pu être extirpés de la boue. Cette même entreprise qui n’avait pas mis en place de système d’alerte pour les villages menacés par les barrages, finance aujourd’hui une équipe de restaurateurs professionnels pour récupérer les statuettes, les livres de prières, les chasubles, les menuiseries ou les autels des églises disparues dans les boues toxiques.
Ce jour de décembre 2017, il pleut, beaucoup dans le Minas Gerais. L’accès aux ruines du village de Bento Rodriguez est interdit par les autorités : le risque de foudre, sur un terrain où il ne reste presque plus rien, serait trop important. Mais il est possible de se rendre à Barra Longa, une localité voisine de quelques milliers d’habitants, où la coulée de boue venue de la rivière avait détruit la place centrale et envahi une partie des habitations.
Les stigmates de la coulée encore visibles
Sur cette place, ont été installés des bancs flambant neuf, de nouveaux pavés fabriqués à partir des résidus de boue, et, sur la promenade qui longe la rivière, des jeux multicolores pour les enfants et des portiques d’exercices physiques pour les plus âgés. Des ouvriers et des personnels de Renova s’activent dans le centre pour mener à bien les travaux encore en cours. Plus loin, sur les rives de la rivière, des amas gris comme du bitume sont toujours agglomérés : ce sont, encore, des résidus des rejets miniers du barrage.
Sur la route, en traversant les localités de Paracatu de Baixo et de Gesteira, les maisons et les arbres près de la rivière portent encore la marque de la boue rouge qui a déferlé sur eux. « Ici, la boue était partout. Nous étions encerclés. Pendant six jours, nous n’avons pas pu sortir, se souvient Rafael, éleveur de bovins dans la partie rurale de la commune de Gesteira. Pendant ces six jours, il ne pouvait pas non plus appeler les secours. Au bout d’un moment, un hélicoptère est passé et nous a vus. » Ici, dans la ferme de Rafael, la fondation Renova a financé et accompagné la mise en place d’un système d’épuration des eaux usées par les plantes, et proposé une formation à son épouse pour l’inciter à vendre les spécialités artisanales qu’elle cuisine chez elle.
Ayant transféré à la fondation la responsabilité des indemnisations et de la remise en état du fleuve, l’entreprise Samarco se concentre aujourd’hui sur la reprise de l’activité du complexe minier de Germano, où le barrage a rompu. Après le drame, elle a suspendu l’extraction. Et tente maintenant de récupérer toutes les autorisations nécessaires. Début décembre, Samarco a enchaîné les audiences publiques dans la zone pour présenter une nouvelle étude de faisabilité.
« De quoi a besoin Samarco pour recommencer à opérer ? », interroge le mini-dossier distribué au début de l’audience de Mariana, le 7 décembre dernier. À l’entrée du gymnase, tout le monde doit passer par des portiques de sécurité, tous les sacs sont vérifiés. À l’intérieur, des centaines de personnes sont assises sur des chaises en plastiques disposées entre les gradins. Des hommes surtout, des travailleurs de Samarco, en majorité.
Aucun sinistré n’est invité à venir s’exprimer
L’auteur de l’étude vient d’abord expliquer les nouvelles infrastructures de gestion des rejets miniers, d’approvisionnement en eau, de filtrage, et les nouveaux barrages que l’entreprise veut mettre en place pour relancer le complexe. Puis, ce sont presque uniquement des défenseurs fervents de Samarco qui prennent la parole sur le podium : porte-parole d’une association de producteurs ruraux, représentant syndical, maire de Mariana, représentant du patronat de l’Espírito Santo… Tous viennent clamer leur entière confiance dans l’entreprise et leur souhait de voir son activité reprendre au plus vite.
« Les accidents, ça arrive », dit l’une des intervenants. « L’environnement, c’est important, mais l’accès à un emploi aussi », insiste le maire. Le porte-parole d’un association sobrement nommée « Nous sommes tous Samarco » (Somos todos Samarco) demande même à ceux qui sont pour la reprise de se lever. La position de la salle est claire : presque tout le monde est debout. S’il est bien rendu un hommage bref aux victimes du 5 novembre 2015, pas un mot n’est prononcé pour ceux qui ont perdu leurs maisons et leurs sources de revenu avec la coulée de boue. Aucun d’entre eux, ni habitants des villages détruits, ni pêcheurs, ni, a fortiori, membre des communautés indigènes qui ont aussi été touchées par les dégâts environnementaux, n’est invité à venir s’exprimer sur l’estrade.
1600 emplois supprimés, 250 millions versés aux actionnaires
C’est que Mariana vit principalement, depuis des siècles, de la mine, et depuis 40 ans de Samarco. Plus de la moitié de recettes de la municipalité vient des impôts payés par l’entreprise [1]. Samarco emploie directement 3000 personnes dans les deux États du Minas Gerais et de l’Espírito Santo, où elle gère un port destiné à l’export des minerais. Sans compter les travailleurs des sous-traitants. Depuis la rupture du barrage et l’arrêt du complexe minier, le chômage est passé de 5 à 23 % dans la ville de Mariana.

Samarco avait déjà opéré un premier programme de départs volontaires et de licenciements, en 2016, supprimant plus de 1000 postes. Mi-novembre 2017, soit quelques semaines seulement avant les audiences publiques, elle annonçait un nouveau programme de suppression de 600 emplois dans les deux États. Pourtant, en 2016, Vale, l’un de deux actionnaires de Samarco, a encore payé 250 millions de dollars de dividendes à ses actionnaires. C’était certes six fois moins qu’en 2015, mais cela reste 800 millions de reais. Or, payer pendant un an 3000 salariés 3000 reais par mois coûterait… 108 millions de reais.
Le jour de l’audience publique de Mariana, seules deux voix discordantes se sont exprimées sur l’estrade, deux activistes écologistes. Le premier s’est fait hué. La deuxième a souligné, articles de presse à l’appui, les bénéfices qu’ont générés, encore ces deux dernières années, les sociétés actionnaires de Samarco, et la proportion, finalement minime, que représentent les salaires des travailleurs face à cette somme. Elle, au moins, a terminé sa prise de parole sans sifflet.
« Si la mine rouvre maintenant, est-ce que Samarco ne va pas nous oublier ? »
« Pour les travailleurs de Samarco, c’est sûr que c’est une mauvaise chose que la mine soit arrêtée, dit José. Moi, je ne suis pas allé à l’audience pour cette raison. Je suis un sinistré. Qu’est-ce que j’irais faire là-bas ? Je vais parler, et ils vont me taper. Je pense aussi que Samarco doit reprendre l’activité de la mine. Mais seulement après nous avoir réinstallés, après nous avoir indemnisés. Si elle recommence maintenant, est-ce que Samarco ne va pas nous oublier ? »
Avec les suppressions d’emploi, les relations entre les habitants de la ville de Mariana, dépendants de la mine, et ceux des anciens villages détruits se détériorent. « Au début, tout le monde nous a beaucoup aidés. Mais avec le temps, ils nous ont rendu coupables des difficultés économiques, regrette Keila. Et la discrimination a commencé. Les gens disent que nous, nous vivons bien, alors qu’il y a des gens à Mariana qui ont faim. » Une situation que les activistes du MAB observent au quotidien. « Pour nous, les personnes qui ont perdu leur emploi à Samarco suite à la catastrophe sont aussi des "sinistrés" et devraient être reconnus comme tels pour revendiquer une indemnisation. Malheureusement, ce débat n’a pas eu lieu », déplore Leticia. Même le retraité de Samarco, Manoel Marcos Muniz, voit qu’il « n’est pas le bienvenu en ville ».
« Je pense que Samarco doit reprendre son activité. Mais avec une grande responsabilité. Et elle doit continuer à nous aider. Parce que nous, nous sommes des moustiques dans cette histoire. Il ne faut plus jamais que ce qui nous est arrivé se reproduise », insiste l’homme. Mi novembre, au moment de fortes pluies, les autorités du Minas Gerais s’inquiétaient pourtant des risques que présentait un autre barrage minier de la région, à Congonhas, à quelques dizaines de kilomètres à l’ouest de Mariana. « Notre ville est très dépendante des mines, depuis longtemps. Mais pendant combien de temps encore y aura-t-il des minerais à extraire ? Nos gouvernants devraient faire de notre ville une ville meilleure, qui pourrait vivre d’autre chose que de la mine », pense aujourd’hui l’ancien travailleur des mines, qui en est devenu une victime.
Rachel Knaebel (texte et photos)
Photo de une : lors de la catastrophe, en novembre 2015 / Kadeh Ferreira
Série « Eau et climat », en partenariat avec France Libertés
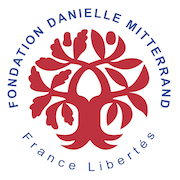
Cet article est publié dans le cadre d’une série de reportages et d’enquêtes sur les enjeux de la gestion de l’eau et des sols dans le contexte du réchauffement climatique, réalisée avec le soutien de France Libertés - fondation Danielle Mitterrand. www.france-libertes.org















