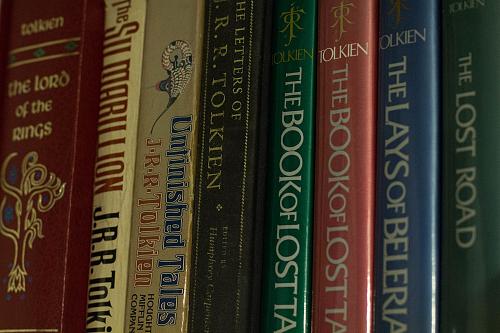Basta! : Le Front national entretient une sorte de « grande confusion », en se réappropriant des thématiques qui n’étaient pas les siennes, comme la laïcité. Beaucoup de gens, un peu perdus politiquement, se laissent attirer par ces discours. Comment analysez-vous cette évolution ?
Raphaël Liogier [1] : Il n’y a pas extension de l’extrême droite, mais une dissolution, ce qui est plus grave. Le national-libéralisme typique de l’extrême droite française, portée par des individus réactionnaires et nationalistes, mais aussi libéraux du point de vue économique – comme Jean-Marie Le Pen qui était favorable à la suppression de l’impôt sur le revenu – n’existe plus aujourd’hui. Le discours du Front national a évolué.
Dans toute l’Europe, on observe la mobilisation dans les discours des valeurs centrales de cohésion, quelles que soient ces valeurs. Le Front National n’y échappe pas. En France, une des valeurs centrales est la laïcité, donc le Front national va mobiliser la laïcité et la défendre. A l’opposé de ce que faisait Jean-Marie Le Pen à ses débuts : il considérait alors la laïcité comme une valeur portée par la gauche, les athées, les gens qui ne seraient pas vraiment français. La laïcité est défendue aujourd’hui par le Front national de la même manière que la virginité de Jeanne d’Arc, le château de Versailles, le vase de Soissons ou le « christianisme immémorial de la France éternelle, fille de l’Église ». Ce qui compte, ce n’est pas ce que signifie la laïcité – qui veut dire pourtant des choses très précises. La laïcité va être mobilisée comme étant un instrument « d’hygiène culturelle ».
Est-ce le même processus ailleurs en Europe ?
En Norvège, le parti qui porte un programme similaire s’appelle le Parti du progrès. Pourquoi ce nom, alors que son but est de chasser les musulmans ? Parce que la notion de progrès en Norvège est aussi importante que la notion de laïcité en France. En Suède, c’est le Parti de la liberté, tout comme l’Autriche. Ces partis mobilisent des concepts qui sont ni de droite ni de gauche, ni progressistes ni réactionnaires. Des notions qui sont vidées de leur contenu juridique réel. C’est cela qui est en train de gagner du terrain.
La laïcité revendiquée par le Front national est donc vidée de sa signification ?

La laïcité, c’est deux choses : la séparation des églises et de l’État, définie par la loi de 1905 – et non pas la séparation du religieux et du politique – et la neutralité des agents publics. Ce qui n’est pas la neutralité de l’espace public ! Si l’espace public devient un espace contraint en ce qui concerne l’expression des opinions, qu’elles soient politiques ou religieuses, c’est une régression. Ce qu’on nous propose aujourd’hui, ce n’est même pas la neutralité de l’espace public, c’est sa neutralisation, donc un retour à une situation antérieure à 1789, au nom de la laïcité.
Cette absurdité est portée non seulement par les partis « populistes », mais aussi dans l’ensemble du champ politique. Quand François Hollande dit que la laïcité ne s’arrêtera qu’au seuil de l’intimité, cela signifie qu’on est libre d’exprimer ses opinions uniquement tout seul chez soi le soir… C’est insensé ! La neutralité des agents publics est justement là pour préserver l’expression publique, pour que l’espace public reste un espace révolutionnaire, où on peut exprimer ses opinions, sans influence. Il y a aujourd’hui un renversement total lorsqu’on dit « il faut laïciser l’espace public ». Cela ne veut rien dire, ce n’est pas logique.
Ce recours aux valeurs de cohésion nationale est, selon vous, symptomatique du développement du populisme. Comment définissez-vous le populisme aujourd’hui ?
Le populisme, c’est lorsqu’un individu s’exprime en lieu et place de la fiction du peuple. Le peuple, c’est un ensemble de classes sociales, de gens aux intérêts différents, des riches, des pauvres… Or d’un seul coup, avec le populisme, on se retrouve face à un « peuple total », qui serait pourvu d’un sens de la vérité inné – ce qu’on appelle le bon sens populaire. L’image du peuple est suffisamment imprécise, ce qui permet de rassembler en son nom, dans une atmosphère d’unanimisme, avec une invocation du bon sens et des valeurs populaires.
Les populistes prétendent avoir accès à cette vérité « populaire » – opposée aux mensonges du « système ». Une « vérité » que personne ne pourrait remettre en cause. On aura beau expliquer, donner des chiffres, pour contrecarrer les discours sur l’immigration, on va nous répondre que les chiffres sont truqués, que ce n’est pas réaliste, ou qu’on est un idiot utile. Le populiste prétend être réaliste, parler du « réel ». Il utilise la science quand cela l’arrange. Et propose une vision manichéenne du monde. Il prétend avoir un lien mystique, un lien direct avec le peuple : plus besoin des institutions, de ce qui crée une médiation. Celles-ci, aux yeux du populiste, ne représentent plus rien, puisqu’elles ne représentent pas le vrai peuple.
Le populisme a aussi besoin d’un « ennemi » pour fonctionner…
Le populiste a besoin d’ennemis, de pointer du doigt ceux qui ne font pas partie du « vrai » peuple. Pour lui, certains prétendent être du peuple mais n’en sont pas. Ce sont notamment les minorités ethno-culturelles : ce sont des ennemis parce qu’ils nous infiltrent, prétendent être d’ici mais ne le sont pas vraiment. De ce point de vue, cela fonctionne aujourd’hui comme dans les années 1930. Changez les personnages, mettez « juif » à la place de « musulman », on retrouve la même chose. Les ennemis, ce sont aussi ceux qui « trahissent » : ces « salauds de Parisiens », les journalistes, les « bobos » multiculturalistes, les « élites », ceux qui font partie du système. Comme aujourd’hui l’idée centrale est la défense culturelle, le mot multiculturalisme est devenu un gros mot.
Pour le populiste, il est nécessaire de trouver un responsable, un ennemi contre lequel il faudrait défendre nos valeurs qui seraient attaquées. C’est tout l’intérêt de la focalisation sur l’islam : certains y voient une menace de la grande tradition judéo-chrétienne – l’image du sarrasin médiéval contre la chrétienté –, et d’autres une menace contre la modernité, niant le droit des femmes. Grâce à ce côté bicéphale, la figure du musulman peut provoquer des alliances inédites, sur lequel le populisme va s’appuyer, en restant dans le registre émotionnel, le flou, en faisant communier des réactionnaires et des progressistes.
En quoi cette situation est-elle nouvelle ?
Il y a toujours eu des populistes. Mais à certaines périodes cela ne marche pas, leurs gesticulations font plutôt rire les gens. Cela fonctionne lorsqu’il y a une vraie crise symbolique, lorsque les gens ne savent plus ce qu’ils sont. Pourquoi le populisme a-t-il séduit en Allemagne dans les années 1930 ? La crise économique de 1929 était tout aussi forte en France ou aux États-Unis. Mais l’Allemagne avait des blessures narcissiques très fortes : le traité de Versailles, les territoires perdus.... C’est ce que j’appelle une crise symbolique : on ne ressemble pas à ce à quoi on voudrait ressembler. On a peur de ne plus être identique à ce qu’on a été. Pour que le populisme se diffuse, il y a besoin d’une crise symbolique. Il se nourrit d’un sentiment de frustration collective.
C’est ce qui se passe aujourd’hui en Europe ?
Imaginez le type qui a toujours été le plus important du village. À un moment donné, il perd sa domination économique. Il a encore suffisamment d’argent pour préserver les apparences, le mythe de sa suprématie, de sa grandeur, il garde un certain poids symbolique. Mais finalement, les gens du village commencent à se moquer de lui. Ou à ne plus le voir. C’est ce qui s’est passé avec l’Europe, centre du monde, qui a perdu sa suprématie militaire et économique à la fin la Seconde guerre mondiale. Elle restait quand même le « psychanalyste global » : d’un côté le paternalisme américain, de l’autre le tiers-monde infantilisé, et au milieu une Europe qui était une sorte de psychanalyste planétaire, étendait tout le monde sur le divan et donnait des leçons de morale. Cela a marché jusqu’aux années 1990.
En 2003, lors du conflit en Irak, les États-Unis disent à l’Europe : « Avec ou sans vous, c’est pareil ». On s’interroge sur le maintien de la France et du Royaume-Uni comme membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies. Viennent ensuite les débats sur l’identité nationale en France. Et la crise symbolique de cette Europe qui n’arrive pas à s’unir, qui n’arrive pas à exister à une échelle qui serait digne de ses ambitions. Tout cela aboutit à une crise narcissique : je ne me vois plus de la même façon dans les yeux des autres, et les signaux qui sont envoyés ne sont pas ceux que mon narcissisme attend.
Quelles sont les conséquences politiques de cette crise symbolique ?
Contrairement à l’extrême droite, qui reste à la marge, le populisme est une machine pour arriver au pouvoir, parce qu’il déplace le centre de gravité politique. Des valeurs de l’extrême droite deviennent légitimes, en ayant d’un coup l’air moins extrêmes. Elles se déplacent vers le centre de l’échiquier politique, tout en restant radicales. Cela se produit grâce au confusionnisme – le mélange entre des valeurs de droite et de gauche dans les discours – caractéristique essentielle du populisme.
Sommes-nous entrés dans une ère de confusion politique ?
Il y a une différence fondamentale avec les années 1930 : nous sommes aujourd’hui face à un populisme liquide. Ce populisme liquide n’est pas fondé sur une idéologie stable, mais sur les variations de l’opinion en temps réel. Le seul point commun entre le populisme actuel et celui des années 1930, c’est ce sentiment d’être attaqué, qu’il y a un complot, que nos valeurs centrales – qu’elles soient traditionnelles ou progressistes – sont menacées et qu’il faut s’unir pour les défendre. Cela est porté par les partis politiques populistes mais pas seulement – on sent une tension permanente dans l’espace public, dans le débat… Avec des « progressistes réactionnaires » et des « réactionnaires progressistes », qui finalement disent à peu près la même chose mais en sens inverse.
C’est là que se situe la différence entre « populisme liquide » et « populisme solide », qui caractérisait les années 1930. Ce dernier est fondé sur des idéologies qui sont cristallisées, solides. Il se fonde sur une idéologie précise, séduisant progressivement une grande partie de la population. En revanche, le populisme solide n’infiltre pas le monde politique classique. Les partis politiques de la République de Weimar se sont littéralement effondrés. Mais ils n’étaient pas infiltrés par le national-socialisme dans leurs discours, ils continuaient de garder leur ligne politique. Ce n’était pas un populisme infiltrant. Il se heurtait aux institutions, car il était solide.
Ce qui n’est pas le cas du populisme actuel ?
Le populisme actuel n’est plus fondé sur une idéologie stable. La culture n’est pas une notion stable, on peut mettre n’importe quoi dedans. Lorsque l’extrême droite parle du mariage pour tous, les ennemis du moment sont les homosexuels. Les musulmans deviennent des alliés. Puis ils redeviennent les ennemis. Résultat, tout le monde se sent attaqué sans savoir exactement par qui, pourquoi, comment.
Autre caractéristique du populisme liquide : il n’est pas suffisamment solide pour créer une société totalitaire, qui suppose une idéologie stable. La bonne nouvelle, c’est qu’on n’aura peut-être pas la Solution finale. La mauvaise nouvelle, c’est que le populisme actuel n’a pas besoin d’un renversement de régime, car le régime lui-même est rongé de l’intérieur, progressivement, sans qu’on s’en rende compte.
Ce processus d’infiltration est renforcé par le marketing politique, par cette impression que le sens des mots lui-même est récupéré…
Le populiste se moque bien du sens des choses, l’important est de « faire signe ». De se montrer préoccupé, plus que de faire sens. Quand le Front national défend la laïcité, c’est la politique du signe : il se fiche de savoir quel sens il donne à la laïcité. Dès qu’on essaye de discuter avec Marine Le Pen, elle assène : « Laïcité ». L’important, c’est de donner l’impression de défendre un élément du patrimoine national, un attribut du peuple. C’est ce que j’appelle la « patrimonialisation » des valeurs centrales de cohésion : il faudrait défendre cet attribut patrimonial, quel que soit son contenu, quelle que soit sa signification.
Les nouveaux moyens de communication favorisent sans doute aussi le développement de ce populisme liquide ?
Cette liquidité du populisme est liée à la globalisation et aux mobilités humaines, matérielles, financières, qu’elle favorise. Et au grand bain informationnel dans lequel nous sommes immergés, rendu possible notamment par Internet. Il ne peut plus y avoir de structuration unitaire, ne serait-ce que parce qu’il y a une multiplicité des sources. Chaque événement produit également des effets de proximité, même s’ils sont éloignés : une bombe éclate à Gaza, et pour certains c’est comme si c’était dans leur jardin, ils se sentent attaqués directement. Les symboles – éléments importants dans une crise symbolique – circulent très rapidement, n’ont pas le temps de se structurer en une idéologie. La seule chose qui reste, c’est le sentiment d’être attaqués.
Quelles sont les conséquences de ce sentiment diffus d’être menacés, attaqués ?
Il y a une sorte de suspicion généralisée : chacun suspecte son voisin de vouloir s’attaquer à son identité. Dans ce contexte, la violence devient aussi liquide. Dans ce sens le jihadisme de 2015 est très différent de celui des années 1990 et du début 2000. A cette époque, on a affaire à des professionnels, nés et endoctrinés dans un contexte religieux, qui appartiennent à des réseaux, à des organisations structurées.
Aujourd’hui, ce sont des jeunes en mal d’idéaux, frustrés, pas spécialement immergés dans un milieu religieux. Ils deviennent« jihadistes » parce que cela représente la « figure idéale » de l’ennemi pour ceux qu’ils estiment être responsables de leur souffrance – les « occidentaux », les « Juifs », « l’élite », etc. Leur vie reprend alors du poids, un sens. Il y a renversement du sens du stigmate. Ils se sentaient exclus parce qu’ils étaient d’origine maghrébine ou africaine, différents. Et là, ils se sentent choisis pour être des héros justement parce qu’ils sont discriminés. Leur échec social devient le signe d’une mission plus haute et impérieuse à accomplir.
Cette posture du héros-jihadiste est directement induite par la mise en scène de la décadence des valeurs européennes, de la civilisation européenne, et peut conduire certains jeunes à sur-jouer le rôle de l’ennemi qui leur est assigné, jusqu’au passage à l’acte vengeur. En sens inverse, le héros-défenseur de l’Occident peut aussi surjouer le rôle qu’il s’imagine être le sien. Et, parce qu’il est lui aussi au chômage, frustré, mais qu’il n’est pas d’origine nord-africaine, son ennemi devient le musulman et les traîtres multiculturalistes qui les laissent « nous » conquérir – et qui semblent responsables de sa détresse ne serait-ce que parce qu’ils lui voleraient l’emploi qu’il mériterait. Nous pouvons aussi voir surgir un Anders Breivik [auteur d’un attentat et d’un massacre en Norvège le 11 juillet 2011, qui fera 77 morts, ndlr] qui tue des traîtres à la nation, des « gauchistes » multiculturalistes. La suspicion est tellement diffuse et générale, que les ennemis changent à grande vitesse, de façon étourdissante, seul reste le sentiment qu’il y a un complot, que l’on nous en veut.
Qui sont les populistes aujourd’hui ? Des responsables politiques ? Des « polémistes » ?
Certains sont passés maîtres dans ce populisme liquide, comme Alain Soral. Il peut dire n’importe quoi et se contredire ensuite. Les gens retiennent que c’est quand même louche, qu’il se passe quelque chose. Ses explications ont l’air extrêmement logiques, elles attirent parce qu’elles proposent une structure, elles donnent une explication par le complot, par l’attaque. S’il n’y avait pas Internet, Alain Soral ne pourrait pas diffuser ses vidéos, il n’attirerait pas autant de gens.
Un autre opérateur populiste typique est Eric Zemmour. Il croit vraiment que c’est la guerre, il se voit comme le héros qui va défendre la civilisation, la société, le peuple, la vraie tradition. Soral ou Zemmour, on sait où les situer. Le problème du populisme liquide, c’est qu’on le retrouve un peu partout. Jusque dans des discussions avec des gens qui sont un peu punks, des gens qui sont supposés être dans une culture alternative. Ce qui est grave, c’est quand François Hollande – qui n’est pas a priori un populiste – se sent obligé de dire que la neutralité doit s’appliquer à l’ensemble de l’espace public et qu’elle ne s’arrêtera qu’au seuil de l’intimité. Cela finit par normaliser, intérioriser, relativiser les idées populistes. Et permettre au système d’être rongé de l’intérieur.
Comment peut-on contrecarrer ce type de discours ?
C’est impossible. C’est pour cela que je parle de populisme liquide. Les partis politiques n’en sont pas exempts, ils diffusent aussi ce type de thèmes. Des gens qui sont supposés être des scientifiques disent des choses effroyables, le plus naturellement du monde. Christophe Guilluy (géographe et consultant auprès de collectivités locales, ndlr) affirme ainsi que, dans les périphéries, les petits Blancs des classes moyennes sont chassées par les « minorités ethnoculturelles ». Mais ce n’est pas parce qu’ils en sont chassés, c’est parce qu’ils préfèrent aller habiter dans des villes moyennes lorsque leur niveau de vie s’améliore ! Comme si c’était désirable de vivre dans cette périphérie… Mais on assène l’hypothèse de l’attaque. Ces analyses sont reprises par Eric Zemmour. Et on ne peut plus rien faire, cela infiltre l’ensemble du champ politique.
Quels sont les risques de cette montée du populisme ?
C’est une menace pour l’État de droit. Cela mine le vivre-ensemble, même si ce terme est galvaudé. C’est presque une menace pour la joie de vivre. Un des problèmes aujourd’hui est que l’Europe fonctionne sur une narration négative : les Européens ne savent pas ce qu’ils sont, mais ils croient savoir ce qu’ils ne sont pas. Ils désignent donc un ennemi menaçant. Ils ne supportent plus la globalisation, la compétition mondiale, ils ont le sentiment d’être attaqués par le monde tel qu’il est, ils n’acceptent pas d’être considérés comme moins puissants qu’avant. D’où la tentation de se retrancher sur les nations. Or celles-ci n’ont plus de programmes à proposer, car c’est une échelle de gouvernance trop petite, pas à la hauteur des ambitions que pourraient avoir ces pays. Et comme il n’y a pas de programme possible, on raconte n’importe quoi.
Malgré cette crise symbolique, l’Europe a encore le plus gros PIB du monde. L’Union européenne, ce n’est pas le cheval de Troie du néolibéralisme ou de l’immigration. La vraie question n’est pas d’être pour ou contre l’Europe, mais pour quelle Europe. Les nations aujourd’hui sont trop faibles pour protéger véritablement les identités nationales. Ce que peut faire l’Europe. L’important dans le contexte actuel, c’est que l’Europe arrive à construire une narration positive d’elle-même, pour sortir de cette crise symbolique. Comme nous l’avons vu, c’est dans le théâtre populiste de la guerre culturelle générale qu’une violence terroriste venu de tout bord peut surgir à tout moment, sans véritable accroche idéologique, sans réseaux solides, seulement nourrie par le sentiment collectif ou communautaire de l’encerclement.
Propos recueillis par Agnès Rousseaux

A lire : Raphaël Liogier, Ce populisme qui vient, Entretien avec Régis Meyran, Textuel, 2013.
Photo : Place de la République, Paris, 7 janvier 2015 © Daniel Maunoury