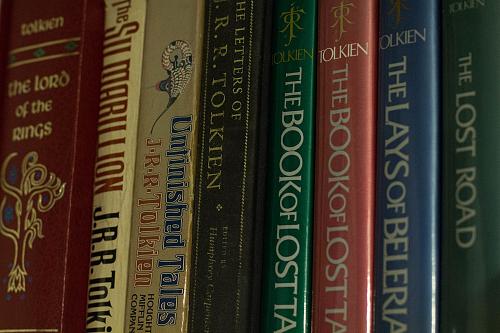Ils sont étudiants dans les universités et dans les écoles supérieures parisiennes. Ils se sont rencontrés lors des mobilisations de l’été et de l’automne dernier pour les migrants, au Jardin d’Éole ou au Lycée Jean Quarré, dans les 18e et 19e arrondissements. Certains étaient déjà des militants syndicaux, d’autres avaient travaillé ou travaillaient sur les questions liées à l’immigration. D’autres encore se sont engagés à cette occasion dans la solidarité. Tous ont en commun d’avoir été témoins d’une situation d’urgence qui les a profondément bouleversés. Les liens créés avec les migrants et leurs soutiens durant cette période, ils n’ont pas imaginés les défaire par la suite.
À la rentrée, ils ont commencé à mobiliser leurs établissements respectifs, puis à y créer des associations, pour que des exilés — sans condition de statut, demandeurs d’asile ou non — puissent suivre des cours de français langue étrangère (FLE), et si besoin reprendre leurs études. La réponse de l’institution a été très variable d’un lieu à l’autre, en fonction aussi du soutien actif de certains enseignants ou de membres du personnel.
En avril 2016, ces différents projets sont rassemblés dans un collectif, Resome, pour « Réseau études supérieures et orientation des migrant.e.s et exilé.e.s ». Un site est créé où paraît une tribune signée par de grands noms de l’université et des grandes écoles, spécialistes en sciences humaines, philosophie et droit pour l’essentiel. La tribune est reprise le 2 mai, dans le journal Libération, au moment précis où les réalisations concrètes commencent à se faire jour. À l’exception de l’École normale supérieure (ENS) de Lyon, l’implication concerne exclusivement une dizaine d’établissements à Paris et en proche banlieue. L’un des enjeux des mois à venir sera de mobiliser en région.
Auprès de Syriens ou d’Afghans
André est étudiant à Paris IV et à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), militant dans un syndicat indépendant de Paris-Sorbonne, majoritaire depuis 2014. Il a 26 ans et deux masters en poche, en sciences politiques et en philosophie. Calme et déterminé, il puise une part de son énergie dans la mémoire familiale. Fils d’immigrés portugais, il sait combien ses parents ont dû lutter pour se faire une place en France. Depuis octobre, il travaille avec deux étudiantes, Alice et Solène, à la création d’une classe de français langue étrangère (FLE). Ensemble, ils ont choisi le site de Clignancourt, au nord de Paris, moins engorgé que les bâtiments prestigieux du Quartier latin, plus proche surtout des lieux où se trouvent les migrants. Ils ont décidé d’appeler leur association Infléchir, parce qu’il y avait le sigle FLE à l’intérieur.
« Il fallait aussi convaincre l’administration ajoute-t-il dans un sourire. La différence d’Infléchir avec les autres projets, c’est qu’ailleurs c’est l’institution qui a ouvert ses portes. » À force de tractations, le projet a été officialisé en janvier, la convention signée en février, mais les attentats de Bruxelles ont créé de nouvelles difficultés. Les étudiants sans papiers se sont vus bloquer l’accès au site. Les cours ont finalement commencé début mai. La convention expire en juillet et il faudra batailler pour son renouvellement.
Les huit heures de cours hebdomadaires sont assurés par deux stagiaires en deuxième année de master de FLE. Ils sont financés par le Service interuniversitaire de l’apprentissage des Langues (SIAL). Pour cette première cession, les étudiants on été divisés en deux groupes de niveau, certains ayant déjà des connaissances de base en français.
Objectif : préparer au diplôme d’étude en langue française
Ils sont dix-sept « apprenants », dont quatre femmes. Trois ne sont jamais venus, d’autres ont des problèmes d’assiduité, liés aussi à des difficultés matérielles, mais la majorité s’accroche, déterminée. On retrouve parmi eux les nationalités les plus représentées parmi les demandeurs d’asile en Europe aujourd’hui : soudanais, afghans, syriens, érythréens, tchadiens, éthiopiens. Ils ont environ vingt-cinq ans en moyenne, et la plupart parlent anglais. En plus des cours, des ateliers de conversations sont prévus avec des référents. À la rentrée prochaine, André voudrait que soient créés des binômes entre étudiants invités et étudiants de l’université, comme cela existe dans les dispositifs mis en place par les grandes écoles.
Les étudiants vivent dans des hébergements d’urgence à Saint-Ouen et Noisy-le-Sec. Le recrutement s’est fait par l’intermédiaire du programme d’étudiants invités de l’ENS et du BAAM, le Bureau d’accueil et d’accompagnement des migrants, créé à l’initiative d’un groupe de soutiens solidaires des migrants du lycée Jean Quarré. L’objectif est de préparer au diplôme d’étude en langue française. Le niveau « B2 » dispense de tout test linguistique pour l’entrée à l’université.
L’an prochain, Alice et Solène vont partir en Érasmus. « Nous avons beaucoup de soutiens formidables, s’inquiète André, mais ça reste difficile, car il il manque des gens prêts à s’impliquer davantage dans le bénévolat. Ceci dit, je n’en suis pas à ma première association. Je sais bien que tout repose en général sur deux ou trois personnes qui font beaucoup de travail. C’est le fonctionnement normal. »
Des besoins en formation de techniciens et d’ingénieurs
À l’école d’agronomie, AgroParisTech, la situation semble moins précaire. L’école, qui a déjà accueilli de jeunes afghans en 2010, est habituée à ce type de dispositif. Durant cette même année, Joséphine, Claire et David ont établi la charte d’organisation interne de leur association, Agros migrateurs. Comme pour leurs camarades de Paris IV, leur tâche la plus ardue n’a pas été pédagogique, mais administrative. Le projet a été officialisé en février mais les cours ne commenceront qu’en septembre. Ils seront dispensés par un enseignant attitré de FLE, qui disposera de deux heures sur son emploi du temps. Pour le reste, les Agros migrateurs devront faire appel à des bénévoles.
Chaque étudiant invité bénéficiera d’un accompagnement personnel par un étudiant et un membre de la communauté — enseignant ou personnel. Il est prévu de développer l’échange interculturel, d’organiser des sorties de découverte du patrimoine et de répondre aux demandes complémentaires par courriel. Les livres et les cahiers seront financés sur le budget courant.
Les étudiants à l’initiative du projet ont constaté qu’il y avait parmi les migrants de gros besoins en formation de techniciens et ingénieurs, ainsi qu’en informatique. C’est aussi le constat fait par Cécile, étudiante à l’École nationale supérieure de création industrielle (ENSCI). Par sa seule énergie, elle est parvenue à faire entrer cette année un jeune afghan dans la Formation atelier-projet-design de son école. Ce dernier a apporté un précieux savoir-faire aux autres étudiants. Deux autres jeunes devraient intégrer l’école l’an prochain. Cécile souhaiterais que d’autres formations supérieures techniques — comme des BTS ou des DUT — ou des écoles d’architecture, ouvrent à leur tour leurs portes aux exilés.
Une première étape vers la reprise d’études
Paris VIII reste quant à elle fidèle à sa tradition issue de la contestation de mai 68. Le collectif s’y est organisé cet hiver, suite aux difficultés à faire inscrire un étudiant syrien et à l’annonce de la création d’un diplôme universitaire (DU) en FLE. Il s’est inscrit dans le cadre du RUSF, le Réseau Université Sans Frontières. Le collectif dispose de sa propre salle au troisième étage, où se tient une permanence du lundi au jeudi. Certains viennent là « juste pour parler avec quelqu’un en français ». Pauline, étudiante en double licence d’histoire et de sciences politiques, est l’une des initiatrices du projet. Elle vient des beaux quartiers de Paris, mais elle a trouvé ici une mixité sociale qu’elle apprécie et qui lui apporte beaucoup. Elle dit aussi combien l’aide de certains enseignants a été précieuse pour la mise en place de leur projet. Il y a beaucoup d’enthousiasme et d’admiration dans ses yeux.
Les étudiants invités ont entre 25 et 30 ans, ils viennent eux-aussi d’Afghanistan, de Palestine, de Syrie, d’Érythrée, du Soudan, du Tchad. L’existence d’un diplôme universitaire permet de valider des crédits, comme dans une filière classique. Pauline cite le cas d’Ibrahim, 22 ans, qui parle syrien, anglais et français. Pour lui comme pour d’autres, le DU pourrait être une première étape vers une reprise d’études.
À l’instar de Paris IV, cependant, les moyens manquent. Nul ne sait pour l’instant si le diplôme, dont la préparation dure six mois, sera reconduit l’an prochain. Malgré cela, le réseau est parvenu à organiser une sortie cinéma avec une vingtaine d’invités, ainsi que deux pique-niques. Pauline prend son rôle très à cœur : « Quand on décide d’aider, on prend de vraies responsabilités. » Le dimanche, elle va aussi donner trois heures de cours dans le jardin de l’hôpital Saint-Vincent de Paul, avec l’association Voyage au bout de la 11, membre aussi de Resome. « C’est là que je me sens directement utile. »
A l’ENS de la rue d’Ulm, une centaine d’étudiants impliqués
Dans ce réseau aux réalités contrastées, l’ENS de la rue d’Ulm fait office de moteur, offrant une prestigieuse vitrine et des conditions matérielles sans comparaison avec des universités saturées. Alison est un des piliers du programme d’étudiants invités de l’ENS. Elle a déposé le projet le 6 septembre, après avoir rencontré Omar, un Soudanais du lycée Jean Quarré. « On avait le même âge et le même niveau d’études, cinq ans de philosophie. »
L’ambition est ici la reprise d’études pour les quarante élèves, répartis en quatre niveaux et qui bénéficient de dix heures de cours hebdomadaires, donnés par des étudiants du crû bénévoles mais formés. L’an prochain, leur travail devrait être coordonné par un professeur de FLE à mi-temps. Les étudiants inscrits doivent déclarer avoir fait deux ans d’étude après le bac. Aucune preuve n’est exigée. Du reste, la plupart d’entre eux seraient dans l’impossibilité d’en fournir. Certains vivent à l’hôtel, d’autres chez des amis rencontrés par l’école.
Sur les quelques 3 000 étudiants de l’ENS, une centaine sont impliqués dans le projet, ainsi que six enseignants et trois membres du personnel administratif. Alison souligne la nécessité de construire des programmes adaptés, citant le projet d’une jeune syrienne qui voulait réaliser des spectacles pour les enfants exilés, mais aussi certains blocages dans l’apprentissage du français, même chez des étudiants brillants, après toutes les difficultés traversées. Des processus de co-apprentissage se développent entre les normaliens étudiant l’arabe et les étudiants apprenant le français.
Rappeler à l’État ses devoirs
En phase de test, le dispositif commence à prendre de l’ampleur. Lola, l’une des initiatrices de Resome, est étudiante en sciences politiques à Paris VIII. Elle travaille sur les politiques d’accueil dans les centres d’hébergement est est bénévole au Bureau d’accueil et d’accompagnement des migrants, où elle donne des cours. Elle est surtout dotée d’une contagieuse énergie positive : « Au final ça ne coûte pas très cher, et si on est motivés, ça peut se faire relativement vite. »
Son souhait est de voir le réseau sortir du cadre parisien. « La liste d’attente est énorme, souligne-t-elle, mais il faut montrer aux gens que c’est possible. On est clairement dans la volonté de se constituer en groupe de pression, pour que l’État prenne ses responsabilités. »
Comme la plupart des étudiants engagés dans ce projet, Lola a une connaissance concrète de la réalité des camps à Paris et une expertise réelle pour faire le lien entre institutions et migrants. Après la parution de la tribune dans la presse, le réseau a obtenu un rendez-vous au ministère et un autre à la mairie de Paris. Mais le combat doit se poursuivre pour pérenniser et agrandir les projets existants et en créer d’autres. Le bénévolat ne peut couvrir tous les besoins et la création de postes est devenue une priorité. Pour l’instant, déplore André, « les pouvoirs publics se lavent les mains grâce à nous ».
Olivier Favier
– Photo de Une : les étudiants d’Infléchir, l’équipe administrative et enseignante devant le site de Clignancourt. De gauche à droite, premier rang : Nazmul, Hassan, Fouzi, Erahl, Mahlet, Hamada, Zabit et Gulwali. Deuxième rang : Lucie, Steffie, Louise, André et Paul. Photo : Olivier Favier.
– Photo intégrée au texte : Ibrahim, Pauline et Sonia à la permanence RUSF de Paris VIII. Photo : Olivier Favier.

Cet article a été réalisé dans le cadre du projet Médias de proximité, soutenu par le Drac Île-de-France.