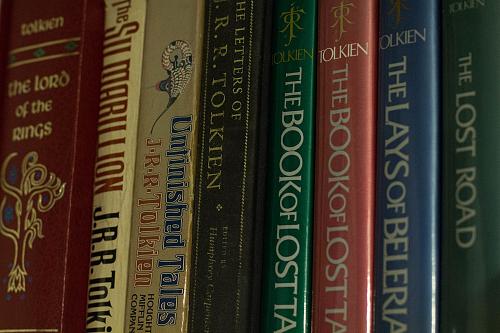J’ai 45 ans et deux enfants. Je suis fonctionnaire de l’Éducation nationale, ingénieur d’études dans un laboratoire de recherche du CNRS (Université Nice Sophia Antipolis). Je suis également enseignant au département de Géographie de la faculté des sciences et membre du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Je n’étais pas jusqu’à présent militant politique ou associatif.
Dans ma famille, nous sommes Corses. J’ai passé toutes mes vacances au village dans la maison de mon grand-père, le médecin du canton qui faisait ses visites à cheval. Au village, presque 50 ans après sa mort, les gens en parlent encore car que ce soit en pleine nuit à l’autre bout du canton, que ce soit un bandit blessé ou un paysan qui n’ait pas de quoi payer, il soignait. Dans les récits que me racontait mon père et dans les expériences que j’ai vécues là-bas, j’ai appris et compris qu’on ne laisse pas quelqu’un en danger sur le bord de la route, d’abord parce que c’est la montagne mais aussi parce que c’est une question de dignité. Ou d’honneur comme on dit.
J’ai la chance d’avoir des enfants et en tant que père avec la garde partagée, j’ai pris cette tâche pas évidente très au sérieux. Pas évidente car aujourd’hui le monde va mal que ce soit d’un point de vue social ou environnemental alors au delà d’une “bonne situation”, ce que je souhaite pour mes enfants, c’est qu’ils soient l’espoir d’un monde meilleur.
« La première fois, j’avais hésité, je n’avais pas eu le courage »
Le dimanche 16 octobre en rentrant en voiture de la fête de la brebis à la Brigue, avec ma fille de 12 ans, nous avons secouru quatre jeunes du Darfour. Ce village français est dans la vallée de la Roya, qui est frontalière de Vintimille en Italie. C’est dans cette vallée que sont régulièrement secourus des hommes mais surtout des femmes et des enfants qui se trouvent sur ces routes de montagnes et qu’on appelle « migrants ».
– Lire aussi : À la frontière franco-italienne, les habitants de la vallée de la Roya risquent la prison pour avoir aidé les migrants
Ces quatre jeunes étaient complètement perdus et se dirigeaient à pied, certains en bermuda, vers les montagnes enneigées. Avec ma fille, on les a ramenés à Nice, ils ont mangé et dormi avec nous dans mon appartement de 40m². Le lendemain, comme tous les jours d’école, nous nous sommes levés à 6h15. Ils sont venus avec moi déposer ma fille à l’école puis je les ai emmenés dans une petite gare peu surveillée par la police et je leur ai payé un billet de train pour la première partie du trajet. Ils devaient retrouver leur famille à Marseille.
C’était ma première action de secours envers ces “migrants”. Pourquoi je l’ai faite ce jour là ? Jusqu’à présent, avec mes enfants, j’avais déposé des vêtements à la Croix rouge à Vintimille, des chaussures, un sac à dos, pour aider mais aussi pour leur montrer qu’il y a des injustices dans le monde et que chacun de nous peut faire quelque chose. Là, c’était la deuxième fois que je voyais un groupe sur le bord de la route. La première fois, j’avais hésité, je n’avais pas eu le courage, mais cette fois ci il y avait ma fille et j’ai pu lui montrer l’exemple.
« Elles ont fréquenté la mort et le cortège d’horreurs qu’on n’ose imaginer »
Le lendemain, lundi 17 octobre, après une soirée chez des amis dans cette même vallée, lors de mon retour vers Nice, je décide de m’arrêter dans ce camp pour migrant, à Saint-Dalmas de Tende, un bâtiment désaffecté pour colonies de vacances de la SNCF qui a été ouvert en urgence quelques heures auparavant, sans autorisation, par un collectif d’associations dont la Ligue des droits de l’Homme, Amnesty international et un tas d’associations nationales et locales. L’ouverture de ce lieu a fait l’objet d’un communiqué de ces associations dans les médias. Je sais bien que mon retour vers Nice est une opportunité d’en sortir quelques-uns de ce lieu sans eau ni électricité et où la température en pleine nuit ne doit pas dépasser 10 degrés. Je décide d’en ramener chez moi et de les déposer à la gare le lendemain.
Ce sont trois filles qu’on vient d’aller chercher à l’étage. Elles sont contentes de ma proposition, me dit-on, car elles sont attendues par une association à Marseille pour être soignées. Quand je les vois, mon cœur se déchire. Elles ont peur, elles ont froid, elles sont épuisées, elles ont des pansements aux mains, aux jambes, l’une boite en faisant des grimaces de douleurs et l’autre ne peut pas porter son sac avec sa main blessée. J’apprendrais plus tard que l’une d’elles est la cousine de la jeune fille tuée sur l’autoroute vers Menton quelques semaines avant.
« Je n’ai pas réussi à les protéger »
Elles ne parlent ni français, ni anglais. Il faut marcher une centaine de mètres pour rejoindre ma voiture et cela prend très longtemps car l’une marche très difficilement. J’en profite pour essayer de savoir de quel pays elles viennent. L’Érythrée. Une fois dans la voiture, je constate qu’elles n’ont jamais utilisé de ceinture de sécurité. Je suis dans l’embarras de m’approcher d’elles, apeurées, pour leur mettre la ceinture. Elles n’ont pas peur de moi mais dans leurs yeux je lis qu’elles savent que rien n’est gagné. Il ne faut pas être un génie pour comprendre qu’au long des 6000 km qu’elles ont parcourus pour arriver jusqu’ici, elles ont fréquenté la mort et le cortège d’horreurs qu’on n’ose imaginer. Je démarre avec à mon bord ces filles dont je dois prendre soin et que je dois amener à bon port. J’éteins la radio, la situation est suffisamment incroyable.
Nous n’arriverons pas à Nice. Au péage de la Turbie, les gendarmes nous arrêtent et nous conduisent à la Police de l’air et des frontières. Ils m’ont séparé des Érythréennes. Qu’ont-ils fait d’elles ? Ce n’est pas clair, mais je ne crois pas qu’elles aient été soignées. Elles auraient été renvoyées au sud de l’Italie comme cela se pratique souvent. Les policiers m’ont dit qu’au moins l’une d’elle était mineure. Je n’ai pas réussi à les protéger.
« Mon geste n’est ni politique, ni militant, il est simplement humain »
Après 36h de garde à vue, j’ai été libéré sous contrôle judiciaire. Ma voiture a été saisie ainsi que mon téléphone. Je n’ai pas le droit de quitter Nice sauf pour emmener mes enfants à l’école mais il n’y pas de transport en commun à moins de les réveiller à 5h30 du matin. Mon procès est renvoyé au 23 novembre 2016 à 13h30, à la même audience que Cédric Herrou, membre d’associations humanitaires, qui est également poursuivi pour avoir aidé des étrangers [1].
Le lendemain de ma libération, alors que j’effectuais un point de compression sur un accidenté de la route qui se vidait de son sang en bas de chez moi, un “jeune migrant” est mort percuté par une voiture sur l’autoroute à Menton. Il a été projeté par dessus le parapet du viaduc et a fait une chute de plusieurs dizaines de mètres. Venu du bout du monde, perdu sur l’autoroute et mort à 20 km de chez moi.
Mon geste n’est ni politique, ni militant, il est simplement humain et n’importe quel citoyen lambda aurait pu le faire. Que ce soit pour l’honneur de notre patrie, pour notre dignité d’hommes libres, pour nos valeurs, nos croyances, par amour ou par compassion nous ne devons pas laisser des victimes mourir devant nos portes. L’histoire et l’actualité nous montrent suffisamment que la discrimination mène aux plus grandes horreurs et pour que l’histoire ne se répète plus, nous devons valoriser la solidarité et éduquer nos enfants par l’exemple.
Pierre-Alain Mannoni
– Lire aussi : À la frontière franco-italienne, les habitants de la vallée de la Roya risquent la prison pour avoir aidé les migrants
– A lire sur France 24 : À la frontière italienne, un Niçois jugé pour avoir transporté des migrants