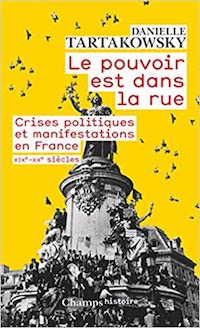À la brièveté de manifestations d’ampleur qui faisaient reculer de controversées propositions législatives ont succédé des manifs percutantes, durement réprimées, mais s’inscrivant dans la durée. Depuis le début du mandat d’Emmanuel Macron, les mobilisations et manifestations (loi travail, gilets jaunes, réforme des retraites, marche pour le climat, pour les libertés...) sont quasi permanentes. Quels ont été, et sont encore, les rôles de cette forme d’action la plus courante ? Comment l’objet manifestation a t-il évolué, alors qu’il est de plus en plus réduit à d’éventuelles scènes de violences ? Dans une société en crise, est-ce réellement la manif qui ploie, ou le système qui la fait naître ?
Basta! : Dans votre livre, vous reprenez l’histoire de la manifestation tant en France qu’à l’échelle internationale depuis les années 1970. Vous expliquez que la manifestation a longtemps été un mode de régulation des crises politiques dans le cadre du régime existant puis « un mode d’interpellation » du législateur. ». A-t-elle toujours ce rôle aujourd’hui ?
Danielle Tartakowsky [1] : De 1870 à aujourd’hui, aucun de nos régimes successifs n’est tombé ou né sous l’effet de manifestations. Entre 1934 et 1968, des manifestations en miroir ont en revanche amorcé une crise politique majeure (6 février 1934, Nuit des barricades et 13 mai 1968) puis permis d’engager le processus de sortie de crise dans le cadre du régime existant (12 février 1934 et construction du Front populaire, 30 mai 1968 et élections législatives). De 1984 à 2002, plus d’une dizaine de mobilisations nationales, de droite comme de gauche du reste, sont venues à bout de propositions de lois, de ministres qui les portaient, voire, indirectement en 1984, du gouvernement. D’où une perception du rôle de la manif comme d’un référendum d’initiative populaire.
À partir de 2003, l’affirmation de Jean-Pierre Raffarin selon laquelle « ce n’est pas la rue qui gouverne », en usant du reste du terme « rue » qui dépolitise, a marqué un coup d’arrêt. Excepté le mouvement contre le contrat première embauche en 2006 [qui a obtenu l’abrogation de la mesure, ndlr], toutes les manifestations ultérieures, quelle qu’en soit l’ampleur, ont été mises en échec. Les interactions entre les manifestants et les gouvernements, par la négociation ou une réponse politique aux revendications, sont réduites à néant, si on excepte le maintien de l’ordre, ce qui contribue à une exaspération croissante.
Il s’agit donc bien d’une séquence nouvelle qu’on ne saurait toutefois appréhender de manière univoque. Une manifestation peut produire des effets notables quoique indirects. Si les Gilets jaunes n’ont pas « gagné », ils n’ont pas « perdu » non plus. Ils ont contraint le gouvernement à des reculs et des contournements en contribuant à une reprise des luttes, sensible dans les mouvement dit des « colères » puis dans celui contre la réforme des retraites. Depuis, Macron ne fait que colmater les brèches. Et déplacer le débat là où il n’est pas.
Actuellement, les manifestations contre le projet de loi Sécurité globale contribuent à accroître les contradictions internes au gouvernement, en le mettant en difficulté. Constatons toutefois que ces manifestations ont été d’autant mieux à même de marquer des points qu’elles ont surgi à l’improviste, de l’initiative d’acteurs à divers titres inédits. Le gouvernement pris au dépourvu a dû réagir avec un temps de retard, comme au demeurant en mai 68, au risque, du reste, d’entretenir l’idée que « la lutte paie ». Un temps déstabilisé, le gouvernement a, à chaque fois, repris l’initiative en recourant à la violence. Les manifestations ont toujours une importance politique : certaines, telles celles relatives à l’urgence climatique, mettent à l’agenda des questions occultées ou minorées, et toutes contribuent à construire ou maintenir un rapport de force. Sans que cela se traduise, hormis cas exceptionnels, par des résultats immédiats.
Dans la décennie 1970, plusieurs manifestations se sont soldées par des morts, puis vint Malik Oussekine en 1986, ces événements suscitant un émoi national à chaque fois. Comment expliquez que les morts d’aujourd’hui (Rémi Fraisse, Zineb Redouane, Steve Maia Caniço…), et les dizaines de personnes mutilées, ne soulèvent pas autant les foules ?
C’est un vrai problème, un véritable questionnement. Cela n’est pas sans lien avec ce qu’on peut qualifier de « seuil de tolérance sociale à la violence ». En 1968, l’ampleur de la riposte populaire face aux arrestations d’étudiants, sans morts ni blessés graves, rappelons-le, est sans doute liée, entre autres causes, à la sortie de guerre d’Algérie, en mars 1962. Plus de deux décennies de guerres presque ininterrompues (seconde guerre mondiale, Indochine, Algérie), en tant que facteurs de « brutalisation de la société » – terme emprunté aux historiens de la première guerre mondiale – avaient provoqué un affaissement de ce seuil de tolérance. À la différence de ce qu’il est advenu en Italie ou en Allemagne, et cette fois pour des raisons qui tenaient à l’espoir d’une alternative à gauche, la violence politique est demeurée limitée durant les années 1970. Les morts advenus dans quelques manifestations (indépendantistes, viticulteurs, antinucléaires) ont été le fait de « dérapages » de part et d’autres plus que de stratégies assumées.
Lors de la manifestation contre la loi de Sécurité globale, à Paris, le 28 novembre 2020 / © Anne Paq
Or la société française est confrontée depuis 2015, et à plus fort titre depuis 2017, à un regain de violence inédit depuis la guerre d’Algérie, qu’il s’agisse de violence sociale en miroir à la violence néolibérale, de violence terroriste, de violence à l’encontre de migrants qu’on laisse se noyer par centaines, ou s’agissant de ce qui nous retient ici, de stratégies redéfinies du maintien de l’ordre ou de certains groupes manifestants. Les mots eux-mêmes ne sont pas innocents. La réactivation d’un discours « guerrier », participe d’un regain de brutalisation. S’en suit une espèce d’acclimatation à une violence, révélatrice d’une société en tension et fruit de la désespérance.
Depuis les manifestations contre la loi El Khomri [la loi travail sous la présidence Hollande, ndlr], certains médias, dont les chaînes d’info en continu, tendent à n’appréhender la question de la manifestation qu’au prisme de la violence. Cet angle d’approche qui, pour n’être pas totalement erroné, est pour le moins réducteur. Quand on montre en boucle sur BFM, toute la journée, une voiture en feu, une accoutumance s’opère chez le téléspectateur et dans de larges pans de la société. S’installe le sentiment que les victimes de violences policières l’ont bien cherché. Ce qui contribue à répondre à votre question.
Dans quelle temporalité la question des violences policière s’inscrit-elle ?
Si l’on s’en tient à l’après 1968, il faut souligner l’importance des redéfinitions des modalités du maintien de l’ordre qui se sont opérées en 2005, lors de la révolte des banlieues. Ces méthodes, en rupture avec la « doctrine Grimaud » [du nom de Maurice Grimaud, préfet de police de Paris, de 1967 à 1971, ndlr] et le principe de la mise à distance des manifestants par l’usage de gaz lacrymogènes ou de canons à eau, lui substituent une politique d’interpellation avec ce qu’elle suppose de corps-à-corps et donc de risques accrus. Ces méthodes initiées dans les périphéries urbaines ont ensuite été introduites face aux lycéens et étudiants en 2006 avant de concerner la plupart des manifestations.
La question du Black Bloc est récurrente dans les discours politico-médiatiques. Or, les sciences humaines et sociales ont décrypté depuis longtemps ses membres, son action. Pourquoi cette dernière est-elle aujourd’hui totalement dépolitisée dans les discours ?
La dépolitisation ne leur est pas spécifique comme je l’ai dit s’agissant du terme « rue », substitué à celui de manifestations dans le discours de tous les gouvernements qui se succèdent. Les discours que vous évoquez se sont affirmés à partir des manifestations contre la loi El Khomri quand la tactique dite du « cortège de tête » a donné soudain plus de visibilité et d’efficience à la présence d’un Black Bloc. Ajoutons que qualifier l’adversaire, fut-il indéniablement à l’origine de violences, de « voyous, bandits » ou même « assassins », par la voix du ministre de l’Intérieur, participe à la dévalorisation globale de ce mode d’action démocratique qu’est la manifestation. Faire intervenir les forces de l’ordre en divers points de la manifestation, interpeller à l’aveuglette des manifestants en égrainant leur nombre, d’heure en heure, sur les chaînes d’info en continu, en criant au loup, sans que l’accusation de coups et violences n’ait ensuite pu être retenue pour aucun d’entre eux, comme ce fut le cas samedi 12 décembre lors de la mobilisation contre le projet de loi Sécurité globale, est le dernier exemple en date de cette stratégie gouvernementale.
Dans votre livre, vous rappelez que le défaite de François Hollande est aussi due à sa manière de modifier le maintien de l’ordre, en « gérant les masses », sans négociation possible…
Oui, ça y a contribué, au même titre que le projet de déchéance de la nationalité. Ce sont des arguments qui ont pu peser dans l’éloignement de la jeunesse vis-à-vis du PS.
Pour en rester à la jeunesse, on a vu des images terrifiantes, ces jeunes agenouillés, ces jeunes frappés devant leurs lycées pendant les blocus… Envoyer directement les forces de l’ordre sur des mineurs, c’est nouveau ?
Si on met de côté les manifestations interdites pendant la guerre d’Algérie, on pourrait évoquer de nombreuses interpellations aux portes de lycées ou sur le boulevard Saint-Michel lors de distributions de tracts appelant à manifester contre la guerre au Viêt Nam. Les jeunes étaient alors relâchés quelques heures après et il n’y avait pas de risques « physiques ». Depuis la guerre d’Algérie, on n’a jamais assisté à un climat répressif comme celui que nous traversons. C’est très préoccupant. Depuis 2005, la priorité va à l’interpellation, on a clairement basculé dans le corps-à-corps et la provocation.
Les brutalités policières, légitimées par le pouvoir, obligent-elles les manifestants à répondre en miroir ? Tout en sachant qu’il y a obligatoirement une asymétrie de la violence, étant donné les armes à disposition des forces de l’ordre.
Il est indéniable qu’elles y contribuent, comme on l’a vu lors des manifestations contre la loi El Khomri où s’est opérée une porosité entre Black Bloc et syndicalistes face à un assaillant qui frappait sans discriminer, ou lors de nombreuses manifestations de Gilets jaunes. La violence est toutefois souvent l’énergie du désespoir et le prix à payer de cette asymétrie. Il revient au gouvernement et à son ministre de l’Intérieur d’engager une politique de désescalade, qui prévaut avec succès dans tous les pays voisins, quand c’est au contraire, chez nous, l’escalade qui prévaut.
Certains syndicats ou des coordinations de lutte peuvent appeler, très ponctuellement, à ne pas manifester à cause des risques de répression. Cela s’est vu samedi 12 décembre, où la coordination contre la loi Sécurité globale a appelé à ne pas manifester à Paris. Cela s’est-il déjà vu par le passé ?
Sauf erreur de ma part, je ne vois guère de précédents sous cette forme. Un appel à ne pas manifester faute de pouvoir garantir la sécurité des manifestants menacée par les stratégies déployées par le préfet de police… C’est inquiétant qu’il faille en arriver là. En même temps cela met à nu la spécificité parisienne qui tient à la présence du préfet Lallement, qui radicalise à l’outrance une politique de maintien de l’ordre déjà globalement inquiétante. Les violences advenues ou provoquées à Paris ne sauraient masquer qu’en régions, des manifestations d’importance se sont déroulées en ces circonstances comme en d’autres sans heurts majeurs hormis de rares exceptions.
Dans des périodes de forte répression, d’autres formes d’actions, de luttes, ont-elles surgi ?
La manifestation n’a jamais été exclusive d’autres formes d’action. Les mutations formelles des mouvements sociaux ne doivent pas tout à la répression. Les manifestations de salariés n’ont été longtemps que des appendices de la grève qui était première. Beaucoup d’entre elles le sont encore. Or il faut bien être conscient que des manifestations font d’autant plus aisément plier le gouvernement qu’elles sont sous-tendues par une grève généralisée ou déployée dans le secteur stratégique des transports, qui pèse sur l’économie, comme en 1936, 1968 ou encore en 1995. Le déclin des grèves qui s’est amorcé au tournant des années 1970 a contribué à des modifications durables qui s’expriment entre autres, depuis 1995, par des séquences de manifestations réitératives durant plusieurs semaines, plusieurs mois ou, s’agissant des Gilets jaunes dont la sociologie excluait qu’ils recourent à la grève, près de deux ans.
La démultiplication des acteurs qui recourent à la manifestation est également à l’origine de novations. Ce que le sociologue Charles Tilly a nommé le « répertoire d’actions » s’est élargi cette dernière décennie avec l’occupation des places. Les occupations jusqu’alors essentiellement limitées aux entreprises ou universités se sont déplacées dans l’espace public dans des dizaines d’États. Avec en France les Veilleurs, en marge de la Manif pour tous, Nuit Debout, ou les ZAD. Cette modalité d’action dont les acteurs sont souvent composites s’inscrit pareillement dans la durée quoique sur un autre mode, et permet la construction d’un collectif au nom d’un changement qui se revendique en faveur d’un « ici et maintenant ». Mais la temporalité de l’occupation dépend de la maîtrise de l’espace. Qu’on excepte les ZAD où des compromis sont advenus avec les pouvoirs publics, l’évacuation signifie la disparition de ce présent recomposé. Enfin, de nombreuses manifestations se déploient à une échelle planétaire à partir de questionnements mondiaux, qu’il s’agisse de l’urgence climatique ou du racisme.
Le droit de manifester est-il en danger ?
Les organismes internationaux de protection des droits humains nés de l’après-guerre ont associé étroitement la liberté de manifestation à la démocratie en considérant la première comme une condition essentielle de l’existence de la seconde. Et réciproquement. La liberté de manifestation, tenue comme une forme de concrétisation d’autres libertés, dont celles d’expression, de pensée de conscience et de religion, ou encore d’association, a ainsi fait l’objet d’une reconnaissance ferme et généralisée en droit international des droits humains. Principalement à travers la liberté de réunion qui l’englobe, régulièrement réitérée. La Cour européenne des droits de l’Homme considère ainsi, que « la liberté de réunion et le droit d’exprimer ses vues à travers cette liberté font partie des valeurs fondamentales d’une société démocratique ». Il paraît peu probable que ces principes soient explicitement remis en cause, du moins dans le temps court. Mais ils n’excluent pas la multiplication des contraintes et restrictions, autorisées par l’état d’exception qui tend à devenir la norme, et les politiques visant à dissuader de se rendre dans une manifestation, ou de la rendre invisible, hormis quand il s’agit de l’assimiler à l’action de « barbares »… Soulignons toutefois que ni l’Occupation allemande, de 1940 à 1944, ni aucun état d’urgence, qu’il soit la conséquence de la guerre d’Algérie ou de la pandémie, n’ont jamais suffi à empêcher les manifestations. Quel qu’en soit le prix. Ceci vaut aussi bien pour des dizaines de pays dictatoriaux ou illibéraux.
Alors est-ce la manifestation qui est en crise, ou le système néolibéral ?
Ce que j’ai voulu montrer dans mon livre, c’est que depuis un demi-siècle, la majorité des manifestations, en France et ailleurs, sont des réponses à la crise de l’état social puis aux crises du néolibéralisme cependant que la politique des gouvernements successifs, attachée depuis 2005 à les mettre en crise, s’essaie à redéfinir les liens qu’elles ont longtemps entretenus avec la démocratie. Ces phénomènes sont concomitants.
Comment envisagez la suite, avec ce glissement très à droite qui s’opère ?
De crise en crise, le gouvernement ne fait au mieux que colmater les brèches et persiste dans ses orientations stratégiques, même s’il lui faut parfois les repousser à plus tard. Si certains des mouvements en cours ont contribué aux victoires locales remportées par les Verts lors des dernières élections municipales, leur ampleur globale n’a suscité aucun prolongement politique. À cette heure, Emmanuel Macron ne se sent pas menacé par les présidentielles qui arrivent et qui sont son horizon. Oserons-nous dire qu’il reste un peu plus d’une année pour qu’il en aille autrement ?
Propos recueillis par Elsa Gambin
Photo de une : Lors de la manifestation contre la loi de sécurité globale, à Paris, le 28 novembre 2020 / © Pedro Brito Da Fonseca

On est là ! La manif en crise, éditions du Détour, octobre 2020, et de Crises politiques et manifestations en France XIXe-XXe siècles, Le pouvoir est dans la rue, Champs Flammarion, août 2020.