Basta! : Une nouvelle loi anti-casseurs adoptée en vitesse, une profusion de commentaires s’indignant de la violence des manifestations sur les plateaux télés, et même un défilé, celui des « foulards rouges », dont le mot d’ordre est « stop à la violence »… Que vous inspire cette focalisation sur la violence du mouvement des gilets jaunes qui en arrive à son troisième mois de mobilisations ?
François Cusset [1] : La violence est avant tout celle que subissent les gilets jaunes : non seulement de la police, avec 300 blessés graves en trois mois, mais aussi des bons bourgeois et des nouvelles lois liberticides. Le rôle désormais central de l’image permet de réduire un mouvement social à ses exactions, ou à sa défense active, aux dépens de ses autres aspects. Les images des détériorations, de l’Arc de triomphe à Paris par exemple, et celles des visages tuméfiés des manifestants après l’usage d’armes par la police circulent plus facilement, mais elles ne résument en rien le mouvement actuel.
Et n’oublions pas que certaines dégradations sur la voie publique, comme les vitrines d’agences bancaires cassées ou les barricades érigées dans les quartiers chics de la capitale, ont un sens plus politique. En ne retenant que ces images, on ne fait plus la différence, et on rabat la résistance sociale sur le nihilisme ou la brutalité d’État : ce n’est pas du tout la même chose. Les dégradations de l’Arc de triomphe relèvent du défi, du vandalisme bravache. Les barricades sur la voie publique sont plus proches de l’action d’autodéfense collective.

La question de la violence n’est pas un thème en soi. Nous sommes face à diverses formes, complémentaires, d’expression de la contestation. La voiture brûlée ou le cordon policier défié font partie d’une panoplie d’ensemble, qui va de l’indocilité à la mise en œuvre d’alternatives collectives en marge de la société, en passant par la subversion depuis l’intérieur du système économique. Et, tout simplement, comparer quelques voitures de sport enflammées et des abribus brisés avec les ravages systématiques du néolibéralisme dans les vies depuis 40 ans est absurde. Une telle violence systémique engendre mécaniquement une contre-violence réactive, dérisoire dans ses moyens mais photogénique. Pour l’essentiel, cette violence s’exprime sur des objets ou des façades.
Dans l’expression du mouvement, l’occupation de certains lieux, des rond-points à l’Ouest parisien, qui concentre de nombreux lieux de pouvoir politiques et économiques, a été l’un des modes d’action privilégié. Comment l’analysez-vous ?
La contestation, en 25 ans, est passée du social au territorial. Les logiques de classe et les identités politiques sont brouillées. Elles sont donc remplacées par un enjeu d’occupation territoriale, comme lors du mouvement Occupy Wall Street aux États-Unis ou les occupations de place en Europe – en Grèce et en Espagne – et dans le monde arabe. Sur les ruines des mots d’ordre politique antérieurs, en crise, il s’agit pour les manifestants de recréer du commun : soit dans des territoires abandonnés par le pouvoir – c’est le cas dans certains quartiers populaires d’Athènes ; soit dans des lieux qui incarnent symboliquement l’opulence, où il est logique de venir braver le pouvoir, comme sur les Champs-Élysées et ses environs ; ou encore dans des endroits qui sont des sites de résistance, comme les « zones à défendre » (ZAD). A Notre-Dame-des-Landes, nous avons assisté à une autre forme d’occupation du terrain, avec des personnes qui s’approprient et cultivent un lopin de terre, se battent pour un territoire sur lequel elles expérimentent des formes d’existence collective.
Avec les gilets jaunes, le défi territorial est sans précédent : jamais les beaux quartiers de Paris n’avaient été occupés par une foule aussi longtemps et de manière aussi répétitive, même pendant les épisodes révolutionnaires. Dès le début de la Commune [du 26 mars au 28 mai 1871, ndlr], l’ouest parisien avait été repris par les « Versaillais ». Cette occupation répétée au fil des « Actes » et des semaines comporte une dimension symbolique – aller sous les fenêtres du pouvoir et de ses lieux – et une signification politique : quand on estime n’avoir plus rien à perdre et personne à qui confier sa représentation – ni parti, ni organisation, ni institution –, le défi est d’aller occuper assez longtemps le terrain adverse pour qu’il se passe quelque chose. Relever ce défi suppose de nouer un lien collectif sur place et de poser ensemble la question du commun : la question de ce que l’on fait là, tous, à cet endroit précis.
La première victoire des gilets jaunes n’est-elle pas de rendre visible, au moins temporairement, la violence économique et sociale que subissent nombre de personnes ?
C’est l’aspect incontestablement le plus fécond du mouvement. C’est aussi son ferment révolutionnaire. Il a rendu visible les dégâts sociaux du capitalisme, la paupérisation, la souffrance, et créé sur cette base du commun. Il démontre en actes que cette guerre sociale peut être un socle collectif, le point de départ d’un combat plus solide et ancré, que les motifs antérieurs de lutte, davantage liés à des options partisanes ou à des identités précises à défendre. Celles-ci n’ont pas disparu. Elles sont – en partie – suspendues, mises sous silence, au moment de rejoindre l’endroit où l’on va manifester : dans les cortèges, on aperçoit peu de drapeaux, aucun signe d’affiliation politique.
La présence de l’extrême-droite suscite pourtant l’inquiétude...
En regardant en détail les accoutrements, on peut repérer dans la foule des militants d’extrême-droite. Et puis certains fascistes attaquent des groupes d’extrême-gauche. Mais dans l’ensemble c’est un mouvement dont la composante déjà politisée, qui semble minoritaire, a choisi de taire sa provenance politique, parce que la majorité l’exige : si vous êtes avec nous c’est sans récupérer notre mouvement. Les gilets jaunes musulmans, hélas trop rares, comme les gilets jaunes islamophobes, laissent en quelque sorte au vestiaire leur appartenance politique ou religieuse pour rejoindre le mouvement, le temps d’un samedi.
Cette suspension tactique des identités intervient pourtant dans un monde très identitaire – par la politique, la religion, la nation, l’origine. Mais la pregnance du contexte, l’élan des circonstances sont si forts qu’ils relèguent au second plan les identités antérieures, et constituent un peuple capable de coordonner son action pour affronter le pouvoir. La suspension de ces appartenances fait la puissance du mouvement, mais ne règle pas tout : la suspension des identités ne fait pas une nouvelle identité. Elle est aussi une limite.
Si les identités politiques ou syndicales sont suspendues le temps du mouvement, dans quelle héritage historique s’inscrit-il ?
La référence explicite et spontanée, dans les discussions du samedi, à des épisodes révolutionnaires antérieurs – 1789, 1848, Mai 68 – exprime la raison qui les guide : face à une injustice sociale sans précédent, nous n’avons rien à perdre et le pouvoir va finir par céder. On a parfois l’impression d’un clin d’œil aux ancêtres, d’une sorte de connivence historique avec leurs homologues d’il y a deux siècles. Qu’ils aient à l’époque pu révoquer puis guillotiner un roi sous-tend la foi des gilets jaunes : tant que nous tiendrons le pavé ensemble, nous avons une chance que le pouvoir cède.
Le contexte politique bien sûr n’est plus le même. Nous vivons aujourd’hui dans un système politique et institutionnel entièrement bloqué par un chantage moral, qui est en réalité idéologique : soit le libéralisme autoritaire et l’austérité bruxelloise, la ploutocratie sans espoir, soit le 3e Reich à la française, ou la rafle du Vel d’Hiv. Du moins tel qu’a été présenté le deuxième tour de la dernière présidentielle. Le système est figé dans cette alternative, imposée comme le seul choix effectif.
La « contre-violence » des gilets jaunes répond, dîtes-vous, à la violence systémique du néolibéralisme… Pourquoi celle-ci paraît-elle presque invisible dans le débat public ?
Le terme violence est trompeur, il évoque le déclenchement d’un coup : une violence vient soudain briser le temps ordinaire. Or, la violence systémique du capitalisme néolibéral est à ce point présente dans les normes et les lois, les inconscients ou les courtoisies de façade, qu’elle en devient ordinaire, structurelle : le stress, la dépression, la haine de soi, la rivalité, la tension sociale, la pollution et la destruction de la vie.
Attention cependant à ne pas sombrer dans le simplisme mono-causal : ces « violences-monde », comme je les appelle, n’ont pas une cause unique, mais des causes multiples et parfois ancestrales, comme pour les violences sexistes et sexuelles. Les violences environnementales, inter-ethniques ou encore sexuelles ne sont pas des objectifs directs et conscients du système économique. Il s’en accommode, voire cherche à en tirer profit, à faire son miel des autres violences – comme le disait Naomi Klein du « capitalisme du désastre » et de sa « stratégie du choc ».
C’est à dire ?
Une catastrophe environnementale ou un attentat terroriste ne sont pas provoqués sciemment par « le système », évidemment. Mais une fois que le désastre a lieu, le système économique se saisit de l’aubaine pour imposer un « ajustement structurel » [des privatisations, des coupes budgétaires, des baisses de salaires, une réforme néolibérale des retraites ou des protections sociales, etc., ndlr]. Il est plus facile d’imposer un cran supplémentaire de paupérisation, de paranoïa sécuritaire ou d’objectif de rendement après un tremblement de terre ou un krach boursier qu’après une élection. La violence est au cœur de la genèse historique du capitalisme, elle n’est pas seulement un heureux accident, elle est aussi une origine sans cesse reconduite : le capitalisme moderne est né, il y a un demi-millénaire, de la traite négrière et de la colonisation.
On a voulu nous faire croire que le commerce adoucissait les mœurs. Le plus souvent, c’est la violence qui le stimule. On a oublié qu’en quatre années de mobilisation dans la deuxième guerre mondiale, entre 1941 et 1945, les États-Unis ont doublé leur PIB. Il faut se défaire de l’idée que la violence est une exception au sein du système économique. Jamais le système économique actuel ne s’est autant accommodé de ces violences ou en a été aussi directement partie prenante. Augmenter les rendements nécessitera toujours d’augmenter les contraintes, donc la violence.
Qu’a changé le tournant « néolibéral » dans la manière de ressentir et de subir cette violence ?
Entre le début des années 1970 et la fin des années 1980, le système économique dominant évolue. C’est d’abord l’extension à toute la planète de ce régime économique, et à toute l’existence de la valeur marchande. C’est aussi le déclin, voire la destruction, des gardes-fous qu’avait inventés ou laissés se développer le capitalisme et qui compensaient sa dureté : l’État providence, notamment, dont la période de gloire se situe après la seconde guerre mondiale, avec ses systèmes éducatifs et de protections sociales universels et accessibles. La privatisation en cours de ces systèmes, ou l’introduction dans leur fonctionnement d’une logique exclusivement comptable, le retrait de l’État d’autres missions, mettent fin à ces gardes-fous. Ce qu’on peut appeler la radicalisation du capitalisme consiste dans le règne sans partage de ses dogmes et dans la disparition de ces contrepoids. Nous payons aujourd’hui le prix très lourd d’une telle évolution.
Dans les autres formes de violences, quasi invisibles médiatiquement, vous évoquez la « violence évaluatrice » et « la contagion sociale du stress », en particulier dans le monde du travail. Comment s’exerce-t-elle ?
La violence évaluatrice est une violence du temps ordinaire : elle ne fait pas exception, elle ne laisse pas de traces, ni trauma, ni effusion de sang. Beaucoup d’évaluations, prises isolément, ont une raison d’être, pour l’évolution de carrière, le bilan de santé, etc. Le problème est la démultiplication de ces évaluations, leur flicage inutile et pesant, le fait qu’elles structurent notre vie quotidienne, de la naissance à la mort. Nous sommes évalués de l’école maternelle jusqu’à la retraite ; évalués par le bulletin scolaire, pour trouver du travail, pour mériter le chômage, pour que la police et la justice s’assurent de notre vertu. Notre état de santé est évalué constamment par les assurances...
Il existe aussi une auto – et une inter – évaluation permanente, parfois anxiogène parfois divertissante, pour laquelle les réseaux sociaux jouent un rôle essentiel, avec le recueil de données sur nos comportements qui sont ensuite commercialisées. Le terme d’évaluation fait partie de ce langage châtié qui permet de voiler la violence du geste. Or, l’évaluation permanente est un processus de destruction de l’autonomie, pour l’évalué comme pour l’évaluateur : c’est de l’extérieur, contre l’intéressé, qu’on va désormais définir la valeur de quelqu’un.
Comment digérer ou extérioriser ces « violences monde » et « cette violence du temps ordinaire » que vous décrivez dans votre livre ? Comment la réguler ?
On pourrait réduire le rapport à la violence de chaque sujet à un double flux de violence « entrante », ce qui fait violence à quelqu’un, et de violence « sortante », ce que cette personne fait de cette violence et la manière dont elle l’extériorise, la sublime, la compense – ou juste la « gère », comme disent les jeunes. Car cette extériorisation se fait, depuis toujours, selon deux modes principaux. Par la culture et la sublimation d’abord, qui permettent de renvoyer vers l’extérieur (fiction, spectacle) les passions et les violences subies par nous-mêmes, pour nous en soulager, comme le font le cinéma, les séries télé, le théâtre, mais aussi le sport qui accomplit une catharsis énergétique et physique. Mais une autre manière de l’extérioriser consiste à en transférer la responsabilité, à imputer à un groupe donné le mal que nous subissons : de l’employé malmené qui va se défouler sur son épouse, jusqu’au transfert vers des boucs-émissaires raciaux ou religieux. La liste des bouc-émissaires historiques est longue : les juifs, les musulmans, les roms, les homosexuels, les bobos, les États-Unis, les Chinois...
Nous vivons une crise simultanée de ces deux formes de régulation de la violence. La catharsis culturelle est rendue difficile par l’explosion quantitative et qualitative de la culture de l’image, elle-même porteuse de violence. Et la sublimation n’est pas la même lorsque nous sommes spectateurs et lorsque nous interagissons. La promesse d’interactivité elle-même, via les réseaux sociaux par exemple, produit aussi de la frustration – je n’ai pas suffisamment de « like ». Reste le transfert émotionnel vers des victimes expiatoires. Dans un monde en crise et déstabilisé, c’est la porte ouverte aux démagogues et aux charlatans. Et le risque du pire, fascisme ou ultra-patriotisme.
Propos recueillis par Ivan du Roy
Photo : Lors de l’Acte XIII des gilets jaunes,le 9 février / © Serge d’Ignazio
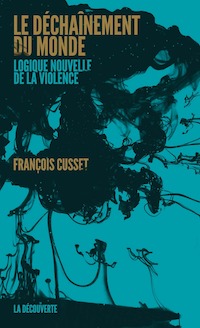
A lire : Le déchainement du monde, logique nouvelle de la violence, éd. La Découverte, 237 pages.








