Basta! : Le Front de mères , association que vous avez fondée, s’est mobilisé initialement pour que les enfants de Bagnolet, en banlieue parisienne, aient accès à des repas végétariens de qualité à la cantine. Pouvez-vous nous raconter la genèse de cette aventure, et les difficultés que vous avez rencontrées ?
Fatima Ouassak [1] : Au départ, je m’intéresse à l’alimentation de mes enfants. C’est un sujet qui est très important pour moi. Je les ai longtemps allaités, je souhaite continuer à prêter attention à ce qu’ils mangent, et aimerais qu’ils puissent avoir accès à des repas végétariens de qualité. J’entendais aussi des mamans dire à leurs enfants, quand elles les amenaient le matin à l’école, de ne pas manger de viande à la cantine. J’imaginais combien il devait être difficile pour ces enfants de se confronter ensuite aux adultes encadrants, leur sommant d’au moins « goûter » leur viande le midi.
Je suis spontanément allée rencontrer les associations de parents d’élèves mais j’ai tout de suite été accusée d’être malhonnête, d’avancer masquée, d’être communautariste. J’étais pourtant entièrement concentrée sur l’intérêt général à savoir celui des enfants, et n’avais pas du tout l’intention de faire de politique. Mais j’ai immédiatement été disqualifiée, de par mon origine sociale. Et avec moi, les autres mères qui me soutenaient. Au même moment, il y a eu le vaste mouvement de la Manif pour tous, qui m’a stupéfaite. J’ai réalisé que les défenseurs d’une conception traditionnelle de la famille française étaient très bien organisés politiquement. Et je me suis dit qu’il fallait que nous le soyons aussi. Nous avons donc décidé de créer cette association, le Front de mères. Ce faisant, nous perpétuons une tradition méconnue : en France, les mères descendantes de l’immigration n’ont aucune réticence à s’organiser collectivement et solidairement sur les enjeux politiques qui concernent leurs enfants et à mener des luttes. C’est important de le rappeler car les représentations dominantes de l’immigré.e sont celles d’un tempérament passif et inoffensif.
Vous avez, en quatre ans, déjà fêté plusieurs victoires…

Il est rare que les mobilisations populaires aboutissent. C’est une des raisons pour lesquelles, beaucoup de gens ont du mal à se mobiliser. L’autre raison, c’est que l’on valorise trop peu les victoires. Ce n’est pas notre cas ! Quand nous avons réussi à faire réparer les ascenseurs avec le Front de mères, nous avons fait la fête pendant une semaine ! Et cette rentrée, les enfants de Montreuil et de Bagnolet devraient avoir accès à des menus végétariens de qualité.
Au fur et à mesure, le Front de mères a pris de l’assurance, et les sujets de lutte se sont étoffés. Des inégalités scolaires aux discriminations raciales en passant par les violences policières, vous avez décidé de lutter « contre tout ce qui opprime vos enfants ».
Oui, nous avons peu à peu réalisé que toutes ces problématiques étaient liées, que nos enfants n’avaient pas accès à tous les droits, parce qu’ils vivent dans des quartiers populaires et qu’ils sont originaires de familles descendantes de l’immigration. Commençons par l’école. Notre système scolaire est inégalitaire, et discriminatoire envers les personnes racisées. C’est parfaitement documenté et chiffré. Prenons un exemple : les élèves de Seine-Saint-Denis perdent en moyenne une année entière de scolarité par rapport aux autres élèves de France car les enseignants y sont moins remplacés en cas d’absence. Il y a aussi, en région parisienne, une stratégie massive d’évitement de certains établissement qui fait qu’il n’y a plus de mixité sociale. Tout cela réduit l’horizon de nos enfants. Mais pour moi, cela a une fonction : l’école sert à alimenter le sous-marché du travail, dont on a brusquement pris conscience au moment du confinement.
Vous insistez sur l’importance du lien parents/enfants et revendiquez une solidarité entre générations au sein des quartiers populaires. Qu’est-ce que, concrètement, cette solidarité permet-elle ?
On sait que les discriminations raciales ont des effets notables sur la santé des enfants, et que le déni des parents accentue encore ces effets négatifs. Je pense donc que les parents ne doivent pas être dans le déni. Il faut associer nos enfants à la lutte contre l’injustice. « Si je ne me résigne pas, toi non plus ! », leur disons-nous en substance. Pour moi, les mères doivent avoir un rôle subversif, aux côtés de leurs enfants. Citons l’exemple typique de l’appel au calme quand il y a des violences dans les quartiers : à chaque fois, les médias et les institutions interpellent les mères pour savoir si elles vont appeler au calme, comme si notre rôle consistait à dire à nos enfants de se résigner, de ne pas se rebeller, se soumettre à un ordre social que l’on sait injuste.
Sur cette question des appels au calme quand nos banlieues s’embrasent suite à la mort d’un jeune, par exemple, je dis « non ! » : il est hors de question d’appeler nos enfants à se taire. Notre rôle, c’est plutôt de dire, de marteler qu’un enfant est mort. C’est ça le sujet. Se souvient-on simplement du nom de celui qui est mort ? Peut-on parler de cette personne ? De ses parents et de leur immense chagrin ? Est-ce permis ?
Notre rôle de mère, c’est de soutenir et protéger nos enfants, de nous organiser collectivement, et solidairement, pour qu’ils soient heureux. Je pense que c’est un projet qui tient la route.
Vous affirmez par ailleurs que l’écologie doit être un point central de l’affirmation politique des quartiers populaires, mais soulignez qu’il est difficile pour les habitants de ces quartiers de s’intéresser à ces questions. Pourquoi cette difficulté ?
Il faut d’abord rappeler les conditions matérielles difficiles de beaucoup d’habitant.es de ces quartiers. Beaucoup de femmes, notamment, élèvent seules leurs enfants, occupent des emplois précaires, ont des horaires de travail hachés. Dans les quartiers populaires, on a moins de ressources – temps, argent, moyens de garde pour les enfants – pour participer aux rencontres, réunions, ateliers. Il ne faut pas oublier que nous, descendants d’immigrés, n’avons aucun pouvoir, et que nous ne sommes pas considérés comme étant chez nous, même après 70 ans de présence. C’est même ce qui fait notre singularité en France.
Par ailleurs, résister, c’est difficile. Ceux qui parlent de désengagement politique dans les quartiers populaires ignorent le coût de cet engagement. Quand j’ai commencé à revendiquer des repas sans viande pour la cantine, dans un souci de bien être des enfants, j’ai subi une véritable guerre psychologique, avec une disqualification tranquille de ma parole. C’était difficile, alors, de me dire que je devais continuer. C’est pourquoi, jamais je n’accuserai les personnes qui ne se mobilisent pas de trahison ou de lâcheté.
Vous dîtes aussi que vous ne vivez pas dans les espaces où l’écologie s’organise. C’est-à-dire ?
Prenons l’exemple des associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (Amap) : elles sont souvent situées dans les quartiers pavillonnaires. Même quand les distributions ont lieu au pied des tours, les habitants de ces tours ne se sentent pas concernés. Il y a une manière de discuter, de formuler ses idées, de discourir, propres aux classes sociales supérieures, souvent blanches.
Il faut regarder les choses en face : l’écologie en France est une écologie de classe. Elle s’accompagne de discours savants sur des questions nobles – le nucléaire, le réchauffement climatique, la transition écologique –, questions le plus souvent énoncées de manière très technique. Elle est généralement totalement déconnectée de la question sociale, du moins du point de vue des classes et des quartiers populaires. Elle s’organise autour des projections établies par les CSP + [catégories socio-professionnelles supérieures, ndlr] dans des termes abstraits, lointains, et désincarnés qui ne remettent jamais réellement en question le système capitaliste et colonial à l’origine du désastre écologique.
Vous évoquez également le mépris de certains écologistes pour les habitants des quartiers populaires...
Prenons un exemple : quand des écologistes débarquent dans le quartier un samedi matin, portant un petit gilet vert et des gants en plastique pour venir nettoyer le quartier, en « solidarité » avec les habitants. Les hommes en vert n’ont souvent jamais nettoyé leur salle de bains de leur vie, ce sont les femmes qu’ils viennent civiliser qui ont la charge de le faire pour eux contre des salaires de misère. Mais aujourd’hui, ils viennent avec leur petit gilet vert pour nous aider à être propres.
Il y a aussi les discours prétendument écologistes autour de la menace d’une explosion démographique, qui relèvent en réalité d’une guerre de territoires. Dans ces mêmes discours, on trouve l’imminence de l’effondrement écologique. Même quand on est conscient de la gravité de la situation actuelle, c’est assez difficile à entendre pour les descendants de mondes effondrés par la férocité coloniale et capitaliste, et qui vivent aujourd’hui dans les quartiers populaires. Cette tendance à ne qualifier la catastrophe que lorsque les classes dominantes blanches sont effectivement ou potentiellement concernées peut s’apparenter à du harcèlement moral à grande échelle.
Revenons au rôle des mères, sujet central de votre livre. Vous dîtes que, au moment de la genèse de votre association, vous n’étiez « qu’une mère. C’est à dire dans la société actuelle, presque rien. » Qu’est-ce que cela signifie ?
À longueur de temps, d’articles, de livres, de films, on essaie de nous faire croire que nos corps sont faibles quand on est enceinte, quand on accouche, quand on allaite. Nous sommes considérées comme des moins que rien, incapables de décider quoi que ce soit. Mais on pourrait décider que ce sont, au contraire, des périodes d’immense puissance. Personnellement, je ne me suis jamais sentie aussi forte que quand j’étais enceinte, puis en train d’allaiter. Et je ne suis sans doute pas la seule. Allaiter, ce pourrait être perçu comme un acte anticapitaliste. On nourrit son enfant, seule, et on le fait grandir et s’épanouir sans rien payer à personne. Ce pourrait être considéré comme quelque chose qui nous émancipe.
Mais en France, on considère que le rôle de mère est stigmatisant pour les femmes. Être mère, c’est presque antiféministe. Les oppressions que l’on subit en tant que mères sont considérées comme moins nobles que celles des femmes en général. Ajoutons que le féminisme français est très parisien et très intellectuel. Les femmes des classes populaires n’y sont généralement pas associées.
Je trouve que la question des mères est un thème fédérateur, qui pourrait être au centre des luttes. Au sein du mouvement des Gilets jaunes, il y avait beaucoup de mères qui se mobilisaient pour leurs enfants. Il y avait aussi beaucoup de mères seules, qui sont en première ligne de toutes les précarités. Dans une période où l’on cherche la division, et où on nous enferme dans des pièges sémantiques, j’aimerais en faire une figure politique universelle, et populaire.
Propos recueillis par Nolwenn Weiler
Photo : © Anne Paq
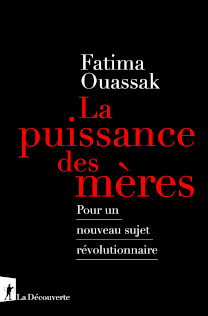
« La puissance des mères, pour un nouveau sujet révolutionnaire », de Fatima Ouassak. Editions de la Découverte. 144 pages. 14 euros.








