« Chiner les Roms. » Cette expression, c’est Youri, 18 ans, qui l’a soufflée à Lise Foisneau. Depuis, l’anthropologue se l’est appropriée. Difficile en effet de trouver phrase plus juste pour résumer le travail qu’elle a mené pendant ces quatre années passées sur les routes aux côtés de Roms de Provence.
De son enquête en itinérance, Lise Foisneau a tiré un livre, Kumpania – Vivre et résister en pays gadjo, paru aux éditions Wildproject. Elle y décrit le quotidien de Roms dits « hongrois » qui, arrivés en France à la fin du 19e siècle, circulent sur une partie de ce territoire dont ils habitent les interstices – faute de pouvoir se déplacer et s’installer librement.
Changer la focale. Raconter l’histoire de ce groupe « par en bas », à partir des représentations de celles et ceux qui le composent : c’est ce qui fait, entre autres, la portée politique de Kumpania. Manière de fouler au pied un antitsiganisme fermement ancré et de rappeler qu’en dépit des discriminations essuyées, les Roms de Provence continuent de s’organiser.
Pour Lise Foisneau, c’est certain : « Au détour d’une route, sur un parking, sur un stade, dans un champ, les Roms montrent que des collectifs […] n’ont pas encore capitulé face à la machine politique et hiérarchique. » Entretien.
CQFD : Votre livre s’intitule Kumpania : qu’est-ce que cela signifie ?

Lise Foisneau : Chez les Roms de Provence, le mot kumpania (compagnie) désigne l’ensemble des personnes et des choses (humains et non-humains, animaux, objets) réunies dans un lieu. C’est un voisinage choisi qui compose un monde singulier – monde en quelque sorte imbriqué dans celui des gadjé [1]. Contre le préjugé qui assigne les Roms à un mode de vie familial de type organique, mon livre décrit un collectif [2] dont les principes politiques sont beaucoup plus égalitaires que ceux de la société majoritaire.
Les stéréotypes qui naturalisent les formes d’organisation collective des Roms sont des constructions étatiques liées à des politiques répressives. Dès 1912, les gouvernements français successifs ont en effet mis en place des dispositifs de contrôle et de surveillance de personnes d’abord catégorisées comme « nomades », puis comme « gens du voyage » dans les années 1970. La rhétorique familialiste de l’État postule que c’est la « famille », de préférence la famille élargie, qui soude ces collectifs.
Réduire ainsi des modes d’organisation collective alternatifs à des liens du sang est une stratégie efficace de dépolitisation. En intitulant mon livre Kumpania, j’ai voulu montrer que le monde du voyage français est un monde éminemment politique, qui s’organise en fonction d’un souci de justice et de bien commun, et dont l’une des formes particulièrement emblématiques est, justement, la kumpania.
Mais une précaution s’impose : cette ethnographie ne porte que sur un fragment du monde du voyage et ne peut pas être généralisée à l’ensemble des collectifs romani et voyageurs. Kumpania décrit la vie de Roms qui sont Français depuis 150 ans, voyagent la plupart du temps en Provence, et sont catégorisés par l’État comme “gens du voyage” ; tandis que les autres Voyageurs les appellent les « Hongrois ». Ils ont été nommés ainsi, à la fin du 19e siècle, par les Manouches qui les ont désignés en fonction de l’endroit où ils avaient voyagé précédemment, à savoir l’Empire austro-hongrois.
Cette façon de « faire collectif » sans représentant ni chef, désarçonne les gadjé, a fortiori les forces de l’ordre auxquelles, comme vous l’écrivez, « il ne vient pas à l’idée que les compagnies puissent ne pas être dirigées »…
Lorsque des caravanes s’installent dans un nouveau lieu, leurs habitants – qu’ils soient Manouches, Roms, Gitans, Sinti, Yéniches ou Voyageurs – font une expérience commune : il y a toujours un policier, un gendarme, un voisin gadjo ou un représentant de l’administration pour demander à parler au chef, au responsable ou au représentant.
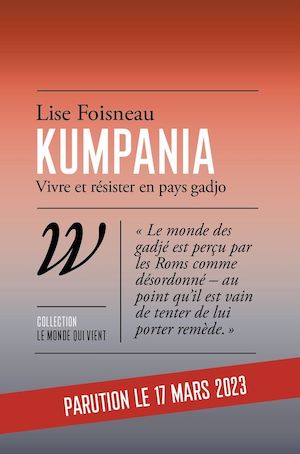
À l’arrivée des caravanes, un observateur non averti a grand mal à imaginer qu’elles ne soient pas organisées et coordonnées par une personne qui dirigerait les autres. Or, en voyageant avec les Roms de Provence, j’ai pu constater que les personnes qui habitent ensemble en caravane, pendant quelques jours ou quelques semaines, ne s’organisent pas de manière hiérarchique ou pyramidale.
Par exemple, lorsqu’ils s’installent sur une « place », c’est-à-dire un lieu non aménagé, les habitants de chaque caravane agissent en toute autonomie. S’il y a des règles à respecter pour que la vie en commun soit possible, personne ne joue un rôle plus important que les autres. D’ailleurs, si l’un des membres de la compagnie s’avise de se comporter en chef, la réponse ne tarde pas : le plus souvent, les caravanes se dispersent et ce pouvoir naissant est dissout.
Plus d’une fois, j’ai vu des gendarmes ou les gérants de magasins près desquels nous étions installés demander à parler au « patriarche » : non seulement, les habitants des caravanes devaient être dirigés, mais ils devaient l’être par un homme – au stéréotype hiérarchique s’ajoutant le stéréotype patriarcal.La réalité est que les compagnies avec lesquelles j’ai voyagé ne reconnaissent pas de chef, pas de tête : elles sont acéphales. C’est le monde des gadjé qui projette volontiers son imaginaire hiérarchique sur les collectifs voyageurs.
Ce préjugé est partagé au plus haut niveau de l’État, puisque, depuis les années 1960, les différents ministères ont toujours cherché à identifier des « représentants » des « nomades » ou des « gens du voyage ». Il y a certes des associations qui défendent les intérêts des Voyageurs, et il y a aussi des personnes qui s’autorisent à parler avec les autorités gadjé, mais, dans les deux cas, sans avoir été désignées par quiconque pour agir en tant que représentants.
Je pense notamment à l’instance censée représenter les « gens du voyage » auprès des ministères, la Commission nationale consultative des Gens du voyage, composée d’une majorité de gadjé (élus, associatifs) et de quelques représentants autoproclamés.
Quand un collectif hiérarchique tente de dominer un collectif acéphale, il lui impose le type de relation qui lui convient le mieux : c’est ce qui se passe entre les gadjé et les Roms de Provence. Le fait que l’État ait regroupé dans une catégorie artificielle, celle de « gens du voyage », des personnes qui n’ont en commun que d’habiter en caravane renforce encore ces jeux de miroirs. Dans les faits, les langues, les histoires, les façons de faire varient selon les collectifs (Roms, Gitans, Yéniches, Manouches, Sinti, Voyageurs), la région de France où ils circulent, et bien d’autres facteurs.
Lorsque vous écrivez que les dispositifs auxquels les Roms « hongrois » ont été confrontés « sont analogues à bien des égards à ceux qui furent imposés aux vaincus des colonisations européennes », à quoi faites-vous référence ?
La façon dont les gouvernements français ont tenté de contrôler entre autres les Roms, montre des parallèles avec les dispositifs coloniaux, notamment en ce qui concerne le contrôle de la mobilité, les pratiques d’identification, l’implication des missionnaires catholiques et évangéliques, la scolarisation forcée et la surveillance sanitaire, pour ne parler que des principaux traits.
Mais il ne faudrait pas non plus oublier que certaines de ces pratiques de gouvernement ont aussi été mises en place à l’encontre des classes dominées, comme les paysans français au début de la IIIe République. Les ancêtres des Roms de Provence dont il est question dans Kumpania ont connu de multiples régimes discriminatoires et répressifs depuis leur arrivée en France à la fin du 19e siècle.
Dès 1912, la plupart d’entre eux sont classés dans la catégorie administrative des « nomades » et soumis au port du carnet anthropométrique. Leurs déplacements sont contrôlés de façon quotidienne par la gendarmerie et les administrations locales.
Dans les années 1930, en accord avec les préfets, le ministère de l’Intérieur cherche à interdire les regroupements de « nomades » à travers un processus de dislocation : les groupes sont séparés en petites fractions, et chaque fraction doit partir dans des directions et des départements différents sans avoir le droit de se rencontrer.
Comme j’ai cherché à le montrer dans un autre livre Les Nomades face à la guerre (1939-1946), Klincksieck, 2022 (avec Valentin Merlin), la Seconde Guerre mondiale est un point de bascule dans ce siècle de persécutions et fait apparaître la catégorie de « nomades » pour ce qu’elle est, à savoir l’expression d’une politique raciale.
Entre 1940 et 1944, les autorités allemandes et le gouvernement de Vichy s’entendent pour traduire « Zigeuner [Tzigane] » par « nomade » ; c’est ainsi que les Roms classés comme « nomades » sont assignés à résidence, internés et déportés. Pourtant, dans les années d’après-guerre, on ne reconnaît pas aux Roms le statut de victimes de génocide et le port du carnet anthropométrique est de nouveau imposé à ceux qui reprennent la route.
Leur situation devient pire qu’avant-guerre : les interdictions de stationnement pour les « nomades » se multiplient, à tel point qu’en 1967, seules 12 550 communes, sur les 38 000 que compte alors la métropole, autorisent la halte des caravanes. Cette politique de restriction de l’accès au territoire perdure, malgré le remplacement de la catégorie de « nomades » par celle de « gens du voyage », et s’intensifie dans les années 1990 avec la création des « aires d’accueil des gens du voyage ».
Quelles sont les stratégies de résistances mises en place par les Roms ?
Confrontés à des persécutions multiples, les ancêtres des Roms de Provence ont toujours su se défendre : comme Ulysse face au cyclope Polyphème, ils ont déployé mille ruses pour déjouer les dispositifs en place. Au début du 20e siècle, afin d’échapper à l’identification et au risque de reconduite à la frontière ou d’expulsion d’un département, il n’est pas rare que les Roms se déclarent successivement sous différents noms.
Je cite ainsi une correspondance entre le siège italien d’Interpol et la police judiciaire française dans les années 1950, où l’on apprend qu’un individu a utilisé plus d’une dizaine d’identités entre 1905 et 1952 dans le seul but d’échapper au carnet anthropométrique, et sans que l’on ait pu lui reprocher un autre délit.
Dans les archives d’avant-guerre, je me suis rendu compte que des parents déclaraient le même enfant dans plusieurs mairies afin de lui permettre d’échapper plus tard au régime des « nomades ». Changer de nom est ainsi au début du 20e siècle l’un des moyens les plus efficaces de contourner les politiques anti-nomades.
Sur un autre plan, vous consacrez un passage de votre livre à « l’éducation » des enfants. Vous y citez une de vos voisines, Nita, qui vous a un jour lancé : « Moi, j’éduque pas mes enfants, j’les grandis »…
J’ai entendu Nita prononcer cette phrase devant un débat télévisé sur l’éducation des enfants. La distinction sémantique qu’elle fait entre « éduquer » et « grandir » traduit bien l’attention qui est portée aux enfants dans les compagnies. « Grandir » suppose de partager sa vie avec ses enfants – vie partagée qui n’existe pas quand les enfants sont mis toute la journée dans des structures éducatives comme la crèche, la garderie ou l’école.
Éduquer, à l’inverse, c’est discipliner, instruire par la contrainte. Si Nita souhaite que ses enfants aient accès à l’école afin d’apprendre à lire et à écrire, elle défend aussi son droit à vouloir « grandir » elle-même ses enfants quand ils sont petits. Elle considère que ses enfants, tous bilingues français-romani, ont un million de choses à apprendre en vivant au sein des compagnies, et que cet apprentissage n’est possible qu’à travers le partage du temps long et non segmenté par des incursions quotidiennes des gadjé dans leur vie.

J’ai passé beaucoup de temps à discuter avec mes voisines de la question de l’école et de l’éducation reçue par les petits gadjé : il y a plusieurs aspects qui les stupéfient, notamment la propension des gadji à faire garder pendant de très longues journées leurs bébés et jeunes enfants, mais aussi la multiplication des activités extrascolaires qui réduisent comme peau de chagrin le temps des jeux, du rêve et de l’ennui, qui leur semble indispensable pour bien grandir.
Cependant, l’enjeu dépasse une simple divergence d’opinion en matière éducative. Le jugement de mes voisines et celui des gadjé ne produisent pas le même effet : mes voisines sont souvent dans le viseur de la protection maternelle et infantile (PMI), des éducateurs spécialisés, des assistantes sociales et des professeurs des écoles.
Le monde des gadjé est intarissable sur la façon dont les Roms, les Manouches, les Sinti, les Gitans, les Voyageurs s’occupent de leurs enfants, le plus souvent pour porter des jugements excessivement négatifs qui sont vécus à juste titre comme une violence par les parents des enfants concernés.
Dans le monde du voyage, chacun connaît une famille à qui les services sociaux ont retiré ses enfants ou sur qui ont pesé des soupçons de maltraitance. Nita, par exemple, est inquiète lorsqu’elle accompagne ses enfants chez le médecin ou à l’hôpital et qu’ils ont un bleu à cause d’une chute à vélo : elle a peur que ce bleu ne soit interprété par les gadjé comme un signe de maltraitance.
Une autre voisine, après avoir accouché, a été soupçonnée par le personnel de la maternité de vouloir vendre son bébé, simplement parce qu’elle avait hâte de retourner chez elle où ses trois autres enfants l’attendaient. Parce qu’elle était rom et avait souhaité signer une décharge pour retrouver plus rapidement ses autres petits, elle s’est retrouvée au beau milieu d’un imbroglio administratif qui a bien failli lui coûter la garde de son nouveau-né. Des exemples semblables, innombrables, expliquent en partie la méfiance des Roms à l’égard des institutions éducatives des gadjé.
Autre sujet abordé dans votre livre, celui des aires d’accueil, que le monde du voyage appelle les « terrains désignés »…
La Ve République a présenté l’aménagement des aires d’accueil comme une politique humaniste permettant aux personnes qui vivent en habitat mobile de continuer à vivre ainsi. Or, rien n’est plus faux. Avant-guerre, les déplacements des « nomades » étaient certes rendus difficiles par des contrôles quotidiens les obligeant à faire viser les carnets anthropométriques, mais les espaces où les caravanes pouvaient stationner ne manquaient pas : terrains communaux, champs de foire, chemins…
Après-guerre, en revanche, de nombreuses villes interdisent tout bonnement l’accès aux « nomades » et, lorsque cette ségrégation territoriale est finalement jugée anticonstitutionnelle (en 1965), des terrains réservés aux « nomades » sont créés, souvent à côté des cimetières ou des décharges. L’idée n’est alors plus de contrôler les déplacements individuels, mais l’endroit où les Voyageurs s’arrêtent.
C’est ainsi que les « aires de stationnement » puis les « aires d’accueil » voient le jour. Des lieux payants, souvent construits dans des endroits qui n’intéressent pas les promoteurs immobiliers, où le stationnement des caravanes est toléré pour une durée limitée.
J’ai vécu pendant plus d’une année sur une aire d’accueil située dans un endroit ahurissant, entre une autoroute, une voie ferrée, un transformateur électrique et une usine classée Seveso seuil haut (c’est-à-dire qui comporte un risque important d’accident industriel grave) ; quant aux autres aires d’accueil où je suis restée, leur environnement était toujours désastreux voire dangereux.
Il me semble évident que les aires découragent et dissuadent les Voyageurs de voyager. Et comme notre société permet de rentabiliser à peu près tout – même l’apartheid territorial –, ces aires d’accueil sont gérées la plupart du temps par des sociétés privées dont le seul but est de faire du profit grâce à la gestion du stationnement des « gens du voyage ».
Pour résister au dispositif des aires d’accueil, il existe en revanche plusieurs possibilités. La première est d’occuper des espaces qui ne sont pas prévus pour accueillir des caravanes. L’ouverture de « places » est à ce titre un moyen de remédier à la disparition des terrains communaux et de lutter sans parole contre l’accaparement des terres par de grands groupes industriels et commerciaux.
Une autre possibilité pour les Roms est d’acheter des terrains dans un environnement convenable afin de pouvoir s’y arrêter avec les caravanes. Certains Roms de Provence sont propriétaires de terrains dans différents endroits de la région qui leur permettent de ne pas habiter toujours le même lieu et d’éviter d’avoir à fréquenter les aires d’accueil.
Leur usage de la propriété privée est donc très inventif puisqu’au lieu de s’enfermer dans un terrain clôturé, ils s’échangent les terrains entre eux afin de faire varier le voisinage et les lieux de halte. L’une des idées qui revient régulièrement est d’imaginer un ensemble de terrains qu’il serait possible d’échanger entre Voyageurs pour éviter les aires d’accueil et continuer de voyager…
Propos recueillis par Tiphaine Guéret pour CQFD
Image de une : ©Valentin Merlin








