basta! : L’écart de richesse entre les femmes et les hommes est impressionnant en France. Il est passé de 9 % en 1996 à 16 % en 2015. Pouvez-vous revenir sur les raisons de ces inégalités persistantes, et même croissantes ?
Sibylle Gollac : En moins de 20 ans, les inégalités de patrimoine entre les femmes et les hommes ont été multipliées par deux. Cet accroissement, documenté par Nicolas Frémeaux et Marion Leturcq, est principalement dû à l’individualisation des patrimoines au sein des couples [1]. Avant, les inégalités de revenus entre les femmes et les hommes ne se traduisaient pas automatiquement en inégalités de patrimoine, grâce au mariage sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Avec ce régime, tout ce qui est acquis après le mariage (à l’exception des héritages) entre dans une communauté de biens. Mais depuis les années 1970, il y a un fort recul du mariage. Aujourd’hui, 60 % des enfants naissent hors mariage. Et de plus en plus de gens font des mariages avec séparation de biens.
Au moment des séparations, chacune et chacun repart avec ses propres richesses, et elles sont moindres pour les femmes dans la plupart des cas. Dans notre enquête, qui a duré dix ans, nous avons exploré les raisons de cette moindre accumulation.
Ce que vous avez mis en évidence, c’est que ces inégalités « ne naissent pas à Wall Street, mais dans les replis quotidiens de la vie familiale ». Vous proposez d’ailleurs de regarder la famille comme une véritable entité économique, ce qui va à rebours d’une idée un peu romantique de la famille, mais aussi de certaines théories sociologiques.
Notre travail est une réponse aux théories sociologiques de la famille des années 1980 et 1990 qui affirment que, désormais, les relations familiales sont des relations affectives et non plus économiques. Les femmes ayant acquis une certaine indépendance économique, la relation conjugale serait libérée des contraintes économiques. Notre travail démontre évidemment le contraire, avec la question centrale de la division sexuée du travail. Au sein des couples hétérosexuels, les femmes travaillent, mais n’accumulent pas.
Les hommes sont en effet spécialisés dans le travail rémunéré, auquel ils consacrent l’essentiel de leur temps et les femmes sont spécialisées dans le travail domestique gratuit. Si on se réfère à l’enquête « emploi du temps » de l’Insee de 2010 des couples avec enfants, on voit que les femmes travaillent 54 heures par semaine, et les hommes 51 heures. Ils ont donc trois heures de loisir en plus que les femmes, par semaine. Et tandis que les deux tiers du temps des femmes sont consacrés au travail domestique gratuit, les deux tiers de celui des hommes sont consacrés au travail rémunéré.
On sait aussi que près d’une femme sur deux réduit son activité après la naissance des enfants, contre un père sur neuf. Tout cela explique les très fortes inégalités de revenus entre conjoints, 42 % en moyenne, alors même que les femmes sont souvent plus diplômées que les hommes. Pour les personnes vivant seul.es, ces inégalités ne sont que de 9 %. Les hommes s’appuient sur le travail gratuit des femmes pour faire carrière et les femmes s’appauvrissent au bénéfice des hommes.
L’étendue de ces inégalités reste plus ou moins invisible tant que les femmes sont en couple, car la richesse ou le niveau de vie sont généralement mesurés au niveau du « foyer fiscal » ou du « ménage ». De ce fait, on saisit surtout les inégalités au moment des séparations, avec un niveau de vie qui diminue en moyenne de 19 % pour les femmes, contre 2,5 % pour les hommes
Pouvez-vous revenir sur l’impact des moindres mariages et sur celui des mariages avec séparation de biens au sein des couples hétérosexuels ?
Dans la pensée féministe, le mariage est vu comme une institution patriarcale. A raison, puisque jusqu’il n’y a pas si longtemps, les droits des époux étaient inégaux. En se mariant, une femme renonçait à la capacité de gérer ses propres biens et elle n’avait aucun pouvoir sur le patrimoine conjugal. Ce n’est qu’à partir de 1965 que les femmes mariées ont pu gérer leurs biens propres et avoir un droit de regard sur la gestion des biens du couple. Les deux époux n’ont des droits équivalents sur leur patrimoine commun que depuis 1985.
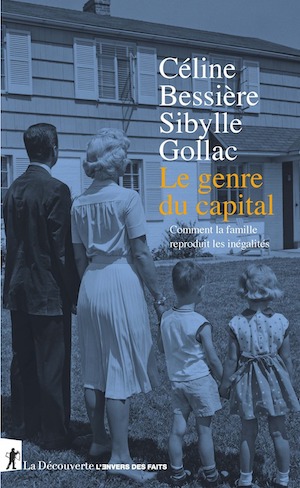
Mais c’est à la même période que les gens ont cessé de se marier, souvent au nom de l’autonomie financière des femmes, et malgré le maintien d’importantes inégalités de revenus. On a donc là une cause importante d’inégalités de richesse, qui deviennent visibles au moment des séparations. Même chose pour les mariages avec contrat en séparation de biens, pourtant perçu comme plus égalitaire et libéral.
Vous évoquez par ailleurs le problème des divorces par consentement mutuel et l’absence de passage devant le juge, possible depuis 2017.
Les négociations, a fortiori sans le regard d’un juge, renvoient les conjoints à leurs rapports de force habituels, dans lesquels les femmes sont en position moins favorable, notamment quand elles ont un revenu moins important. Elles ont besoin que les négociations avancent vite car sans les compensations financières qui leur reviennent, elles sont assez rapidement en difficulté. C’est moins le cas pour les hommes, qui peuvent donc les faire durer à leur avantage. Rappelons que les différences de richesse entre les femmes et les hommes, au sein des couples de sexe différent, sont de 42 %. Ils et elles n’ont donc pas non plus les moyens de se payer le même genre d’avocate pour défendre leurs intérêts.
Le fait de ne pas passer devant un juge favorise par ailleurs la mise en œuvre de stratégies d’optimisation fiscale à la limite de la légalité – par exemple sous-estimer un bien immobilier ou des parts d’entreprise – qui jouent en faveur des hommes : comme ce sont plus fréquemment eux qui conservent ce type de biens après la séparation, ce sont les compensations qu’ils vont verser à leurs ex-conjointes qui sont sous-estimées.
Les successions sont un autre moment d’invisibilisation du travail gratuit des femmes, et une autre source d’appauvrissement, car elles n’héritent pas de la même chose que les hommes. Vous parlez notamment à ce propos de comptabilité inversée sexiste. De quoi s’agit-il ?
Officiellement, quand on regarde un acte notarié, on fait l’inventaire des éléments du patrimoine – appartement, terrain, compte en banque, etc – puis une évaluation de chacun de ces biens, la somme de la valeur globale de la succession, l’évaluation de droits de chacune par division et enfin la répartition des biens pour essayer d’obtenir des parts de valeur adéquate. Si les parts s’avèrent inégales, l’un doit verser à l’autre une compensation financière. C’est ce qu’on appelle une soulte.
Or, on a observé que les choses se passent en réalité dans le sens inverse. Ce qui prime c’est « qui va avoir quoi ? », avec en premier lieu la distribution des « biens structurants » du patrimoine familial, par exemple une entreprise. Ce dont l’on discute ensuite c’est « combien celui qui garde le bien est prêt à payer ? ».
Enfin, le ou la notaire fait en sorte que l’inventaire et l’évaluation des biens rendent ces arrangements conformes à la loi. Pour parvenir à ce résultat, les « biens structurants » sont couramment sous-évalués. Or, que ce soit dans les divorces ou les héritages, les biens structurants vont plus souvent aux hommes, et ce sont les compensations financières que touchent les femmes qui sont sous-évaluées.
On découvre dans votre enquête que les notaires et avocats sont des acteurs insoupçonnés du creusement et de la reproduction des inégalités entre les femmes et les hommes. Les arrangements qui ont lieu dans le secret de leurs cabinets lors des divorces ou des héritages convergent généralement avec les intérêts des hommes. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
Notaires et avocates ont des pratiques professionnelles qui valorisent l’accord. Prenons la situation typique d’un divorce avec une entreprise familiale. C’est le mari qui garde l’entreprise. L’épouse souhaite obtenir une compensation financière, mais pas au point de compromettre la situation financière de l’entreprise. Il y a très peu de chances pour qu’une notaire ou une avocate dise : « Ah non, attendez, dans ces conditions Madame ne va pas recevoir la prestation qu’elle devrait. Elle pourrait demander plus... » Les avocates ne veulent pas être trop « contentieux ». Les notaires mettent en avant leur rôle dans le maintien de « la paix des familles ». Ces valeurs les amènent à entériner les rapports de pouvoir et de domination.
Le second élément à prendre en compte, c’est l’origine sociale de ces professionnelles. Parmi la vingtaine de notaires que nous avons rencontré.es, une seule n’était pas fille de travailleur indépendant. On avait des enfants de notaires, de pharmaciens, de restaurateurs…. c’est à dire des personnes issues de familles dans lesquelles la transmission d’un bien structurant est quelque chose de très important. Ils et elles partagent avec beaucoup de leurs clientes – et le reste de la société – l’idée que celui qui est le plus apte à gérer une entreprise ou un bien immobilier, et bien, souvent, c’est un homme.
On a vu passer des divorces avec une entreprise familiale dans laquelle la femme travaillait à temps plein, de façon plus ou moins reconnue, parfois pas reconnue du tout… Cela paraissait évident à tout le monde que c’était à l’ex-époux que devait revenir l’entreprise. Il fallait qu’il reste propriétaire du capital de l’entreprise et que l’ex épouse se contente de compensations subordonnées au maintien de la rentabilité de l’entreprise. Alors même que ces compensations devraient être d’autant plus importantes que son travail n’a pas été reconnu par un salaire, et qu’elle n’a pas accumulé de droits à la retraite.
Ce qui se joue là est également lié au souci de ce que l’homme va transmettre à ses enfants…
Effectivement. Qui trouve légitime qu’un père renonce à son entreprise florissante, et compromette ainsi l’héritage de ses enfants, pour verser une compensation à son ex-femme ? Nous avons rencontré des femmes qui renonçaient sciemment à leurs droits sur le domicile conjugal pour que leur ex puisse rester propriétaire et transmettre quelque chose à leurs enfants. Les femmes sont par ailleurs davantage socialisées à maintenir de bonnes relations familiales. Pour elles, c’est difficile de se mettre dans la position de celle qui va amener le conflit et les tensions au sein de la famille, quitte à renoncer à des biens au profit de leurs frères par exemple.
Dans le cadre des séparations, s’ajoute le primat de l’intérêt des enfants. Malgré la séparation, les parents doivent rester en bons terme pour maintenir les conditions de la « coparentalité », une norme très forte dans l’ensemble de la société, chez les professionnelles du droit comme dans la littérature de conseils éducatifs sur laquelle s’appuient parfois les mères… Au nom de cela, il ne faut pas se fâcher, et cela se traduit concrètement par un renoncement des femmes à leurs droits économiques.
Le fait d’être à l’ombre du droit n’explique pas tout. Même quand la justice intervient, elle ne parvient pas à renverser ces mécanismes sexistes.
Il est vrai que le passage devant un juge – et plus souvent une juge aux affaires familiales (dans plus de ¾ des cas) – ne vient pas renverser ces mécanismes inégalitaires. On en donne deux exemples : le calcul des prestations compensatoires et celui des pensions alimentaires. Les prestations compensatoires sont réservées aux couples mariés et sont versées sous forme de capital au moment du divorce, ou au plus tard huit ans après le divorce. Elles sont censées compenser les inégalités économiques liées à la rupture du mariage et aux sacrifices qu’un ou – plus généralement – une conjointe a fait au bénéfice de la carrière de son ex-conjoint et de la prise en charge de la vie familiale, c’est à dire des enfants. Ce que l’on a observé, c’est que ces prestations sont soumises au même type de comptabilité que le partage du patrimoine conjugal. Les juges les déterminent avant tout en fonction des liquidités disponibles du débiteur. Cela leur paraîtrait étrange d’obliger un homme à vendre son logement pour pouvoir verser une prestation compensatoire à son ex conjointe. Au final, il n’y a de prestation compensatoire que dans 20 % des divorces.
Ce que l’on a aussi constaté, c’est que les juges interprétaient ce dispositif de prestation compensatoire comme un encouragement à un partage traditionnel des tâches, que les magistrates réprouvent. Elles sont rétives à fixer des prestations compensatoires importantes au bénéfice de femmes qui ont renoncé à leur carrière. Pourtant ces magistrates, si elles font carrière, ne la font pas comme leur mari. Elles sont nombreuses à adapter leur carrière à celle de leur conjoint, y compris quand celui-ci est magistrat. Elles ont les moyens de déléguer une partie du travail domestique mais ce sont elles qui gardent la charge mentale de cette délégation. Les sacrifices que font les justiciables qui sont en face d’elles leur paraissent tout à fait normaux, puisqu’elles font elles-mêmes ces sacrifices, tout en ayant l’impression de faire carrière et d’être indépendantes financièrement. Leur réticence dans la fixation des prestations compensatoires s’explique, de façon mêlée, par leur genre et leur position de classe.
Même chose pour les pensions alimentaires ?
Les pensions alimentaires, destinées à la prise en charge des enfants, concernent toutes les justiciables, mariées ou pas, riches ou pauvres. La façon dont elles sont fixées met en lumière les normes de genre qui imprègnent l’activité de l’institution judiciaire. Tout d’abord, il paraît évident que les mères soient perpétuellement disponibles pour prendre en charge leurs enfants. Le père doit pouvoir participer à leur éducation, mais s’il n’est pas disponible, la mère doit être là. Et cela n’appelle pas vraiment de compensation financière. Les juges ne comptabilisent jamais le coût de cette disponibilité pour les femmes. Pourtant, elles sont souvent à temps partiel, et l’ensemble de leur carrière est surdéterminé par la nécessité de s’occuper des enfants. Pour fixer une pension alimentaire, la question principale reste : « combien le père peut payer ? » Et les femmes se débrouillent ensuite. Ou elles n’ont qu’à se tourner vers l’État pour avoir des aides.
Ce qu’on montre c’est que face aux justiciables des classes populaires, et en particulier face à ceux qui sont racisés, les juges survalorisent le travail des pères. Chez certaines, il y a cette idée que c’est problématique un père au chômage. Et que devoir payer une pension alimentaire trop élevée, en cas de retour à l’emploi, encouragerait ces hommes à cesser de travailler. On les exonère parfois de pension, alors que leurs ex-conjointes sont dans des situations financières encore plus difficiles et ont la charge des enfants. Du côté des plus riches il y a une forme de plafonnement des pensions. Les juges sont des fonctionnaires qui gagnent bien leur vie mais qui pensent devoir leur salaire à la méritocratie scolaire : ils ont réussi un concours difficile et ils ont des revenus inférieurs à une partie de la bourgeoisie économique, notamment certains avocats. Ils et elles valorisent des pratiques éducatives relativement ascétiques et sont réticents à fixer des pensions alimentaires très élevées quand le père est très riche. On a des juges qui nous disent : « qu’est-ce qu’elles vont payer à leurs enfants avec cet argent ? ». Leurs propos dénoncent certaines consommations ostentatoires et expriment un mépris de la bourgeoisie économique, qui jouent au détriment des femmes et au bénéfice des hommes les plus riches.
Vous montrez que le droit de la famille français est un droit des biens, destiné à organiser la circulation des richesses entre les ex-conjoints…
Oui, et ce qui peut circuler dépend nécessairement de la richesse familiale. Si on est « éligible » à la prestation compensatoire et que le conjoint est pauvre, on a peu de chances de récupérer quoi que ce soit, même s’il y a eu du travail gratuit au cours de la vie conjugale. La situation la plus explicite est celle des entreprises conjugales. Nous citons l’exemple d’une femme qui a travaillé pendant des années, sans aucun statut, dans l’entreprise horticole de son mari et qui n’a donc jamais rien gagné. Aucun salaire. Pas de droits à la retraite. Au moment du divorce, elle aurait dû toucher une prestation compensatoire. Mais, depuis qu’elle a cessé d’y travailler, l’entreprise a fait faillite. Le juge, constatant qu’il n’y a pas d’argent, estime qu’il ne peut pas y avoir de prestation compensatoire.
Pour les pensions alimentaires, c’est un peu la même chose : le juge dit « oui, vous êtes en difficulté, vous travaillez à temps partiel dans un emploi peu qualifié, et vous avez deux enfants à charge. Mais votre ex-conjoint il est au smic, qu’est-ce qu’on peut faire ? » On saisit là des limites du code civil français : c’est un droit qui règle les relations entre les personnes avant tout par des transferts de propriété. Dans les classes possédantes, les femmes se font avoir. Mais quand il n’y a pas de patrimoine, elles n’ont juste rien du tout.
Vous expliquez qu’elles se retrouvent alors coincées dans des situations de mendiantes.
Exactement. Elles doivent demander à leur ex-conjoint de les aider et, s’il n’est pas solvable, elles doivent demander à l’État de les aider. Alors même que pendant la vie conjugale et après, ce sont le plus souvent elles qui ont la charge des enfants. De plus, le recours aux aides sociales impose une mise sous contrôle de leur budget et de leur conjugalité. Elles sont tenues de mentionner si elles se mettent à nouveau en couple, ce qui entraîne la perte d’une partie de leurs aides (pourtant destinées à la prise en charge d’enfants qui ne sont pas ceux de leur nouveau conjoint).
Les juges ont ainsi l’habitude que les femmes justifient leurs dépenses, en particulier celles qui concernent leurs enfants. J’ai souvenir de l’un d’eux qui disait : « Ah, vous êtes une femme, je suis sûre que vous avez des pochettes et des sous-pochettes avec tous les comptes pour vos enfants. » Et c’était vrai. La dame avait tout cela ! Ce qui est impressionnant quand on met tout bout à bout c’est de réaliser qu’une femme qui prend en charge quotidiennement ses enfants, c’est elle qui doit aussi faire les démarches pour obtenir une pension, c’est encore elle qui doit faire les démarches auprès de la CAF, et que c’est elle qui doit fournir en permanence des justificatifs de ses revenus et prouver qu’elle ne s’est pas remise en couple. C’est un travail et un contrôle permanents.
Les hommes ne sont-ils pas censés dire ce qu’ils gagnent pour pouvoir verser une pension ?
Si, mais quand ils n’ont pas de justificatifs de revenus, les juges renoncent souvent, pour des questions de moyens, à faire des expertises comptables. Ils considèrent aussi qu’un homme rétif à justifier de ses revenus risque d’être un mauvais payeur. Mieux vaut alors ne pas de fixer de pension, pour que la mère puisse demander une allocation de soutien familial, ou alors fixer celle qu’il déclare être prêt à payer. Les impayés de pension sont de fait nombreux et les recours complexes à mettre en œuvre.
En France, ils restent peu pénalisés. La situation est très différente aux Etats-Unis, par exemple, où il n’y a pas d’état social, et où les juges fixent des pensions alimentaires élevées, y compris pour les classes populaires. Les impayés de pension constituent une raison fréquente d’emprisonnement des hommes noirs. On voit ici les limites de systèmes qui pensent d’un côté une redistribution de genre, plus ou moins limitée, au sein de la famille et de l’autre une redistribution entre familles riches et pauvres, elle aussi plus ou moins limitée, aveugle aux inégalités qui se jouent au sein des ménages.
A quand un système de redistribution qui articule les inégalités entre familles et les inégalités dans la famille ? Ce qui serait intéressant c’est que les pères riches paient pour les mères pauvres. Mais ce n’est pas ça qui est prévu dans le droit.
Propos recueillis par Nolwenn Weiler
Photo de une : ©Anne Paq








