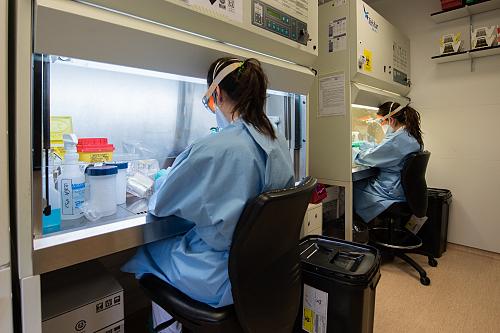En entrée : une saucisse de glu de porc malaxée
Cela ressemble à de la guimauve rose liquide. Cette mixture de viande est obtenue en passant les carcasses de poulet ou de porc dans une centrifugeuse à haute température, ce qui permet de récupérer le moindre morceau de barbaque. Les tendons, graisses, tissus conjonctifs sont transformés en pâte. À l’arrivée dans l’assiette, le « lean finely textured beef » (bœuf maigre à texture fine) est utilisé depuis quinze ans « sans restrictions » aux États-Unis.
Petit détail : ce hachis liquide provient des parties les plus prédisposées à la bactérie E.coli et aux salmonelles. Ce qui rend nécessaire, pour tuer tous les éléments pathogènes, un traitement à l’ammoniaque, substance considérée comme non dangereuse par les autorités sanitaires, et utilisée par ailleurs pour la fabrication d’engrais, le détartrage des métaux, ou la fabrication d’explosifs… Aux États-Unis, le produit est ajouté depuis des années à la viande hachée ou aux hamburgers. Vous en reprendrez bien un peu ?
Ce pink slime – ou « glu rose », tel qu’il a été rebaptisé par ses détracteurs – a déclenché récemment une tempête aux États-Unis. Des parents d’élèves se sont mobilisés lorsque le ministère de l’Agriculture a annoncé qu’il prévoyait d’acheter plus de 3 000 tonnes de cette mixture pour les cantines scolaires. Devant la fronde populaire, McDonalds et Burger King ont annoncé en janvier qu’ils cessaient d’en ajouter à leurs steaks hachés. Beef Products Inc., le plus grand producteur de pink slime, a dû fermer (momentanément) ses usines. Le géant de l’agroalimentaire Cargill, qui utilise un produit similaire dans ses hamburgers, traité à l’acide citrique au lieu de l’ammoniaque, a annoncé en mars qu’il réduisait sa production.
En plat : la « viande séparée mécaniquement »
Pourquoi l’agro-industrie se donne-t-elle tant de mal ? Pour rentabiliser la moindre calorie bien sûr. « Nos installations traitent 4 500 à 6 000 têtes de bétail chaque jour, et il y a beaucoup de déchets dans le processus de fabrication », a expliqué un porte-parole de Cargill. Du coup, ces restes sont broyés, traités, compactés, et utilisés comme additif dans la viande sortie des chaînes de fabrication. Ajouter du pink slime permet à Cargill « d’économiser » l’équivalent de 1,5 million d’animaux chaque année. Impossible de savoir quelle quantité de cette mixture est ajoutée à la viande. Secret industriel. Aucune mention sur l’étiquetage, puisque le pink slime est considéré comme « 100 % bœuf ». Le ministère de l’Agriculture impose une limite de 15 % du fait du traitement à l’ammoniaque. Difficile à contrôler. 70 % des produits de bœuf haché contiendraient du pink slime, affirme Beef Products Inc.

En France aussi, on pratique le « VSM », pour « viande séparée mécaniquement ». Même objectif : récupérer toute la substance « comestible » possible. La VSM est produite en forçant les os à travers un tamis, sous haute pression. Ce qui provoque la destruction de la structure fibreuse des muscles. Le produit obtenu n’est donc plus vraiment de la viande. La Commission européenne a statué en 2001 qu’un étiquetage différencié était nécessaire, car la viande mécaniquement séparée « ne correspond pas à la perception de la viande par le consommateur et ne permet pas de l’informer de la nature réelle du produit »... Les petits morceaux d’os contenus dans la VSM ont aussi une taille réglementée.
Où trouver cette appétissante substance ? Notamment dans les saucisses. 700 000 tonnes de VSM sont produites par an en Europe. Un marché de 400 à 900 millions d’euros. En France, le volailler Doux, avec sa marque Père Dodu, a été accusé par la répression des fraudes de tromperie sur l’étiquetage : entre 2009 et 2011, il a écoulé 1 282 colis de saucisses de « poulet séparée mécaniquement » en les présentant comme « viande »... Destination : des cantines scolaires et des maisons de retraite [1]. Côté traçabilité, ce n’est pas gagné.
Le plateau de fromages synthétiques
Du côté des produits laitiers aussi, une formidable innovation technologique permet de casser les prix. Cargill a lancé en 2009 un « fromage » sans lait. « Son aspect, son goût et sa texture correspondent parfaitement à ceux du fromage à base de protéines laitières, vante le géant de l’agroalimentaire. Ils sont semblables à ceux des traditionnels fromages à pâte dure, comme le gouda, le cheddar ou le gruyère, assurant ainsi les mêmes plaisir et satisfaction aux consommateurs. » Ce fromage chimique, le Lygomme™ACH Optimum, est composé de trois amidons, d’un galactomannane (E410, 412, 417), d’un carraghénane (E407) et d’arômes. Un « système fonctionnel », qui « reproduit la fonctionnalité des protéines du lait et les remplace totalement », sans pourvoir prétendre à l’appellation « fromage », puisque sans produit laitier.

Son avantage ? Son prix. Le Lygomme™ACH Optimum permet de ne pas dépendre des fluctuations du marché du lait. Une « alternative rentable » pour les pizzas au fromage : le Lygomme est 200 % moins cher que la mozzarella ou l’emmental, annonce Cargill ! Et même 60 % moins cher que le « fromage analogue », autre produit de substitution en circulation. Ce dernier, à base d’huile de palme, d’amidon, de sel et d’exhausteurs de goût – et 15 % seulement de protéines de lait –, a déjà inondé le marché européen. Cargill vante aussi les propriétés diététiques de son Lygomme : moins de matières grasses et moins d’acides gras saturés. Le produit a même été nominé aux Food Ingredients Excellence Awards 2009, grand rendez-vous de l’agroalimentaire, pour le titre d’« Innovation de l’année », catégorie... Produits laitiers (sic).
En Europe, pas de problème de commercialisation des substituts de fromage : il suffit que les composants soient clairement indiqués sur l’étiquette. Mais qui peut deviner que le « galactomannane » inscrit sur l’emballage désigne la pâte fromagère de la pizza ou des lasagnes ? D’autant que les producteurs laissent souvent une part de « vrai fromage » dans la liste des ingrédients pour ne pas effrayer le consommateur.
Selon un reportage de la chaîne ZDF, l’Allemagne produit chaque année 100 000 tonnes de « faux » fromage. Un dixième de sa production. Un laboratoire allemand a analysé une centaine de sandwichs au fromage. Verdict : un tiers d’entre eux ne contenaient pas du « vrai fromage ».
Au menu demain : animaux transgéniques et hamburgers in vitro
Autre solution pour produire plus de protéines animales : des animaux qui « poussent » deux fois plus vite. Dans les laboratoires se multiplient les expériences pour produire des animaux génétiquement modifiés aux propriétés intéressantes pour l’industrie agroalimentaire. Aux États-Unis, les cochons « Enviropig », génétiquement modifiés pour moins polluer, et les saumons « Frankenfish », qui grandissent deux fois plus vite, attendent leur autorisation de mise sur le marché (lire notre enquête). Des vaches hypermusclées, des chèvres dont le lait fabrique de la soie, des porcs avec un gène de souris… Des animaux porteurs de gènes étrangers à leur espèce pourraient arriver bientôt dans nos assiettes. La Chine est à la pointe de la recherche sur la transgenèse animale. Et l’Europe se prépare discrètement à suivre le mouvement.
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) vient de lancer une consultation publique concernant l’évaluation des risques environnementaux des animaux génétiquement modifiés. Objectif : définir les données requises et la méthodologie à appliquer « si des demandes d’autorisation de mise sur le marché dans l’Union européenne devaient être soumises dans le futur »… L’évaluation porte « essentiellement sur les poissons, les insectes, les mammifères et les oiseaux génétiquement modifiés ». Vaste programme ! « Jusqu’à présent, aucune demande d’autorisation de commercialisation d’animaux GM n’a été déposée dans l’UE », précise l’Efsa. Mais « la technologie a rapidement évolué ces dernières années et, dans certains pays non membres de l’UE, les autorités de réglementation évaluent déjà la sécurité des animaux GM, tant au niveau de l’environnement qu’au niveau de l’alimentation humaine et animale ».
Et bientôt… le steak de sérum de fœtus de cheval
Demain, nous pourrons aussi nous demander si le steak ou la saucisse que nous avalons goulûment a bien un jour été « vivant ». De nombreux programmes de recherche travaillent depuis des années sur la viande artificielle. La Nasa a été la première à s’y intéresser (pour nourrir les futurs astronautes en route vers de lointaines planètes). En 2000, des chercheurs new-yorkais ont réussi à produire de la chair de carpe à partir de cellules prélevées. Comment fabriquer de la viande en éprouvette ? Les scientifiques cherchent à développer du muscle à partir d’une cellule de porc (bien vivant celui-là), par la mise en culture dans un milieu riche en nutriments.
Pour le moment, les morceaux de viande produits in vitro, fabriqués avec des cellules souches de porc et du sérum de fœtus de cheval, mesurent 2,5 cm de long et apparaissent gris et ramollis. Pas de quoi ouvrir l’appétit… En France, on doute d’arriver à un résultat à court terme. « L’une des difficultés majeures est de reproduire la finesse de l’irrigation sanguine, qui apporterait les nutriments et les facteurs de croissance nécessaires aux cellules, en mimant l’irrégularité des pulsations cardiaques », explique Jean-François Hocquette, directeur de recherche à l’Inra. En septembre dernier, des chercheurs néerlandais promettaient d’ici à six mois un steak prêt à manger… Le coût du morceau de viande reste pour le moment prohibitif : 250 000 euros.
Ces travaux sont encouragés par la plus importante organisation des droits des animaux, People for the Ethical Treatment of Animals (Peta), qui voit dans la viande in vitro un moyen de mettre fin aux souffrances des poulets, porcs ou vaches tués chaque année. Peta a promis une récompense d’un million de dollars au premier chercheur qui – avant le 30 juin 2012 – produira de la viande de poulet in vitro, au goût identique à celui du « poulet réel », et pouvant être fabriquée à grande échelle.
La solution écolo : mangez des vers, des scarabées et des papillons
Pour faire face à la demande mondiale, la production animale devrait doubler d’ici à 2050, estime la FAO [2]. Si d’ici quelques décennies les protéines ne poussent pas encore dans les laboratoires, cela représentera 36 milliards d’animaux – en plus de 9 milliards d’humains – sur la planète. Alors que l’élevage est déjà responsable de 18 % des émissions de gaz à effet de serre… La solution ? Diminuer fortement notre consommation de viande. Autre moyen pour réduire l’impact écologique de l’élevage : développer les cultures d’insectes. Certes, la quiche au vers ou la tarte à la chenille risquent d’avoir du mal à trouver des adeptes en France… Mais, selon la FAO, plus de 1 000 espèces d’insectes sont consommées dans le monde [3]. Une alimentation très saine et nutritive : les insectes apportent autant de protéines que la viande traditionnelle. Avec une teneur en fibres

comparable à celle des céréales, plus du fer, du calcium et de grandes quantités de minéraux et de vitamines. Scarabées, papillons ou fourmis mais aussi punaises, termites et abeilles seront peut-être la base des repas les plus sains… De quoi en tout cas varier les menus !
Les insectes, c’est bon pour l’environnement : il faut 8 kilos de végétaux pour produire un kilo de viande bovine. Et moins de deux kilos pour produit un kilo d’insectes. Une matière première que l’industrie agroalimentaire semble pour le moment délaisser. En attendant les élevages intensifs et la future pâte d’insectes que ne manquera pas de nous concocter l’industrie alimentaire, il est toujours possible de déguster une sucette scorpion aromatisée à la myrtille, des raviolis de criquets ou des brownies aux vers.
Agnès Rousseaux
Photo de une : source
À lire aussi :
– Ces animaux mutants que la cuisine génétique vous prépare
– Nanotechnologies : tous cobayes de la nano-bouffe ?
– Overdose d’antibiotiques dans l’élevage industriel