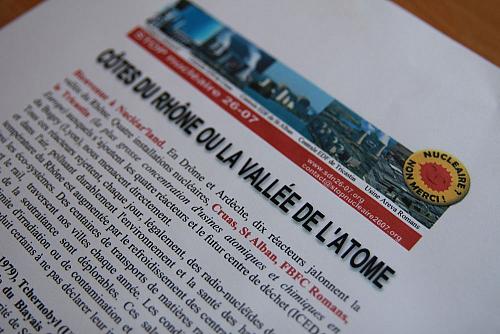Basta! : Lors des lancements des programmes nucléaires civils, aux États-Unis ou en France, la filière est clairement jugée à très haut risque. Comment les industriels qui se lancent dans l’aventure vont-ils être, en quelque sorte, en partie dédouanés de ces risques ?
Sezin Topçu [1] : Le caractère ingérable des dégâts provoqués par un accident nucléaire majeur est reconnu par les experts nucléaires dès les années 1950, bien avant le passage au stade industriel. Ils étaient d’accord sur le fait que de très vastes territoires allaient être contaminés pendant des centaines voire des milliers d’années ; et qu’il faudrait, en théorie, évacuer un nombre très important de personnes. Il est même envisagé de désigner des zones d’exclusion pour l’implantation des sites nucléaires. Des calculs effectués en 1957 à la demande de la commission à l’énergie atomique aux États-Unis (Atomic Energy Commission) imaginent alors un coût financier de l’ordre de 7 milliards de dollars.

Afin de protéger l’industrie nucléaire contre de tels risques financiers, l’État américain décide de limiter de façon drastique et exceptionnelle la responsabilité civile des exploitants en cas d’accident. Sans ces lois d’exception, il n’est alors pas envisageable pour les industriels de se lancer dans l’aventure nucléaire. Tous les pays qui développent le nucléaire vont s’inscrire dans ce schéma, qui n’a guère évolué depuis. EDF, par exemple, est aujourd’hui tenue par une responsabilité civile limitée à 91 millions d’euros en cas d’accident majeur, ce qui représente une somme dérisoire si on la compare aux évaluations des pouvoirs publics français qui estiment à environ 430 milliards d’euros le coût moyen d’un accident nucléaire majeur, jusqu’à 760 milliards pour un scénario « majorant ».
Le Japon fait figure d’exception vis à vis de cette atténuation des responsabilités, puisque l’exploitant doit dès le départ mettre de côté une réserve financière très élevée. Qu’a dû payer l’exploitant de Fukushima ?
Effectivement. La loi japonaise de 1961 relative à la responsabilité civile contraint tout exploitant à débloquer une « réserve de sécurité » d’un milliard d’euros, avant même de se lancer dans l’exploitation des centrales nucléaires. C’est une somme assez importante, égale à onze fois le montant imputé à EDF en cas d’accident. Cela dit, quand la catastrophe de Fukushima frappe le Japon en mars 2011, l’exploitant nucléaire privé Tepco aurait pu s’exonérer de toute responsabilité car la loi de 1961 prévoit aussi de rendre nulle la responsabilité de l’exploitant en cas de « catastrophes naturelles majeures ». Face à l’ampleur des réactions suscitées dans la population japonaise, Tepco a finalement décidé de ne pas demander d’exonération.
« Le coût d’un accident nucléaire majeur en France est estimé à environ 430 milliards d’euros »
Les sommes à débourser sont telles – les estimations oscillent entre 250 et 500 milliards d’euros jusqu’à récemment – que l’État a en fait avancé une partie des indemnités versées aux victimes, sans que l’on sache si Tepco remboursera un jour. Les consommateurs ont également été mis à contribution via une augmentation du prix du kWh. Ainsi, même dans un contexte où a priori l’exploitant porte une « responsabilité illimitée », des ajustements sont apportés au cadre législatif existant. Le « fossé » entre ce qu’un industriel est censé – et surtout est « en mesure » de – payer et ce qu’il faut réellement débourser pour prendre en charge correctement les dommages, impose une limitation forcée des responsabilités de l’industriel. Cela engendre une ré-organisation des charges à imputer à l’État et à la collectivité.
En France, au moment où le programme nucléaire est lancé dans les années 1970, plusieurs centaines de physiciens dénoncent une mauvaise évaluation du risque nucléaire. Comment se fait-il que leur avis n’ait pas été pris en compte ?
Le lancement du programme nucléaire français – le plus ambitieux du monde – ne s’est pas du tout fait dans des eaux tranquilles. Il y a alors de très grandes controverses. En février 1975, des physiciens du Centre national de recherche scientifique (CNRS), du Collège de France, de l’Institut de physique nucléaire, et d’autres encore, se mobilisent via une pétition qui met en garde contre le plan nucléaire du gouvernement. Ils conseillent à la population de ne pas accepter ce programme tant que les risques ne sont pas mieux évalués. Ils dénoncent un recours massif à l’énergie nucléaire – la France prévoyait alors 100 % d’électricité d’origine nucléaire – qui est selon eux extrêmement dangereux, d’autant qu’à l’époque la filière nucléaire n’était pas éprouvée. Ils critiquent aussi la technocratie propre à ce secteur. Le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) et EDF décident alors de tout, en lien avec les ministères de l’économie, de l’industrie et de l’énergie. En dehors de ce noyau, aucun scientifique n’est intégré.
Il n’était pas banal qu’autant de savants – 4000 au total – s’opposent à un tel programme. A ce moment, EDF a réellement peur de devoir stopper son programme nucléaire. Ces savants sont immédiatement désignés comme illégitimes, parce que ne connaissant pas, soit disant, le secteur. Cette stigmatisation est habituelle, en France, pour disqualifier les mouvements anti-nucléaires. EDF et le gouvernement les ont toujours présentés comme des partisans irrationnels du retour à la bougie, opposés au progrès. Dans la période actuelle, on observe un retour à ce discours de dénigrement des opposants anti-nucléaires, notamment à Bure [lieu d’un projet d’enfouissement à grande profondeur de déchets radioactifs, ndlr]. Avec un interventionnisme très important de l’État, qui oppose les « habitants citoyens » aux « opposants casseurs ».
Vous évoquez également une façon de gouverner par l’urgence, et la très alléchante taxe professionnelle pour faire accepter les projets nucléaires…
Dans les années 1970, le suivi de l’opinion publique devient un enjeu majeur pour le gouvernement et pour EDF. A partir d’études de comportement de la population à l’échelle locale comme nationale, notamment via les enquêtes d’opinion, EDF est avertie que les critiques d’un projet diminuent au fur et à mesure qu’un chantier avance. C’est logique : on a moins envie de s’opposer à un projet une fois qu’il est terminé. Il faut donc aller le plus vite possible dans la mise en chantier. C’est l’une des raisons pour lesquelles beaucoup de chantiers sont lancés avant d’avoir les autorisations de construction.
Les nombreuses plaintes déposées par des habitants ou des communes contre ces travaux non autorisés ont cependant toutes été classées, avec une régularisation a posteriori. Nous sommes confrontés à l’irréversibilité des projets techniques. On rend d’abord les projets irréversibles, ensuite on les régule. Cela estompe les possibilités de contestation. C’est la même chose avec les pesticides, qu’on tâche aujourd’hui de réguler alors qu’ils sont déjà disséminés partout dans l’environnement.
La taxe professionnelle joue également un rôle important pour rendre les projets nucléaires acceptables, avec d’autres avantages matériels, comme l’aménagement de piscines olympiques ou la réfection des routes. Des communes entières sont ainsi modernisées au fur et à mesure du déploiement du programme nucléaire. La région de La Hague, dans le Nord Cotentin, est un des bons exemples de ces avantages. C’est le visage scintillant de la modernité nucléaire. Aujourd’hui, le même phénomène se produit dans la région de Bure où on trouve des salles des fêtes immenses et toutes neuves, même dans des communes dépeuplées. Il y a toujours eu beaucoup d’investissements pour que les populations soient hospitalières vis à vis du nucléaire.
– Lire à ce sujet notre enquête : Un milliard d’euros ont été dépensés pour rendre « socialement acceptable » l’enfouissement de déchets nucléaires
EDF n’a-t-elle pas également beaucoup investi dans la communication ?
Si bien sûr. L’aspect informationnel – certains diraient propagande étatique – joue un rôle central dans le fait de rendre le nucléaire acceptable. On accentue ses avantages, qui font rêver : une énergie illimitée, zéro coût, avec un risque quasi-nul. Nous savons désormais que les conséquences immenses d’une catastrophe ont conditionné des lois d’exception pour ce secteur. Mais dans la France des années 1970, on pouvait entendre dire que la chute d’une météorite était plus probable qu’un accident nucléaire. Des sommes très importantes sont investies dans la publicité pour « éduquer » le public, notamment les opposants, ceux et celles « qui ne comprennent pas ».
Comment évoluent les stratégies de communication à partir du moment où les catastrophes nucléaires deviennent réalité ?
A la fin des années 1980, suite à l’accident de Tchernobyl, de nouvelles stratégies de communication se mettent en place, avec ce qu’on appelle la dissonance cognitive : il s’agit d’affirmer plutôt qu’être sur la défensive. En 1991, une campagne de communication est ainsi organisée via les journaux et la publicité audiovisuelle qui assène que 75 % de l’électricité est d’origine nucléaire. Il faut que les Français sachent que leur grille pain fonctionne au nucléaire, il faut qu’ils l’acceptent. C’est comme ça, c’est la réalité, plus personne ne peut s’y opposer. Depuis l’accident de Fukushima aussi, cette même stratégie est à l’œuvre. C’est terrible, nous disent les promoteurs du nucléaire, mais c’est comme ça, il faut apprendre à vivre avec. Les programmes de publicité sont à l’inverse d’une tournure pessimiste des choses, avec des enfants qui courent dans la verdure.
Ce nouvel axe de communication, qui affirme qu’il faut « accepter le nucléaire », va de pair avec une nouvelle idée : on peut continuer à vivre dans les territoires contaminés. La Biélorussie, dont une partie importante a été touchée par l’accident de Tchernobyl en 1986, devient un laboratoire grandeur nature pour l’expérimentation de cette nouvelle « idée ». Quel rôle jouent les experts français dans cette normalisation des zones contaminées ?
Au début des années 1990, la Biélorussie est encore dans une économie de type post-soviétique, où l’État s’engage à prendre en charge totalement les victimes. Des systèmes de compensation sont mis en place, la possibilité pour les enfants malades d’aller en sanatorium, etc. Dans la deuxième moitié de la décennie, les organismes internationaux comme l’AIEA, l’OCDE et la Banque mondiale ont commencé à lancer des ultimatums à la Biélorussie pour qu’il accomplisse sa conversion. Les expertises pilotées par l’AIEA et l’OMS jugent que les règles d’évacuation et de compensation sont trop précautionneuses, économiquement insoutenables, politiquement contre-productives et de fait nuisibles à la possibilité d’opérer une transition vers une économie – néolibérale – de marché. Il faut que les gens soient responsabilisés, et qu’ils n’attendent pas tout de l’État, ce n’est pas « moderne ».
« C’est une individualisation des risques, chacun doit apprendre à gérer les becquerels »
C’est à ce moment qu’intervient le programme Ethos, mené par des experts français, issus du CEA et réunis au sein du centre d’étude sur l’évaluation de la protection dans le domaine nucléaire (CEPN), une association loi 1901 ne comptant que trois membres : CEA, EDF et IRSN. Ces consultants se rendent régulièrement en Biélorussie, proposent une « réhabilitation participative » des territoires « moyennement » contaminés. L’idée, c’est que l’on peut rester dans ces villages si on éduque les gens. Exemples : si on a mangé trop de champignons – chargés en radioactivité – le lundi, on mangera des aliments moins chargés le reste de la semaine. Idem pour le temps passé dehors : si on passe plusieurs heures dans un lieu contaminé – la forêt par exemple –, il faut faire attention, les jours suivants, à passer plus de temps chez soi. C’est une individualisation des risques, chacun doit apprendre à gérer les becquerels.
Cette stratégie de « normalisation » des territoires contaminés est-elle également mise en place à la suite de la catastrophe de Fukushima ?
Oui, et c’est en partie à l’initiative des experts français et leur « retour d’expérience » biélorusse. Ceux qui ont mis au point le programme Ethos sont au Japon actuellement. La normalisation des territoires contaminés y a été orchestrée en premier lieu par l’État japonais lui-même. Très vite, elle est devenue un mot d’ordre officiel. Dans un premier temps, en vue de limiter les évacuations, le gouvernement multiplie la dose maximale admissible par vingt, qui est ainsi passée de 1 mSv (millisievert) – la norme en vigueur en Europe et en France pour le fonctionnement « normal » des centrales – à 20 mSv par an. Soit le niveau maximal fixé pour les travailleurs du nucléaire en France et en Europe. Les pouvoirs publics japonais considèrent par ailleurs, depuis 2011, qu’en dessous du seuil de 100 mSv, le risque de développer un cancer radio-induit est proche de zéro – le tabagisme ou l’obésité, disent-ils, sont des problèmes plus préoccupants.
À partir de 2012, les responsables politiques japonais passent à l’offensive en matière de politique de normalisation de l’accident, en n’hésitant pas à parler de la nécessité de « reconquérir » au plus vite la plupart des zones évacuées. En comparaison, les ex-états soviétiques avaient été plus prudents à procéder de la sorte. Le gouvernement japonais investit dont énormément dans la décontamination pour opérer ce prétendu retour à la normale. Il dit à la population : « Revenez, il faut tourner la page, il faut que le Japon achève de faire son deuil. » Pour le moment, ce discours ne semble pas convaincre les personnes évacuées qui peinent à croire que l’on peut vivre heureux dans un univers contaminé. La plupart du temps ils sont stigmatisés par les experts gouvernementaux ou par les non-victimes en tant qu’individus peureux et irresponsables, entravant l’effort national relatif à la reconstruction de Fukushima.
Vous dites que la « normalisation » des territoires contaminés est une aubaine pour les promoteurs du nucléaire, notamment en France. Pourquoi ?
Ces stratégies visent à minimiser les évacuations, et à « normaliser » les territoires contaminés moyennant des normes sanitaires anormales ou des guides pour « apprendre à vivre avec ». Mais ces territoires contaminés ne pourront plus jamais redevenir normaux au sens propre. Ces stratégies sont en fait le moyen, pour l’industrie nucléaire, d’assurer sa survie, de continuer à diffuser le mythe du nucléaire « propre », de rendre ainsi invisibles les dégâts réellement engendrés en cas d’accident. La minimisation des impacts catastrophiques d’un accident nucléaire est ainsi en passe de devenir un grand classique de notre temps.
« Ces stratégies visent à minimiser les évacuations, et à « normaliser » les territoires contaminés »
S’il parait incontestable qu’il faut aider les victimes à s’informer, et à agir vis-à-vis des risques radioactifs qui les menacent, ces démarches de réhabilitation participative des territoires contaminés ont ceci de problématique qu’elles sont portées par des experts ou des institutions nucléaristes. Elles ont tout intérêt à prétendre, par ce biais, auprès de l’opinion publique nationale comme internationale, que les conséquences graves d’un accident nucléaire sont maîtrisées. Tout ceci pose de graves problèmes éthiques et démocratiques, en ce qu’il subordonne l’avenir de nos sociétés à des visions fatalistes, qui déforment la conception même des droits humains de base, dont le droit fondamental des individus à vivre dans un environnement sain.
Propos recueillis par Nolwenn Weiler
Photo : Inspection de l’Agence internationale de l’énergie atomique à Fukushima en novembre 2013 / CC IAEA Imagebank