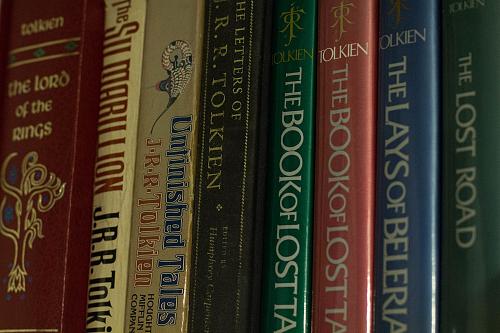Dans le crépuscule, Saïd joue sur deux bidons un rythme à trois temps pour ses compères afghans. L’un d’eux entonne un chant langoureux, où il glorifie « les yeux des femmes ». Éclats de rire, pas de danse et claquements de mains. Des bénévoles tendent l’oreille, questionnent les migrants sur leur parcours, leurs vies en Afghanistan, les raisons de leur exil. Les discussions sont vives d’enseignements : les Afghans parlent de leur sport national, le boskachi, et enseignent la danse à trois temps à quelques bénévoles. Les petites guerres entre associations locales sont oubliées le temps d’une flambée. Elle réchauffe tout le monde, d’autant qu’une bonne partie d’entre eux n’ont ni chaussures, ni passeport.
Encore un reportage dans un camp de réfugiés perdu dans un « no man’s land » ? À Lampedusa ? Sur les îles Canaries ? En Géorgie ou au Tchad ? Non, reportage à Dunkerque.
Entre quelques arbustes givrés, un petit cours d’eau qui commence à se glacer et les rails des trains de Fret, on croise des mutilés de guerre, des grands blessés, des anciens malades. Soignés d’urgence puis relâchés dans la nature. Des jeunes hommes, de 15 à 25 ans, arrivés dans le Nord de la France il y a un, deux, trois mois, voire davantage. Le froid les pousse dans leurs derniers retranchements, et c’est en dansant qu’ils se réchauffent. Les Irakiens préfèrent le chant. Les Afghans, la danse. Chacun de son côté. Pas d’animosité, mais de la fierté. Puis la fatigue.
Ils veulent tous aller en Angleterre. Le marché du travail y est très libéral. On y est embauché aussi facilement qu’on y est viré. La législation sur les papiers d’identité n’y est que peu restrictive. En Afghanistan, on leur a vendu le rêve anglais. Le rêve, ils ne le savent pas encore, ce sont les risques d’expulsion dans le premier pays européen où leurs empreintes ont été enregistrées, souvent la Grèce ou l’Italie, des salaires dûment ponctionnés et des quotidiens de durs labeurs.
« Ils finissent tous par passer », disent les bénévoles.
Mais qui sont ces jeunes hommes qui parviendraient à déjouer les systèmes de sécurité parmi les plus sophistiqués au monde (sondes à oxygène, sondes thermiques, sondes à battement de cœur) ? Comment sont-ils arrivés dans ce purgatoire à ciel ouvert ?
Erish, originaire de Mossoul, dans le Kurdistan irakien, tente de bien se faire comprendre. Il parle mal anglais. La moitié de son corps a été recousu d’urgence. Il a un bras en moins. Son ami grave sur sa main les chiffres correspondant au droit de passage pour l’Angleterre, qu’il a payé rubis sur ongle en Irak. « 17 000. Oui, oui. En dollars », insiste Saïd. Il les réécrit, sur la main d’un autre Irakien, comme pour assurer qu’il n’a pas commis de faute, et que nous croyons bien ce que nos yeux lisent. Pour faire le trajet Mossoul-Dunkerque, trajet qui devrait se ponctuer, si tout fonctionne comme prévu, d’une arrivée en Angleterre d’ici quelques jours, Erish a payé 17 000 dollars.
Il est 15 heures. Ahmad sort de sa toilette, un savon et un tee-shirt au bout des doigts. Il revient du canal, enfile son bonnet et sort son pied de sa chaussure pour le rapprocher des flammes. Il fait quelques degrés au-dessous de zéro.
Nous sommes dans le camp de Loon-Plage, dans le port de Dunkerque, deux semaines après avoir été rasé sur ordre du parquet [1] Le lendemain, le maire de cette petite ville de moins de 7 000 habitants, sans consulter le port ni la Communauté urbaine, ni la Police aux Frontières, ni la Sous-Préfecture, a décidé de suivre l’exemple des maires de Téthegem et de Grande-Synthe, où les camps ont été rasés, puis ravitaillés et aujourd’hui chauffés pendant le grand froid. Branle-bas de combat : une dizaine d’employés municipaux érigent une tente chauffée, avec gaz, électricité et courses au discount du coin payées par la municipalité.

Nous allons à la rencontre de Franck, employé par la mairie depuis trois mois après avoir bossé comme stagiaire dans une entreprise de maçonnerie. Il cale la grande bâche, élève des piquets et tourne des boulons. À contrecœur, visiblement, car ces « Libanais », ces « Kosovars », ont « tout ce qu’ils veulent ici » : « On leur donne de l’argent pour qu’un jour, ils se retournent contre nous, en posant des bombes comme au Printemps, à Paris. Vous avez vu ? »... « Franchement, quand on voit tous les SDF et les Français qui sont dans la rue, je ne suis pas trop d’accord. » Son point de vue ne semble pas partagé par ses collègues, qui louent le geste humanitaire de leur maire, car, vraiment, « il fait trop froid ».
C’est d’ailleurs cette sensation de fraîcheur qui a poussé Éric Rommel (divers gauche) à l’action, après six années de sourde oreille face aux associations : « Hier soir, je m’apprêtais à me rapprocher de ma cheminée, et je me suis rendu compte à quel point il faisait froid. Mes adjoints municipaux ont également eu du mal à s’endormir, tellement il faisait froid. Je me suis dit que ce devait être dur pour les migrants. Dans ces cas-là, c’est la partie humaine qui l’emporte. »
Il n’y aura qu’une petite dizaine de migrants sous la tente municipale ce soir-là. Ce que la mairie n’a pas compris, malgré son élan humanitaire, c’est que la nuit, les migrants essaient de passer sous un camion. Quand les passeurs tardent à venir, ils se livrent à ces tentatives presque toutes vouées à l’échec. Pour bien passer, il faut arroser les douaniers, les routiers et d’autres intermédiaires. C’est le job des passeurs, qu’on ne voit jamais, mais qui ont leurs relais dans les camps. Logique, donc, que la nuit, ils n’accourent pas tous dans ce chapiteau blanc municipal. Mais le maire peut désormais faire bonne figure. Dans les journaux locaux, il dira : « J’ai outrepassé mes droits, c’est vrai, mais il y en a marre d’être l’enfant sage et obéissant. » (La Voix du Nord, 30.12.08) « Je suis complètement hors-la-loi et en plus, je suis sur le territoire du Port Autonome. Peut-être que demain, on viendra m’arrêter chez moi, à 6 heures du matin. » (Le Phare Dunkerquois, 1.01.09). Don Quichotte n’a qu’à bien se tenir.
Retour dans le campement du port.
Erish, le Kurde irakien, aux cicatrices aussi longues que son corps, exprime une envie indéfectible de passer de l’autre côté. Il veut rejoindre ses deux frangins à Manchester. « Ils sont tout ce qui me reste dans ma famille, tous les autres ont été tués par des terroristes à Mossoul. » Il prétend s’être fait mutiler par des terroristes en Irak, avant d’avoir payé les 17 000 dollars.
Son ami nous explique : « Regardez : il a perdu son bras, coupé par les terroristes, et tout son corps a été éventré, puis recousu. Moi aussi j’ai subi des attaques, des coups de couteau. » Erish nous montre ses blessures de guerre. Il n’a pas l’air d’y croire lui-même et ponctue son exhibition corporelle d’un grand sourire désabusé. Erish est fauché, comme les autres. Il attend que le passeur vienne le chercher et a besoin d’une greffe. C’est ce que ses compères lui conseillent de dire : « Il doit prioritairement aller en Angleterre, pour rejoindre ses deux frères. » Mais les bénévoles nous disent qu’il est celui qui, il y a un mois, est « passé sous un camion », d’où ces blessures gravissimes...
Les exilés pensent savoir ce qu’il faut dire aux journalistes, à savoir qu’ils « fuient la guerre », que cette guerre est « sanglante », qu’ils sont des « victimes de l’islamisme et du terrorisme » dans leur pays et qu’ils font les frais d’un affrontement nourri par l’Union soviétique puis par les États-Unis et aujourd’hui par le bloc occidental, uni dans une guerre pour la « liberté immuable ». Mais les journalistes oublient systématiquement d’écrire, dans leurs reportages, que les Afghans et les Irakiens du Nord sont des réfugiés de guerre. Ce sont des « sans-papiers », des « clandestins » ou des « migrants ». Jamais des « travailleurs », des « exilés politiques », des « victimes de conflit international », fussent-elles collatérales. « Il causent des problèmes de sécurité à la SNCF, en divaguant sur les voies ferrées », écrivait La Voix du Nord il y a à peine trois mois (9.09.08) , avant de faire de l’émouvant sujet des « migrants » l’un des plus couverts de ses pages locales de fin d’année. Plusieurs mois de silence, puis des unes tapageuses, des petits éditos alarmistes, des photos choc.
De là à relier la présence militaire en Afghanistan et la situation des exilés échoués dans les communes de Dunkerque...
« Justice » contre « obscurantisme » ?
La France, avec ses 3 000 soldats, est engagée militairement en Afghanistan depuis 2002. Elle est devenue un fidèle allié de Washington - militairement en Afghanistan, et symboliquement en Irak - et jure en permanence faire la guerre pour la liberté du peuple afghan. C’est Bernard Kouchner qui l’a écrit, avec le ministre Morin, dans les colonnes du Monde, le 18 août dernier, quelques jours après la mort de dix soldats français dans une « embuscade » :
« Nous nous battons pour offrir au peuple afghan des conditions de vie acceptables : égalité, justice, recul de l’arbitraire et de la violence. Nous voulons leur apporter cette sécurité nécessaire au développement et permettre aux enfants d’avoir un avenir - c’est-à-dire d’être éduqués et soignés. (...) Ce qui est en jeu, ce sont d’abord nos valeurs. De 1996 à 2001, une dictature barbare, le régime des talibans, coupait l’Afghanistan du reste du monde. La dignité de la femme y était bafouée, les Droits de l’Homme inexistants, l’obscurantisme et la terreur omniprésents. Sous ce régime, les femmes n’étaient ni scolarisées ni soignées, les opposants étaient pendus dans les stades, la culture et la civilisation du pays reniées. »
Évidemment, les deux « ministres d’ouverture » ne piperont mot des actions de représailles menées par l’armée française quelques jours après l’embuscade mortelle. Pourtant, les soldats français se sont bel et bien vengés sur des victimes civiles, en août dernier, en tirant quatre missiles Milan sur les hameaux à proximité du lieu de l’embuscade, dans la vallée d’Uzbeen. « Plusieurs dizaines de civils » ont été tués durant cette opération ainsi que par le raid aérien du lendemain, selon la seule agence de presse afghane indépendante, Pahjwok [2]. En parlant des victimes civiles de ces représailles militaires, le colonel Rumi Nielson-Green, porte-parole de la coalition dira : « Je ne suis pas certain qu’ils étaient directement impliqués dans l’attaque contre les Français. Ça n’a aucune importance. Ils étaient certainement au moins complices. »
Puisque les « valeurs occidentales » d’égalité et de justice sont en jeu, puisqu’il s’agit d’un « conflit de valeurs » - « justice » contre « obscurantisme » - comment expliquer que sur le sol français, les droits des victimes civiles de l’affrontement entre talibans et troupes de l’Otan (et armée afghane), puis celles de l’invasion américaine - qui pilonne l’Irak depuis 2001 - soient systématiquement bafoués ?
Le 4 septembre 2008 à Paris, en marge d’une conférence interministérielle sur le droit d’asile intitulée « bâtir une Europe de l’Asile », la Coordination française pour le droit d’asile (CFDA) a publié un rapport de 185 pages intitulé « la loi des "jungles" » [3] dans lequel elle dénonce l’absence de reconnaissance juridique, les persécutions policières et les conditions de vie ultra-précaires des quelque 1 000 à 1 500 migrants éparpillés dans la nature, le long des autoroutes ou à proximité d’un terminal ferry, des côtes belges jusqu’aux ports normands, en passant par Paris. Largement relayé par les médias français, le rapport n’a fait que précéder une période d’intensification des opérations policières sur le terrain.

Si les municipalités du Dunkerquois se voient forcées de faire amende honorable en levant des subventions, des tentes chauffées ou des salles municipales (Téthegem, Grande-Synthe, Loon-Plage), au niveau national, le mutisme prime. Lors de son passage à Hoymille, le 19 décembre, près de Bergues, ville où était inaugurée une des plus grandes gendarmeries de France, la ministre de l’Intérieur Michèle Alliot-Marie a battu d’un revers de la main les propositions de rencontre émises par des associations, des partis politiques, et le maire de Dunkerque, Michel Delebarre (PS), qui affirme, comme ses confrères, la main sur le cœur, que « dans ce problème, il n’y a pas de solution miracle ». Son grand opposant, Franck Dhersin, maire UMP de la ville de Téthegem, vient de libérer une salle et des douches pour l’accueil de nuit des migrants. Deux mois plus tôt, il expliquait à ses administrés qu’il avait, « avec humanité, et avec l’aide de la police, démonté des campements autour du lac » (La Voix du Nord, 11.09.08). Changement de stratégie ? Trêve hivernale ? Toujours est-il, qu’il n’y a « pas de solution ». À moins que...
Dans un éclair de lucidité, l’élu tente un début de proposition : « Il existe une solution : arrêter de bombarder l’Irak et l’Afghanistan ! »
Raccourci ? Provocation ?
De son côté, le maire de Loon-Plage, Éric Rommel (divers gauche), soutient « de tout (s)on cœur les soldats français en Afghanistan ». Ils « font leur boulot et je suis contre les journalistes qui leur tombent dessus quand on apprend qu’ils ont tué un Afghan ». L’élu local le martèle : la présence française en Afghanistan n’a « rien à voir » avec le fait que ces exilés se retrouvent ici. « Si demain l’armée française se retire d’Afghanistan, il y aura encore des réfugiés à Loon-Plage. Il y a six ans déjà, ils étaient encore plus nombreux ici, dans le port. »
Il y a six ans, déjà, la France envoyait un millier d’hommes pour subordonner la « liberté immuable » du peuple afghan...
Employés par la coalition, forcés à l’exil
Autour du feu, alors que l’on danse pour les invités - quatre bénévoles et un journaliste -, un grand brûlé et un ancien malade de la gale, soignés, puis relâchés dans la « jungle », se serrent les coudes en se balançant doucement. Akhbal Saïd préfère parler sous son écharpe. Ses yeux sont méfiants, son humeur, mauvaise et sa patience, à bout - ou presque. Depuis plusieurs jours, les ferry-boats ne partent pas pour cause de grand froid. Les passeurs repoussent donc sans cesse le jour du départ. Et cet Afghan de presque 20 ans en a assez, semble-t-il, des conserves de haricots verts. Il y en a une bonne centaine, sur la palette, à côté de lui.
S’il parle un si bon anglais, c’est qu’il a travaillé pendant quatre années pour les forces d’occupation anglo-américaines en Afghanistan. C’est ce qui l’a fait fuir son pays, où, pour les talibans, il est devenu un « traître » à abattre. En parlant, il a l’air de se méfier de ses voisins. Il livre quelques secrets, demande de ne pas les dire aux autres et de respecter sa parole. Il se lance. « Alors voilà. J’ai bossé quatre ans pour deux sociétés de sécurité, dans la province de Kounar. La première est anglaise, elle s’appelle Odia. J’y ai passé deux ans et demi comme garde. La seconde est américaine et s’appelle Cobra. J’y ai passé un an et six mois en tant qu’informaticien. C’est une bonne société. Dans le camp « Topchi » - ça vient du russe - je travaillais vingt jours d’affilée, puis j’avais dix jours de pause pour un salaire de 350 dollars. En Afghanistan, tu vis bien avec ce salaire. Mon père travaillait pour Cobra depuis longtemps comme sergent supplétif et mécanicien, spécialisé dans les armes. Il s’est fait tuer par des talibans il y a deux ans, parce qu’il travaillait pour les Américains. »
Les États-Unis, dit-il, lui ont proposé l’asile, mais « seulement dans un an ». Long, trop long. Il aurait risqué sa vie. Il s’est donc lancé dans le périple. « Pour venir ici, en Europe, les gens comme moi, qui ont perdu leurs parents, vendent leurs maisons ou économisent pendant des années, puis paient un passeur. Moi c’est mon oncle qui me l’a présenté. J’ai payé 10 000 dollars. » Dans sa ville de la province de Kounar, les talibans ont gardé le contrôle local et continuent de terroriser les habitants. « Sachant que je bossais pour les Américains, j’ai reçu la visite de talibans. Ils m’ont averti une fois, puis deux. Mon père a été tué et c’est après sa mort que j’ai compris que j’allais moi aussi être visé. Mon oncle m’a parlé de ce réseau pour rejoindre l’Europe. Les Américains m’ont proposé de venir aux États-Unis, comme réfugié, mais ils me proposaient de venir dans un an. Avec les menaces des talibans, jamais je n’aurais passé l’année. »
Pour passer la frontière, Akhbal Saïd attendra que le passeur vienne le chercher. Voilà 45 jours qu’il est dans ce camp. « Il doit venir dans six jours, nous disait-il quelques jours après Noël. Les passeurs sont des gens qui font l’aller-retour entre la France, la Belgique et la Grande-Bretagne. Rien que pour passer, ça coûte entre 3 000 et 4 000 livres. Mais moi j’ai déjà payé. Normalement, je dois passer bientôt. J’en ai assez d’être ici. Le plus dur c’est d’accepter l’aide humanitaire, de ne pas avoir le choix de tendre la main. C’est la première fois que j’accepte de la nourriture, comme ça. C’est dur d’accepter ça. »
Julien Brygo