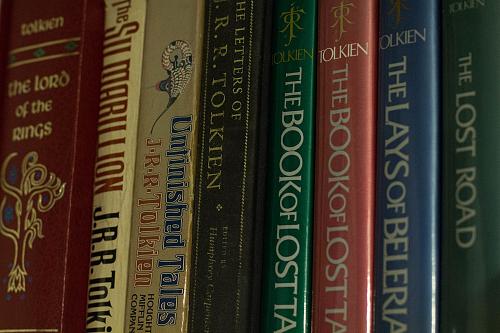Spécialiste de la question scolaire ou des dominations et des inégalités, collaborateur de l’Institut national d’études démographiques (Ined) dans son unité « Migrations internationales et minorités », Ugo Palheta analyse, non sans inquiétude, l’actuelle « dynamique néofasciste » à l’œuvre dans des États reposant pourtant a priori sur des principes démocratiques. Une tendance due aux « effets politiques des contre-réformes néolibérales ».

Avec l’accroissement des inégalités sociales, « la possibilité du fascisme », entre aiguisement des nationalismes et intensification du racisme, est selon lui un risque à appréhender. Il rappelle que les Brésiliens avec Bolsonaro, les Hongrois avec Orban ou les États-uniens avec Trump en ont déjà fait l’amère expérience. La France est-elle le prochain pays sur cette liste ?
Politis : La plupart des commentateurs n’ont cessé de présenter comme « impensables », à la veille des élections dans ces pays, les victoires de Trump, de Bolsonaro ou des ultraconservateurs polonais du PiS. Comment expliquer ce refus d’appréhender ces réalités ?
Ugo Palheta [1] : Je vois plusieurs raisons. L’une des plus importantes, dans le Nord global, c’est que nous imaginons souvent que nos pays en auraient fini avec les formes de barbarie des siècles précédents, alors même que celles-ci ont eu principalement l’Europe pour épicentre. Que ce soit l’esclavage, le colonialisme, le fascisme, les guerres mondiales et bien sûr le génocide des Juifs d’Europe et des Roms commis par les nazis ; cela sans nier les atrocités commises ailleurs par des pouvoirs tyranniques.
Disons que, dans l’imaginaire dominant des pays d’Europe, on réserve la barbarie, la dictature ou les politiques d’épuration ethnique à des pays lointains, d’Afrique, d’Amérique latine ou d’Asie. Or, ce nationalisme radical de purification qu’est le fascisme est bien né sur le Vieux Continent et n’a pas disparu dans les décombres du bunker d’Hitler en 1945, comme le rappelait souvent l’historien du fascisme Zeev Sternhell.
Après l’éclipse de l’après-guerre, dans une Europe traumatisée par le second conflit mondial, le fascisme a été contraint de muter pour renaître et reprendre sa marche en avant. À partir des années 1970, chaque crise lui a permis de progresser, à des rythmes différents selon les pays. En centrant son activité sur la scène électorale et médiatique, il a adopté la guerre de position comme stratégie politico-culturelle, au sens de Gramsci.
Même si des petits groupes violents se développent dans son sillage en cherchant à tenir la rue et, pour cela, en commettant des agressions contre les minorités (ethno-raciales, de genre, sexuelles) et les militantes féministes, antiracistes, antifascistes et de gauche. Jusqu’à commettre des attentats, pour certains militants fascistes isolés.

Diriez-vous qu’un même déni est, sinon en cours, du moins tout à fait semblable, en France ?
Je dirais que le déni a longtemps été plus fort en France qu’ailleurs, parce qu’on s’imagine bien souvent que notre pays serait une sorte de phare de l’humanité : la « patrie des droits de l’Homme ». Certains historiens ont même prétendu que la France avait été « allergique » au fascisme au XXe siècle : du fait notamment de la profondeur de l’ancrage des idées républicaines et de l’existence d’autres traditions à droite, le fascisme n’aurait pas pu trouver de terrain favorable et donc se développer.
Or c’est oublier qu’il y eut des mouvements de masse authentiquement et indéniablement fascistes dans les années 1930 (par exemple le Parti populaire français de Jacques Doriot), que d’autres mouvements de masse (comme les Croix de-Feu) avaient plus qu’un air de famille avec le fascisme, et que le régime de Vichy fut une dictature qui emprunta nombre de ses traits au fascisme (en particulier à sa variété portugaise que fut le salazarisme). C’est aussi oublier à quel point l’un des principaux axes de propagande des fascismes européens, à savoir l’antisémitisme, fut central et endémique dans la politique française dès la fin du XIXe siècle et jusqu’au milieu du XXe siècle.
C’est oublier enfin combien la République fut compatible avec l’entreprise coloniale, et tout ce que celle-ci comportait de politiques de déshumanisation, de hiérarchisation raciale, d’accaparement de biens, etc. Des traits qui sont bien communs avec le projet fasciste. Rien d’étonnant, donc, à ce que, parmi les fondateurs du FN, se soient mêlés des collaborationnistes (pétainistes) et des nostalgiques de l’Algérie française – dont certains se vantaient même d’avoir torturé pendant la guerre coloniale.
Quels sont les signes qui vous laissent penser que cette « possibilité du fascisme », pour reprendre le titre d’un de vos récents livres, n’est peut-être pas aussi lointaine ? Que cela n’arrive pas « qu’aux autres » ? Et comment les réseaux numériques accroissent-ils un tel risque ?
On ne compte plus les « symptômes morbides », pour parler comme Gramsci. Il y a par exemple les dissolutions de collectifs antiracistes luttant contre l’islamophobie (CCIF et CRI), de collectifs anticolonialistes (Palestine vaincra) ou antifascistes (Gale, à Lyon). Il y a également les lois jumelles liberticides imposées il y a deux ans, dites « sécurité globale » et « contre les séparatismes », qui conjointement intensifient l’autoritarisme et institutionnalisent encore un peu plus l’islamophobie.
On pourrait évoquer évidemment aussi les politiques antimigratoires et leurs conséquences criminelles depuis plusieurs décennies, ou l’indifférence généralisée vis-à-vis du sort terrible que subissent les exilées et la manière dont les appareils de répression de l’État les brutalisent continûment. Il y a aussi la manière dont fonctionnent les institutions politiques en France, avec un pouvoir énorme concentré dans l’exécutif et une marginalisation de l’Assemblée nationale, qui n’est plus pour l’essentiel qu’un théâtre d’ombres : pendant la crise sanitaire, toutes les décisions étaient prises par le président de la République en conseil de défense, soit en toute opacité. Si les institutions de la Ve République ont toujours été bien peu démocratiques, le macronisme en a encore accentué les traits les plus autoritaires, à tel point que nous ne nous situons déjà plus dans le cadre de ce qu’on appelait les « démocraties bourgeoises ».
Enfin, il faut rappeler les violences policières, presque toujours impunies, qui sont historiquement endémiques dans les quartiers populaires et d’immigration, et qui se sont largement intensifiées contre les mouvements sociaux depuis 2016, puis la répression policière et judiciaire ahurissante durant le mouvement des Gilets jaunes.
Vous vous méfiez beaucoup des anachronismes ou des comparaisons aventureuses ou simplistes chevauchant les époques. Le terme « fascisme » convient-il pour décrire les régimes de Trump, Bolsonaro et consorts ? Convient-il aussi pour celle qui pourrait arriver au pouvoir en France ?
Il est intéressant de voir combien nombre de chercheurs sont gênés par la comparaison des extrêmes droites contemporaines avec le fascisme historique, mais emploient volontiers la catégorie « populisme », celle-ci renvoyant à des mouvements passés (les populismes russe et étatsunien du XIXe siècle, ou les populismes latino-américains) qui n’ont à peu près rien à voir avec les extrêmes droites d’aujourd’hui.
En vérité, il y a de nombreux traits communs entre le fascisme historique et ces extrêmes droites, avec des différences qui justifient le fait de parler – pour être tout à fait précis lorsqu’on caractérise le projet de la plupart des organisations d’extrême droite – de « néofascisme ». C’est-à-dire une forme nouvelle de fascisme.
Il est vrai toutefois que cette catégorisation « fasciste » ne convient effectivement pas pour décrire leur régime puisque, précisément, ils ne sont pas parvenus – pour l’instant dans le cas de Bolsonaro – à utiliser leur victoire électorale pour transformer profondément l’État et bâtir une dictature. Preuve qu’il ne suffit pas pour les fascistes de gagner une élection pour être ipso facto en capacité de mettre en place un régime à leur entière botte, parce qu’ils rencontrent nécessairement des résistances (mouvements sociaux, secteurs de la classe dominante rétifs par intérêt à une solution ultra-autoritaire, etc.). D’autant plus que les néofascistes ne disposent pas (sauf peut-être en Inde aujourd’hui) du type d’organisations de masse que les fascistes historiques avaient su créer jadis.
Dans notre livre avec Ludivine Bantigny, nous parlons de « fascisation » pour désigner précisément un processus, à la fois idéologique et matériel, de transformation de l’État dans un sens fasciste. Une leader ou une organisation néofasciste peut parvenir au pouvoir sans réussir à mener jusqu’au bout le processus de fascisation.
Par ailleurs, ce type de processus peut s’enclencher sans que des forces fascistes soient au pouvoir ; c’est la manière dont nous analysons ce qui se joue en France depuis quelques années, avec notamment le macronisme, cet autoritarisme du capital qui est allé de manière systématique sur le terrain des réactionnaires (comme les lois déjà évoquées, la loi « asile et immigration » ou la dénonciation du prétendu « islamo-gauchisme », etc.). Évidemment, l’arrivée au pouvoir de Le Pen aurait pour conséquence d’accélérer ce processus, en intensifiant l’assujettissement et la brutalisation des minorités, et l’écrasement des mouvements de contestation sociale.
Propos recueillis pour Politis par Olivier Doubre
Photo : Cortège antifasciste à Paris / © Yann Lévy