
Basta! : Votre ouvrage Blanc de plomb, histoire d’un poison légal raconte comment les industriels ont réussi à généraliser l’usage de ce produit au 19e siècle, alors même que sa toxicité était déjà largement documentée. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces dangers ?
Judith Rainhorn : L’usage du plomb à l’échelle industrielle, à partir du 19e siècle, se fait effectivement sur un savoir scientifique très largement établi. On sait depuis l’Antiquité que ce produit est dangereux. Et dès le milieu du 17e un lien très clair est établi entre la fréquentation quotidienne du plomb et certains symptômes. On a par exemple des témoignages d’ouvriers des mines de plomb, en Allemagne, qui décrivent ce que l’on appelle « la colique de plomb » qui est souvent le premier des symptômes : ils décrivent des douleurs qui s’apparentent à des chats qui leur déchireraient l’estomac et les entrailles avec leurs griffes.

En même temps, ces symptômes ne sont pas spécifiques : les maux de tête, les vomissements, la fièvre parfois peuvent aussi être dus à d’autres facteurs. Cela participe à l’invisibilisation du danger, qui est une constante dans l’histoire du plomb, comme dans celle de beaucoup de produits toxiques. À cela s’ajoute le fait que, jusqu’au milieu du 20e siècle et le développement massif du salariat, il y avait beaucoup de nomadisme professionnel : les travailleurs se déplaçaient beaucoup d’un chantier à l’autre, d’une mine à l’autre, d’une usine à l’autre. Cela qui ne facilitait pas la traçabilité des expositions professionnelles et des maladies.
Dès le début du 19e, c’est-à-dire en même temps qu’il devient un produit de consommation courant, notamment dans les peintures, le plomb est présenté comme un poison dans la littérature médicale. Cette connaissance est largement accélérée par le travail de Louis Tanquerel des Planches, un jeune médecin français qui consacre sa thèse (1839) aux graves effets du plomb sur la santé, et qui ne cesse ensuite de traquer ce toxique dans les parcours des gens malades qu’il soigne. C’est à lui que l’on doit la généralisation du terme de « saturnisme ». Citons, parmi ces effets : des coliques intolérables, des souffrances articulaires, la paralysie ou encore des atteintes neurologiques. On sait aujourd’hui que le plomb est un cancérogène pour le foie et les reins.
Plusieurs stratégies sont mises en place pour que l’usage du plomb se développe malgré ces terribles dangers. L’une d’elles consiste à mettre en cause la responsabilité individuelle plutôt que celle de l’organisation du travail…
Oui, c’est une tendance de fond très claire quand on se penche sur cette période, d’autant plus que la Révolution française a brandi l’individu comme acteur de sa vie et de son destin politique. Dans la seconde moitié du 19e siècle, on assiste au développement de l’hygiénisme. C’est un mouvement novateur qui met le doigt sur le fait que les pathologies viennent autant de l’environnement que des agents pathogènes.
Prendre en compte l’ensemble des facteurs qui contribuent à l’état de santé peut être vu comme un progrès, mais le problème est que l’on valorise à l’extrême l’environnement – habitat, habitudes de vie, alimentation, alcoolisme, hygiène, etc – tout en déculpabilisant les produits auxquels les ouvriers sont exposés dans le cadre du travail. L’hygiénisme permet de faire valoir que le produit toxique est loin d’être le seul à causer la maladie, quand bien même sa toxicité est parfaitement documentée.
Ainsi, les industriels affirment qu’il est possible de vivre avec les produits toxiques, comme le plomb, si l’on prend des précautions : c’est aux individus d’être attentifs à la manière dont ils manipulent les poisons. On oppose ainsi les « bons » et les « mauvais » ouvriers, qui sont rendus responsables de leur propre intoxication par manque de précaution hygiénique.
La variabilité de sensibilité aux produits toxiques joue également en faveur de cette individualisation des risques, puisque chacun réagit différemment aux contacts avec les produits toxiques. On ignore alors - et encore largement aujourd’hui - les raisons de cette variabilité, ce qui permet toutes les hypothèses, en particulier d’incriminer des comportements problématiques associés, comme l’alcoolisme, par exemple.
Le discours des industriels, amplement relayé par les institutions et les pouvoirs publics, n’a pas beaucoup changé depuis 150 ans. Si l’on en croit par exemple les difficultés pour obtenir la reconnaissance d’une maladie professionnelle consécutive à l’exposition à des pesticides….
Effectivement. Je pensais beaucoup aux agriculteurs victimes de pesticides quand je lisais les discours des entrepreneurs de l’industrie de la céruse au 19e siècle. Les similitudes sont frappantes : « Vous devez porter des masques » (qu’ils ne fournissent pas en général), « vous devez vous laver les mains », « vous devez garder les ongles courts ». Ce dernier point est tout le temps présent au début du 20e siècle : il faut que les ouvriers se coupent les ongles.
Cette mention a réapparu au moment de l’incendie de Notre-Dame, en 2019. Dans les circulaires de la Préfecture, on pouvait lire qu’il fallait que les femmes enceintes et les enfants « gardent les ongles courts », et se lavent les mains en rentrant chez eux. Il y a une vraie continuité historique dans l’imputation de la toxicité à des comportements individuels inappropriés, c’est tout à fait fascinant.
Vous expliquez aussi dans votre ouvrage que la Révolution française de 1789 n’a pas favorisé la visibilisation des dangers du plomb, au contraire.
C’est étonnant, mais c’est vrai. Contrairement à ce que l’on pourrait croire de façon intuitive, la Révolution française n’a pas facilité la prise en compte de la santé au travail. En 1791, elle a mis fin aux corporations de métiers, considérées comme des institutions de l’ordre social d’Ancien Régime.
Mais cela a complètement désorganisé les collectifs de travail et joué comme un facteur d’invisibilisation de la santé au travail, car des espaces de parole et de mobilisation au sein du monde ouvrier ont été supprimés. Auparavant, la question de la santé des ouvriers était apparue comme une question importante et la médecine s’y intéressait depuis les années 1770.
D’autre part, un fameux décret de 1810, publié à l’initiative des industriels de la chimie (dont Chaptal), organise l’irresponsabilité des industriels à l’égard des dommages qu’ils créent pour les voisins de leurs usines : il ne mentionne même pas la santé au travail. Il faut aussi évoquer le travail de dénigrement des produits de substitution qui ont été mis au point pour remplacer la mortelle céruse, en l’occurrence le blanc de zinc, dont le brevet a été déposé en 1845 en France, et qui était inoffensif pour la santé humaine. Il n’est jamais parvenu à s’imposer sur le marché face au blanc de plomb qu’il aurait dû remplacer.
Il y a également toute une rhétorique sur la nécessaire acceptation du risque professionnel. Et cette acceptation est en quelque sorte « relayée » par la culture ouvrière virile, ainsi que par l’absence de mobilisation syndicale spécifique. Pouvez-vous revenir sur ce point ?
Avant les années 1970 et 1980, le syndicalisme aborde peu la question de la santé au travail. Au moment de sa fondation, dans les années 1880, le syndicalisme ouvrier s’intéresse très peu à ces problèmes, qui semblent très périphériques et sont noyés dans les conditions de travail, les luttes étant plutôt consacrées au temps de travail et aux salaires.
Certains secteurs ont lutté précocement, comme les mines, en raison de leur dangerosité : en 1890, sont institués les délégués mineurs à la sécurité. À partir des années 1930, certains membres de la CGT s’y intéressent, mais la commission en charge de ces questions reste très marginale [1]. Les négociations sur les maladies professionnelles sont l’occasion d’affrontements avec le patronat. Mais, en général, l’acceptation du risque professionnel chez les ouvriers - en particulier les hommes - est assez générale, comme faisant partie des « risques du métier ».
En tant qu’historienne, j’ai vu fréquemment apparaître le déni du risque par les ouvriers, dans les archives. Certains peintres en bâtiment ont les bras paralysés, ce qui est le symptôme d’une intoxication au plomb déjà grave, mais ils nient être malades quand on leur parle du poison. La confrontation au risque a longtemps fait partie de la culture ouvrière. Et il ne faut pas oublier que travailler en portant un masque toute la journée est très compliqué, en particulier quand la chaleur rend le masque très inconfortable et que les cadences imposées restent élevées.
Vous vous êtes aussi intéressée à la fabrication de la loi sur l’interdiction du plomb, qui participe paradoxalement à la permanence de son usage.
Oui, et c’est un peu la grande déception mise en évidence par cette recherche… Quand on s’intéresse à la fabrication de la loi et à la manière dont elle est négociée, on voit à quel point les industriels sont venus négocier pied à pied et grignoter peu à peu les droits des ouvriers. On peut ainsi constater de grandes différences entre le projet de loi et le texte finalement voté. Il y a une vraie difficulté à contraindre les patrons pour qu’ils modifient leur outil de travail ou les substances qu’ils utilisent. Et même quand des lois sont finalement votées, il est très compliqué de les faire appliquer.
C’est vrai pour la loi de 1909, qui interdit l’usage de la céruse et des composés du plomb dans la peinture en bâtiment : elle a nécessité huit années de tractations. Elle est censée être appliquée à partir de 1915 mais la guerre arrive et le texte tombe en quelque sorte dans l’oubli. Quand le conflit prend fin, les fabricants recommencent à produire de la peinture au plomb comme si la loi n’existait pas. Il n’y a ni contrôle ni coercition.
Certains usages restent autorisés, ce qui rend ce travail de contrôle particulièrement difficile, voire impossible. On a donc une loi votée et promulguée, mais pas de changement majeur sur le marché de la peinture. Même chose en 1921, quand l’Organisation internationale du travail (OIT) interdit l’usage de la céruse pour les travaux intérieurs : les États membres de l’OIT ne font pas tous ratifier par leur parlement la convention internationale qu’ils ont pourtant défendue à Genève. Le texte n’est appliqué que dans quelques pays – et pas de manière stricte, comme en France.
En 1993, une directive européenne interdit la peinture plomb partout … sauf dans certains usages comme la réfection de bâtiments historiques. On peut également citer l’exemple de peintures importées du Canada et contenant du plomb, mais qui sont passées entre les gouttes de la législation, car elles ont été présentées comme des produits d’entretien de la voirie. La permanence du flou autour d’une interdiction, qui n’est pas totale et qui prévoit beaucoup de dérogations, joue clairement en faveur du maintien de produits toxiques.
Aujourd’hui, « le poison blanc demeure là, tapi dans les immeubles insalubres des grandes villes contemporaines », écrivez-vous. Qui sont ceux et celles qui souffrent de saturnisme en France, en 2023 ?
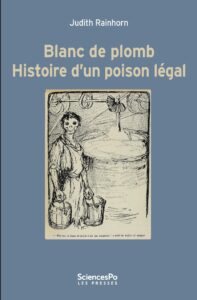
Il faut insister sur l’exposition des enfants qui habitent des logements insalubres dans lesquels les vieilles peintures au plomb s’écaillent. Les enfants vivent dans la poussière de plomb. Actuellement, dans le logement indigne, c’est une importante question de santé publique dans certaines grandes villes, comme dans la périphérie de Paris et à Marseille. Malgré l’instauration du constat de risque d’exposition au plomb (CREP) obligatoire en 2000, il y a encore du saturnisme infantile dans les logements dégradés, ainsi que, pour des populations mal logées ou sans logis, sur les chantiers de récupération de vieux métaux.
Rappelons que le saturnisme est particulièrement dangereux pour les enfants, qui sont très vulnérables aux intoxications au plomb, qui est responsable, chez eux, de retards psychomoteurs graves et irréversibles, entraînant des difficultés d’apprentissage très sérieuses. À l’échelle mondiale, c’est encore pire. Un rapport de l’Unicef en 2020 établit que 800 millions d’enfants dans le monde sont intoxiqués par le plomb, très largement en raison de leur environnement de travail. On peut citer par exemple les montagnes de déchets électroniques qui arrivent dans certains pays d’Afrique et d’Asie et que les enfants manipulent à mains nues.
Dans l’industrie, le saturnisme est courant dans les secteurs de la pétrochimie, de la verrerie et notamment de la verrerie d’arts et, plus encore, dans les métiers du bâtiment amenés à poncer des peintures au plomb. Les plombiers zingueurs sont également exposés, de même que les ouvriers d’échafaudages comme on a pu le voir lors du chantier de réfection de Notre-Dame de Paris. Le choix ayant été fait de reconstruire le toit de la cathédrale en plomb, en dépit des nombreuses alertes par des scientifiques, des syndicats et des élus, la fabrication, le transport et la pose du plomb laminé (usiné en fines couches), émettent de grandes quantités de poussière.
D’autre part, le Haut Conseil de la santé publique a attiré l’attention sur le fait que les eaux de ruissellement sur le toit de la cathédrale vont nécessairement contenir du plomb, que l’on va donc retrouver en aval sur les trottoirs et, à terme, dans les égouts et dans la Seine. La toxicité environnementale du plomb est considérable et peut difficilement être régulée : c’est un polluant extrêmement durable et dont on peine à se débarrasser. La seule solution pour interrompre la pollution est d’arrêter d’en produire et d’en utiliser.
Propos recueillis par Nowenn Weiler
Photo de Une : © Yann Lévy / Basta!








