Basta! : Raconter le football comme outil de transgression et d’émancipation apparaît aujourd’hui surprenant, presque « contradictoire » diraient certains alors que l’argent domine le haut niveau et que la Coupe du monde est organisée par un régime autoritaire. D’où vous est venue cette idée de livre ?
Mickaël Correia [1] : On dit toujours que ce sont les gagnants, ou tout du moins les dominants, qui écrivent l’Histoire. Dans le cas du football, il existe une histoire officielle, jalonnée par les grandes compétitions aux mains des fédérations, avec ses équipes de légende et ses héros mythiques tels Pelé. Cette histoire met en avant un football d’élite et véhicule une certaine vision du foot, celle d’un simple divertissement marchand, d’une culture de masse, avec toujours la même rengaine : « Le foot c’est juste du sport, ce n’est pas politique. »

Je voulais me pencher sur le football en tant qu’objet social et culturel, explorer sa dimension politique. Écrire une histoire « par en bas » du football, c’était d’abord remettre en avant un foot qui est pratiqué au quotidien, dans les petits clubs amateurs comme dans la rue, par des millions de joueurs et de joueuses. C’est surtout démontrer que ce sport a été un creuset de résistance face à l’ordre établi, qu’il reste un instrument d’émancipation pour les différents groupes sociaux opprimés à travers l’Histoire : les ouvriers comme les peuples colonisés, les femmes comme les jeunes précarisés ou encore les Palestiniens.
Vous racontez comment différentes luttes se sont appuyées sur le football, avec certains exemples parfois méconnus, à l’image du rôle du football dans la rébellion zapatiste au Chiapas. Quelle expérience vous a le plus étonné ?
Le football a souvent accompagné les grandes luttes sociales. En Angleterre, durant la Première Guerre mondiale, les ouvrières qui travaillaient d’arrache-pied dans les usines d’armement – d’où leurs surnoms de « munitionnettes » – ont profité d’une domination masculine moins prégnante – du fait de l’absence des hommes, alors sur le front – pour s’émanciper. Elles ont demandé à pouvoir pratiquer le football, le loisir de leur père, frère ou mari. Près de 200 équipes d’ouvrières-footballeuses ont vu le jour ! Ces pionnières du foot féminin vont devenir extrêmement populaires : en 1920, plus de 50 000 spectateurs assistent à Liverpool à un match de deux équipes de munitionnettes ! C’est une histoire totalement mise sous le tapis. Elle a pourtant nourri la première vague féministe, mouvement alors notamment conduit par les militantes suffragistes. Ces footballeuses ont fait preuve de beaucoup d’opiniâtreté et de courage face aux moqueries et réticences des hommes et des fédérations de football.
A partir de 1981, au Brésil, le club de São Paulo, SC Corinthians, va se muer en étendard de la contestation de la junte militaire, au pouvoir depuis 1964. Le directeur sportif et quelques joueurs mythiques, comme Sócrates, Casagrande ou Wladimir, instaurent des pratiques d’autogestion et de répartition équitable des bénéfices au sein du club – une révolution dans le foot brésilien de l’époque, alors très autoritaire. Rapidement, le club incarne un laboratoire populaire de la démocratie, d’autant plus qu’il brille à l’échelle nationale. Là aussi, l’impact sur la société est important. À travers les Corinthians, le peuple brésilien finit par se demander : « Si l’autogestion et la démocratie directe fonctionnent dans le football, ce milieu si encadré par les militaires au pouvoir, pourquoi cela ne marcherait-il pas à l’échelle de la société ? » C’est ainsi qu’un immense mouvement anti-dictature, Diretas Já, finit par converger avec cette équipe, au point qu’on retrouvera Sócrates en tête de cortège des grandes manifestations de 1983-1984. La mobilisation mettra fin au régime militaire en 1985.
Quant au Chiapas, les militants zapatistes utilisent le football comme un langage universel. Le sous-commandant Marcos mobilise régulièrement le foot dans ses écrits, afin notamment de traduire via des métaphores la stratégie politique des zapatistes face au pouvoir central mexicain. Le foot est aussi utilisé pour susciter de nouvelles formes de solidarité. À Mexico, des matchs sont organisés pour populariser leur combat. Des militants internationaux se rendent dans les communautés zapatistes pour pratiquer le foot – dont l’artiste Banksy, qui après une partie de foot au Caracol de la Realidad, y peindra une fameuse fresque pro-zapatiste. Le club italien Inter de Milan, via l’emblématique joueur argentin Javier Zanetti, se fait également le relais de la résistance zapatiste via un programme de solidarité avec les communautés chiapanèques.
La lutte des supporters contre la répression policière et judiciaire, dès les années 1980, est aussi un pan de l’histoire sociale complètement oublié. Ils sont pourtant le premier groupe social à être massivement surveillé, fiché, et pour lequel on a créé un arsenal juridique spécifique. Depuis vingt ans, les supporters constituent les cobayes des mesures liberticides et des violences policières que de nombreuses franges de la population subissent aujourd’hui.
N’est-ce pas anachronique, aujourd’hui, d’évoquer le football comme vecteur de revendications ? Où trouver ces espaces actuellement, en France et ailleurs ?
Le football est plus que jamais un vecteur de contestation. Peu de gens le savent, mais les supporters de foot ont joué un rôle fondamental durant les Printemps arabes de 2011 ou lors du mouvement Gezi de 2013, à Istanbul en Turquie. En Égypte, les premiers slogans hostiles au régime autoritaire de Moubarak sont entendus dans les stades du Caire, où les supporters ont subi dès 2007 une féroce répression policière pour leur contestation dans les tribunes. Ces derniers ont élaboré des pratiques d’auto-défense face à la police. Lorsque le mouvement révolutionnaire égyptien a éclaté, en janvier 2011, ces supporters sont devenus le « bras armé » de la défense de la Place Tahrir. Au point que nombre d’observateurs ont pu dire : « Durant l’occupation Tahrir on s’est souvent cru au stade ». Aujourd’hui encore, les tribunes, tout particulièrement en Algérie, restent le seul espace de liberté totalement autonome pour la jeunesse maghrébine. Libérées du carcan étatique et familial, elles sont le lieu où l’on peut se forger une vraie culture politique et clamer son aversion au régime en place.
En France, un rapport de force est actuellement en train de s’établir entre les institutions sportives – c’est-à-dire la Fédération (FFF), la Ligue (LFP) et les directions des clubs – et les supporters. Face aux investisseurs qui n’appréhendent le foot que comme un vulgaire produit économique, les supporters défendent un football populaire, ancré dans l’histoire sociale de leur club. Ils revendiquent entre autres des places à tarifs abordables ou encore la possibilité d’animer les tribunes avec des fumigènes. Ils veulent être considérés comme des acteurs démocratiques à part entière sur la scène footballistique et, comme des syndicalistes, ils n’hésitent pas à se mettre en grève des tribunes.
De manière plus générale, on voit que l’imaginaire du football irrigue peu à peu le mouvement social. Le désormais très répandu slogan « ACAB » [All Cops Are Bastards, ndlr] est issu des tribunes anglaises des années 1980. Durant ce printemps 2018, l’un des mots d’ordre les plus populaires parmi les étudiants en lutte n’était-il pas « Contre toutes les sélections sauf celle de Benzema » ? Le clapping [quand des dizaines de personnes frappent dans leur main au même rythme, ndlr] et les fumigènes, deux attributs de la culture « stade », sont également de plus en plus pratiqués dans les manifestations.
En proposant une vision alternative et politique du football, vous vous positionnez à l’opposé d’une certaine lecture, plutôt élitiste ou condescendante, parfois portée à gauche et chez certains universitaires, comme les théoriciens de l’anti-sport. Pourquoi cette gêne à l’égard de l’objet « football » ?
Dès le début du 20e siècle, le mouvement ouvrier français débat de la place du football dans la société. Certains y voient une école de la compétition, affirmant que le foot efface, derrière le maillot, la division de classe. D’autres, au contraire, émettent la volonté de créer des équipes de foot rouges pour soustraire les ouvriers des clubs d’usine et donc du giron patronal. Pour eux, le foot peut être un espace d’apprentissage de la coopération et de l’entraide mutuelle. Ces réflexions vont donner lieu à un véritable mouvement sportif ouvrier, avec la création notamment de la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT) en 1934 – qui existe toujours – et comptera jusque 100 000 adhérents durant les années 1930.
Toutefois, après-guerre, la gauche française se distance du football. A part quelques exceptions comme Albert Camus, Pier Paolo Pasolini ou Jorge Semprun, peu de figures intellectuelles de gauche revendiquent leur amour du ballon. Avec mai 68 émerge une théorie critique du sport dans les milieux d’extrême-gauche, portée par quelques sociologues freudo-marxistes dont Jean-Marie Brohm. Ceux-ci voient dans le sport, et encore plus dans le foot, une idéologie à la fois capitaliste et fascisante, un mode de gouvernement mais surtout un nouvel opium du peuple.
Le problème avec cette théorie, aussi séduisante soit-elle, c’est qu’elle est incroyablement méprisante envers les amoureux du foot, qu’ils n’estiment être qu’une vulgaire « masse d’aliénés ». Ils oublient aussi qu’en dehors du spectacle marchand, le foot est d’abord une pratique « pauvre », où un simple ballon suffit pour se divertir. La puissance politique du football réside dans le fait que c’est à la fois un langage corporel et une pratique très simple, facilement appropriable par tous et toutes. Cette théorie anti-sport ne fait pas la distinction entre l’idéologie sportive, véhiculée par le pouvoir et ses institutions, et l’éthique populaire du jeu, où le moteur premier est le plaisir et le goût de rivaliser avec l’autre. Or le plaisir est souvent le premier pas vers l’émancipation…
Votre ouvrage permet aussi de remettre en perspective l’évolution de ce sport, notamment le fait que les joueurs professionnels n’ont pas toujours été les rois du marché. Par exemple, en mai 68, il existe un mouvement parmi les footballeurs pour participer à la grève générale et dénoncer les « contrats à vie », considérés alors comme de « l’esclavage moderne »…
Dans les années 1960, un footballeur professionnel est lié par contrat jusqu’à l’âge de 35 ans à son club, autant dire jusqu’à la fin de sa carrière. En 1963, l’illustre Raymond Kopa lance un pavé dans la mare en affirmant qu’avec ce « contrat à vie », les joueurs sont des esclaves et que le footballeur professionnel est « le seul homme à pouvoir être vendu et acheté sans qu’on lui demande son avis ». En parallèle, le journal Le Miroir du Football, plutôt proche de l’extrême gauche, fait depuis 1960 une critique sociale du football. C’est à cette époque qu’on voit l’irruption d’une logique productiviste dans le football français, où le résultat final compte plus que le spectacle et la joie de jouer. Est également dénoncé le népotisme de la FFF où le secrétaire général, Pierre Delaunay, a hérité du poste par son père.
Quand Mai 68 éclate, ces journalistes partagent les aspirations politiques de ce mouvement qui lutte contre toute forme d’autorité et pour plus de démocratie directe. Avec une poignée de joueurs amateurs, ils occupent le siège de la FFF durant cinq jours, hissant même sur sa façade une banderole « Le football aux footballeurs ». Quelques mois plus tard, ils obtiendront en partie gain de cause avec la mise en place d’un contrat à durée librement déterminée pour les joueurs professionnels, ainsi que l’élection du secrétaire général de la Fédération. Depuis, le monde amateur est aussi un peu mieux représenté au sein des instances dirigeantes, même s’il reste de vrais progrès à accomplir au sein de la FFF.
A quel moment s’opère le tournant décisif qui fait du football actuel un étendard du capitalisme mondialisé ?
La retransmission des matchs à la télévision, et donc la naissance des droits TV, à partir des années 1960 puis l’arrêt Bosman en 1995, qui permet la création d’un marché international du footballeur, sont des moment-clés du foot-business. Il s’agit plus d’une continuité logique de l’histoire que d’un tournant décisif : capitalisme industriel et football ont toujours été intimement liés, tout simplement car ils sont nés en même temps.
En Grande-Bretagne et dans l’ouest de la France, on pratique depuis le Moyen-Âge des jeux populaires de ballon où se confrontent les villages. Ce football sauvage, qu’on appelait la « soule », a été accaparé, domestiqué et codifié par l’aristocratie britannique pour en faire un sport moderne et standardisé en 1863. Il est alors appréhendé comme une arme pédagogique pour inculquer à la jeunesse bourgeoise les valeurs nécessaires à la révolution industrielle et à l’entreprise coloniale : l’esprit d’initiative, la division du travail, l’obéissance au chef, le virilisme, la combativité, l’exploit individuel. Rapidement, le football sera diffusé dans les usines par le patronat qui voit dans ce sport un moyen de contrôler ses travailleurs pendant leur temps libre, d’éviter qu’ils se pervertissent au pub ou, pire encore, qu’ils se syndicalisent.
Dès les années 1880, on assiste à un phénomène totalement contradictoire qui est à la source même de tous les paradoxes du football actuel : d’une part, les capitaines d’industries créent les premiers grands clubs de foot, les financent et mettent en place les premières compétitions à des fins purement lucratives. D’autre part, le football devient un des terreaux de la culture ouvrière : assister au match chaque week-end, supporter le club de son quartier ou de son usine renforce chez les travailleurs le sentiment de fierté et d’appartenance à une même communauté ouvrière. Ce sentiment nourrit la conscience de classe et sera le catalyseur de nombreuses luttes sociales.
Comment doit-on interpréter l’attribution record des droits TV du championnat de France de Ligue 1, pour plus d’un milliard d’euros, au groupe espagnol Mediapro ? N’assiste-t-on pas là à une sorte de bulle financière ?
Cette attribution démontre une fois de plus comment le football se transforme en simple produit financier, en investissement lucratif qui permet de conquérir de nouveaux marchés, notamment la Chine pour laquelle on commence à adapter les horaires de matchs, au grand dam des supporters. Les droits TV, ainsi que l’inflation des transferts et des salaires de footballeurs, font qu’effectivement, depuis cinq ans, une multitude de journalistes sportifs et d’économistes prédisent l’explosion de cette bulle spéculative.
Nous sommes exactement dans le même contexte qu’avant la crise financière de 2008. Tout le monde sait que le marché est complètement irrationnel et économiquement hors-sol mais chacun spécule au maximum en attendant l’effondrement. En début d’année, la vente des premiers lots pour les droits de retransmission 2019-2022 de la Premier League anglaise, véritable locomotive du foot-business mondial, ont été pour la première fois à la baisse, ce qui est un très mauvais signe avant-coureur.
Le clivage entre un football de droite et un football de gauche existe-t-il ?
Je dirais plutôt que les stratégies de jeu peuvent avoir une dimension politique. Au début du football, les aristocrates jouaient de façon rude et individualiste : passer le ballon à un coéquipier était un aveu de faiblesse. Quand les ouvriers se sont mis à pratiquer le foot, ils ont développé un jeu de passes, qu’ils voyaient comme un acte altruiste au service du collectif. Leur système de jeu, qu’on appellera par la suite le passing game, incarnait sur la pelouse l’esprit de solidarité et d’entraide qui régnait au sein des usines et des communautés ouvrières.
Cette stratégie, basée sur la passe courte, la construction collective et le jeu offensif, connaît son âge d’or dans les années 1950 notamment via l’équipe nationale hongroise – on parlait même à l’époque de « football socialiste ». Une philosophie de jeu que l’on retrouve aujourd’hui au sein du FC Barcelone, depuis le passage de Pep Guardiola, ou chez des entraîneurs comme Maurizio Sarri au Napoli et Thomas Tuchel, qui, paradoxe suprême, vient d’être embauché au PSG.
En opposition, un jeu beaucoup plus terne et défensif est apparu à partir des années 1960 avec la montée en puissance des exigences de rentabilité financière chez les investisseurs. Le résultat doit primer sur la beauté du jeu, et toute notion de prise de risque sur le terrain est évacuée. L’objectif est de sécuriser la victoire. En France, l’idéologue de cette rigidité a été Georges Boulogne, un homme fasciné par la discipline militaire et inspiré par les travaux d’Alexis Carrel, un biologiste célèbre pour ses thèses eugénistes…
Au-delà du jeu, certains gestes peuvent également avoir une portée politique. Au Brésil, quand les Noirs découvrent le foot dans les années 1920, la société brésilienne est encore extrêmement raciste. Durant les matchs, il n’est pas rare de voir les footballeurs blancs harasser rudement les joueurs noirs devant un public – et un arbitre – complètement indifférent. C’est ainsi que naît le dribble, que les Noirs vont pratiquer pour esquiver les agressions physiques des joueurs blancs. Le dribble, qui est aujourd’hui une pratique essentielle dans le football brésilien, met ainsi en scène la condition même du colonisé : pour exister sur le terrain comme dans la société, il doit se soustraire à la violence du colon.
Dans cette même logique contestatrice, que peut-on attendre de la coupe du monde en Russie ? Faut-il la boycotter ?
Les logiques marchandes et les enjeux financiers sont tels qu’on va davantage assister à un show digne d’un parc d’attraction qu’à une compétition sportive. Certes, dans l’absolu, le boycott massif aurait été la meilleure réponse aux dérives de la FIFA et à l’autoritarisme du régime de Poutine… On peut espérer quelques brèches dans ce spectacle si policé. Début juin, le match amical Israël – Argentine a été annulé. Ce match, qui devait se dérouler à Haïfa, a finalement été déplacé à Jérusalem, dans le prolongement de l’inauguration de l’ambassade américaine… et de la mort d’une soixantaine de Palestiniens tués par l’armée israélienne lors de manifestations. Selon certains observateurs, cette annulation pourrait être l’amorce d’un vaste mouvement de boycott, à l’image de celui opéré contre le régime de l’apartheid en Afrique du Sud dans les années 1970.
Cette coupe du monde en Russie voit aussi l’arrivée officielle de l’arbitrage vidéo en compétition internationale. Qu’en pensez-vous ?
L’arbitrage vidéo vient briser la dimension dramaturgique et l’incertitude propres au football. C’est un outil numérique qui signe la fin de l’imprévu et de l’erreur, de l’humain en somme. Une compétition dans un stade est un spectacle où joueurs, arbitres, staff des clubs et supporters partagent un même moment durant 90 minutes. Avec l’arbitrage vidéo, on assiste en somme à une intrusion supplémentaire des interfaces technologiques dans nos rapports sociaux, à l’instar de l’omniprésence des nouvelles technologies dans notre vie quotidienne.
Place au jeu, désormais : votre pronostic ? Qui ferait un beau vainqueur pour cette nouvelle édition ?
Malgré leur inconstance, les Bleus ont leurs chances au vu de la qualité des joueurs. Mais au foot, onze footballeurs de talent ne suffisent pas pour gagner ! Il y a un esprit d’équipe à cultiver pour l’emporter sur le terrain. Sans vouloir rejouer l’illusion « Black-Blanc-Beur » de 1998, je trouve qu’une victoire de la France, dont nombre de joueurs sont issus de l’immigration et des quartiers populaires, serait un joli pied-de-nez aux actuels délires identitaires et anti-migrants… C’est symbolique, certes, et ce serait bien vite récupéré par le pouvoir en place, mais ce serait tout de même une parenthèse salutaire au sein de ce climat délétère.
Recueillis par Barnabé Binctin
En photo : Sócrates et d’autres joueurs du SC Corinthians de São Paulo (Brésil) /DR
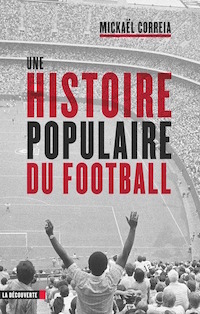
- Une histoire populaire du football, Ed. La Découverte, 416 p, 21 €.








