Chaque année, 2000 mineurs passent par la case prison. Ce chiffre demeure - pour l’instant - stable. En mai 2009, 743 jeunes de moins de 18 ans étaient incarcérés. Les trois quarts sont enfermés dans les quartiers pour mineurs des maisons d’arrêt, les autres découvrent les nouveaux établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM), créés en 2002 par la Loi d’orientation et de programmation pour la Justice (loi Perben). Sept EPM ont été construits [1] et peuvent accueillir 60 jeunes chacun. Si, malgré le discours sécuritaire ambiant, on ne constate pas d’inflation du nombre de mineurs incarcérés, « les historiens de la justice relèvent que l’on n’a jamais construit des prisons qui sont restées vides », prévient la journaliste Nathalie Dollé, auteur du livre « Faut-il emprisonner les mineurs ? ». Quel bilan peut-on dresser de cette politique d’incarcération menée depuis presque une décennie alors que discours politiques et spectacles médiatiques pointent de plus en plus les « jeunes » comme un danger potentiel pour la société ?
« Dans les quartiers pour mineurs, les jeunes deviennent fous »
Quelles sont les conditions d’incarcération des enfants ayant commis un délit ? « Les quartiers pour mineurs, c’est l’horreur. Ce sont des lieux de privation de droits. Les mineurs sont censés aller six heures par semaine à l’école, mais cela ne se fait jamais. Ils passent seulement quatre heures par jour hors de leur cellule, ils deviennent fous », décrit Nathalie Dollé. Mineurs, prévenus et condamnés sont mélangés. « Les groupes se reforment. Tout ce que l’on reproche à la prison comme école du crime s’applique aux quartiers pour mineurs ». Les conditions d’incarcération ne sont pas meilleures en EPM. Malgré l’encadrement important, les tentatives de suicides se multiplient. « Dans les quartiers pour mineurs, les espaces sociaux permettent aux petites bandes de se recomposer et font baisser la pression. C’est un mode de socialisation. Dans les EPM, tout est minuté. Il n’y a jamais de temps pour se poser », critique Nathalie Dollé. Michel Foucault ne disait-il pas que la vraie tyrannie, c’est le minutage ? « De ce point de vue, les EPM sont un pur enfer. Alors que ces gamins ont déjà du mal avec les contraintes. »
Les jeunes incarcérés restent en moyenne 2,5 mois dans les EPM. Certains sont même de passage pour une semaine. Difficile dans ces conditions de mener une action éducative pertinente. L’incarcération « est une rupture supplémentaire, renforce les risques de passages à l’acte violent tournés contre les autres ou contre eux-mêmes », déplore le Syndicat national des personnels de l’éducation surveillée - Protection judiciaire de la jeunesse (SNPES-PJJ) [2]. « Le souci du soin et de l’éducation pour prévenir les mises en danger des détenus, est contradictoire de fait, avec la logique punitive du système carcéral. » L’ancienne ministre de la Justice Rachida Dati déclarait que les EPM avaient pour but « de faire tourner la détention autour de la salle de classe ». Le personnel de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) affirme au contraire que l’objectif de ces établissements « est bien d’augmenter l’incarcération » : « Invoquer la salle de classe est une façon de minimiser le poids des murs, du système disciplinaire, de l’isolement et le but punitif de la prison. »
« Personne ne veut bosser dans les EPM »
Peut-on mettre en œuvre des mesures éducatives dans un cadre répressif ? « On a mis d’énormes moyens dans les murs et pour le personnel, comme les médecins. Mais on n’a pas suffisamment réfléchi à la question : comment inventer un espace commun ? Symboliquement on ne peut pas mélanger un espace d’éducation et un espace de répression. Les éducateurs tutoient les gamins, les surveillants non. Les gamins arrivent à jouer les uns contre les autres », détaille Nathalie Dollé.
Et surtout, le personnel fait défaut. Dans les EPM, l’encadrement pour un jeune est normalement de quatre adultes, surveillants et éducateurs. Or ce sont rarement des éducateurs de la Protection judiciaire de la jeunesse qui sont recrutés, car ceux-ci ne veulent pas y aller. On y retrouve un personnel sans formation ni expérience. « Ce sont des personnes qui viennent avec plein de bonne volonté, qui veulent s’occuper des gamins à problème. Du coup, dans une même équipe, on peut retrouver des gens qui viennent la PJJ, dépositaire d’une culture et d’une histoire, et des gens pas du tout formés. Bilan ? Le taux de rotation est très élevé. »
Une société qui a peur ?
Troisième lieu « d’enfermement » : les Centres éducatifs fermés (CEF). 1845 enfant y ont été placés depuis mai 2003. Ces centres ne sont pas considérés comme une prison. On n’y est donc pas officiellement incarcéré. Créés en 2003, les CEF s’adressent aux mineurs multirécidivistes faisant l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire ou de sursis avec mise à l’épreuve. Il sont prévus pour huit à dix mineurs. La durée du séjour est de six mois maximum, renouvelable une fois. Pourtant, si le jeune fugue du CEF – ce qui est fréquent et prévisible du point de vue judiciaire - il se retrouve automatiquement en prison. Pas sûr que les adolescents trouvent du sens à tout cela. Alors que l’objectif est une future réinsertion sociale, on choisit de les mettre à l’écart. « Pour apprendre à nager, on va à la piscine. Pour leur apprendre à vivre en société, on isole ces gamins. On veut les aider à se réinsérer, alors qu’avant ils ne l’étaient pas forcément. L’idée ici, c’est plutôt de les exclure, pour "protéger" la société. » Selon les chiffres du SNPES-PJJ, un seul EPM de 60 places équivaut à six foyers éducatifs de dix places, huit services d’insertion professionnels pour 250 mineurs ainsi que 10 services de milieu ouvert soit 1500 jeunes suivis. Le choix politique est clair.
« Dans une société économiquement rétractée, les déviants ne sont pas une priorité. En plus ils deviennent les boucs émissaires. Observer la façon dont on traite les enfants déviants donne une bonne vision de l’état d’esprit de la société et des adultes », analyse Nathalie Dollé. Le basculement de notre société dans l’ultralibéralisme va de pair avec la mise en avant de la responsabilité individuelle : chacun, qu’il soit chômeur, pauvre ou désoeuvré, est jugé intégralement responsable de son sort. Mais les mineurs ne sont pas, par définition, responsables. « Aujourd’hui, les mineurs sont proportionnellement plus sanctionnés que les majeurs. C’est typique d’une société affaiblie : les plus faibles s’en prennent plein la gueule. Il y a toujours eu ce petit jeu-là, cette peur de la jeunesse, dans toutes les sociétés. Sauf qu’avoir autant de dispositifs de coercition, c’est symptomatique. »
« Faire cesser cette spirale de la délinquance »
Cette peur correspond-elle à une réalité ? A l’heure où les faits divers scabreux impliquant des mineurs – des agressions dans les établissements scolaires à des cas de persécutions – sont de plus en plus mis en exergue, le miroir médiatique de la société pourrait le laisser croire. Ceux qui souhaitent transformer les jeunes en boucs émissaires et en machine à faire peur également. En octobre 2008, la ministre de la Justice de l’époque, Rachida Dati, déclare sur France 2 [3] : « Il y a environ 4 millions de mineurs entre 13 et 18 ans (...). Il y a 204 000 mineurs qui sont mis en cause pour des actes graves. Des mineurs délinquants (...), c’est des violeurs, des gens qui commettent des enlèvements, des trafics de produits stupéfiants, qui brûlent des bus dans lesquels il y a des personnes. Les mineurs délinquants qui sont incarcérés ou placés en CEF y sont majoritairement pour des actes de nature criminelle. Il est important de faire cesser cette spirale de la délinquance. » Le dossier de presse distribué lors du lancement de la commission Varinard sur l’enfance délinquante [4] cite des chiffres effrayants, à l’appui de cette analyse stigmatisant cette jeunesse « dangereuse ».
La ministre oublie qu’on ne calcule jamais une population mais le nombre de jugements rendus. « Les récidivistes ne sont donc jamais pris en compte, chaque mineur jugé devenant un nouveau délinquant, même s’il est un habitué des tribunaux. Les quelques études menées sur des échantillons localement exhaustifs démontrent qu’un jeune peut comparaître jusqu’à 15 fois devant un juge pour des affaires différentes avant sa majorité. Comme, en moyenne, le volume des jugements rendus avant 18 ans semble deux fois plus important que celui des mineurs jugés, on en arriverait ainsi à l’équation qu’un jeune délinquant comptabilisé en vaut deux et que donc le chiffre global des mineurs délinquants devrait être divisé de moitié », lit-on sur le portail « Enfants en justice », mis en place par le ministère de la Justice.
Le mineur, ennemi public n°1
En décembre 2008, Rachida Dati récidive et annonce une explosion des condamnations criminelles des mineurs de 13 ans. Celles-ci auraient augmenté de 763 % en 10 ans. Pourtant une note de la chancellerie fait état de 27 condamnations pour crime de mineurs de 13 ans, en 1997, contre 32 en 2007 [5], soit une augmentation de… 20%. D’où sort le chiffre de la ministre ? « La délinquance juvénile reste une des questions sociales les plus manipulées, dans tous les sens », rappelle Nathalie Dollé. Pour Laurent Mucchielli, directeur de recherches au CNRS, le diagnostic de la ministre « n’est ni neutre, ni objectif, ni fondé. Il apparaît au contraire totalement orienté, ne rend absolument pas compte de la totalité des éléments de connaissance statistique disponibles, dissimule tout ce qui ne « colle » pas avec la démonstration souhaitée, et conduit au final à énoncer de telles déformations de la réalité que l’on peut parler de véritables contre-vérités induisant les citoyens en erreur. »
Mais le tour est joué. « Au prétexte d’un « changement de nature » de la délinquance des mineurs, on fait basculer depuis quelques années des enfants vers l’âge adulte pour pouvoir les punir comme des majeurs… », regrette Nathalie Dollé. En 2002, la loi autorise le placement des mineurs en détention provisoire, à partir de 13 ans. En 2004, on prolonge la durée légale de garde à vue à 96 heures pour les plus de 16 ans. En 2007, c’est l’apparition des peines planchers, pour les récidivistes, à partir de 13 ans. En février 2010, l’Assemblée nationale adopte un texte mettant fin au huis clos systématique dans les procès de mineurs, ce qui permettait de les préserver.
La fin d’une époque où l’enfant était protégé
Après la seconde guerre mondiale, l’ordonnance de 1945 relative à la justice pour mineurs pose le principe du caractère exceptionnel de l’incarcération. Après les camps, l’emprisonnement n’est plus vu de la même manière… Pourtant, après la guerre, le taux de délinquance est des plus élevés. Mais la reconstruction ne se fera pas sans la jeunesse. Cette orientation est fortement remise en cause depuis quelques années. « Trahissant l’esprit de l’ordonnance de 1945, le gouvernement fait le choix de répondre aux actes délictueux par la seule logique de l’enfermement, écartant la nécessaire recherche des causes de ces passages à l’acte qui seule pourrait en éviter la réitération », dénonce le SNPES-PJJ.
Le syndicat condamne également « une politique qui réduit les jeunes délinquants à leurs seuls passages à l’acte, les enfermant ainsi dans une identité de délinquant ». Car l’évolution récente marque une autre rupture. « Depuis 1945, on privilégie l’histoire de la personne, et on considère l’acte comme un symptôme. On s’intéressait donc à la personnalité du gamin, pas seulement à son acte, pour agir sur les causes et pas sur le symptôme. C’est la vision d’une société qui a confiance en elle, qui estime qu’il s’agit d’une responsabilité collective », considère Nathalie Dollé.
Le basculement est désormais net. D’une responsabilité collective, nous sommes passés à une société où chacun doit « se prendre en main », y compris les mineurs, quels que soient leur environnement social, familial, les discriminations dont ils font l’objet, les blocages de la société. Paradoxe : « En parallèle, on revient à une idée du 19e siècle, insistant sur le déterminisme : il y aurait des groupes à risques. Il faut une surveillance, des fichiers. On ne peut pas « soigner » mais il faut contenir le danger pour la société », ajoute Nathalie Dollé. La méfiance généralisée par rapport à la jeunesse est entretenue - voire créée - par des discours sécuritaires. « Aujourd’hui on fait venir des flics dans les cours d’école. Cela montre la faillite généralisée des adultes et une peur sociale démesurée. Des gamins de 10 ans se rendent compte qu’ils peuvent faire peur, ils ne vont pas se gêner... ». En réponse à cela, on a fait disparaître le mot « enfant » des textes juridiques.
Agnès Rousseaux
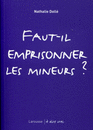
Nathalie Dollé, Faut-il emprisonner les mineurs ?, Larousse, Collection à dire vrai, 2010, 9,90 euros.








