Basta! : Vous développez dans votre livre la notion de « colonialisme chimique », qu’est-ce que cela signifie précisément ?

Larissa Mies Bombardi : Je cite longuement Marx dans mon livre, car il montre bien comme le pillage de l’Amérique du Sud a été primordial dans les débuts du capitalisme. Le colonialisme chimique répète le colonialisme classique avec l’apparence de la démocratie, avec l’aide de conventions mondiales [trois conventions mondiales existent au sujet des substances toxiques : celles de Stockholm, de Rotterdam et de Bâle, ndlr] qui dissimulent les inégalités entre les pays et les blocs.
Cette structure réglementaire légalise les inégalités et je compare souvent la situation actuelle avec l’exemple de l’esclavage : réduire des humains en esclavage semblait intolérable pour une grande partie des sociétés européennes du 18e siècle, mais néanmoins, des entreprises de ce même continent étaient impliquées dans la traite esclavagiste.
Aujourd’hui, en Europe, certains pesticides sont interdits, mais exportés en même temps à l’étranger. Il en va de même pour les limites maximales de résidus de pesticides, qui sont beaucoup plus faibles en Europe qu’ailleurs. Le colonialisme se retrouve aussi sous d’autres aspects. Des populations autochtones sont toujours massacrées, par exemple au Brésil, et leurs terres dévastées. Les pesticides sont ici parfois utilisés comme des armes chimiques, mais aussi pour intimider ou expulser des paysans autochtones de leurs terres.
L’adage veut que « le Brésil nourrisse le monde », mais sous la présidence de Bolsonaro, la faim a refait son apparition dans le pays. Comment s’explique ce paradoxe ?
Aujourd’hui, dans le capitalisme mondial, la production agricole n’est plus synonyme d’aliments. Le Brésil est devenu une espèce de machine à produire des marchandises et de l’agroénergie [le premier importateur de produits agricoles brésiliens est la Chine, ndlr]. Des tradings, des sociétés de négoce, commercialisent ces marchandises sur les bourses internationales de valeur et pour elles, peu importe qu’elles échangent du minerai, du pétrole ou des céréales. Seul le profit compte, il faut boursicoter et jongler avec les valeurs.
Sans action de l’État, on se retrouve dans la situation actuelle : le Brésil est un grand producteur de céréales (à des niveaux records), mais la faim est revenue. Elle est même davantage présente en zone rurale qu’en zone urbaine. Le pays ne cherche donc plus à nourrir sa population.
La course effrénée au productivisme agricole menace l’approvisionnement en aliments de base pour la population brésilienne. Comment en est-on arrivé là ?
Les piliers de l’alimentation du Brésil que sont le riz, le haricot noir (fejão) et le manioc ont vu leurs zones de cultures diminuer au profit des produits d’exportation comme le soja. À tel point que le Brésil doit importer du fejão ! De plus, ces aliments fluctuent sur les cours du marché en fonction de l’offre et de la demande, avec parfois des hausses très fortes, ce qui impacte directement la souveraineté alimentaire du Brésil.
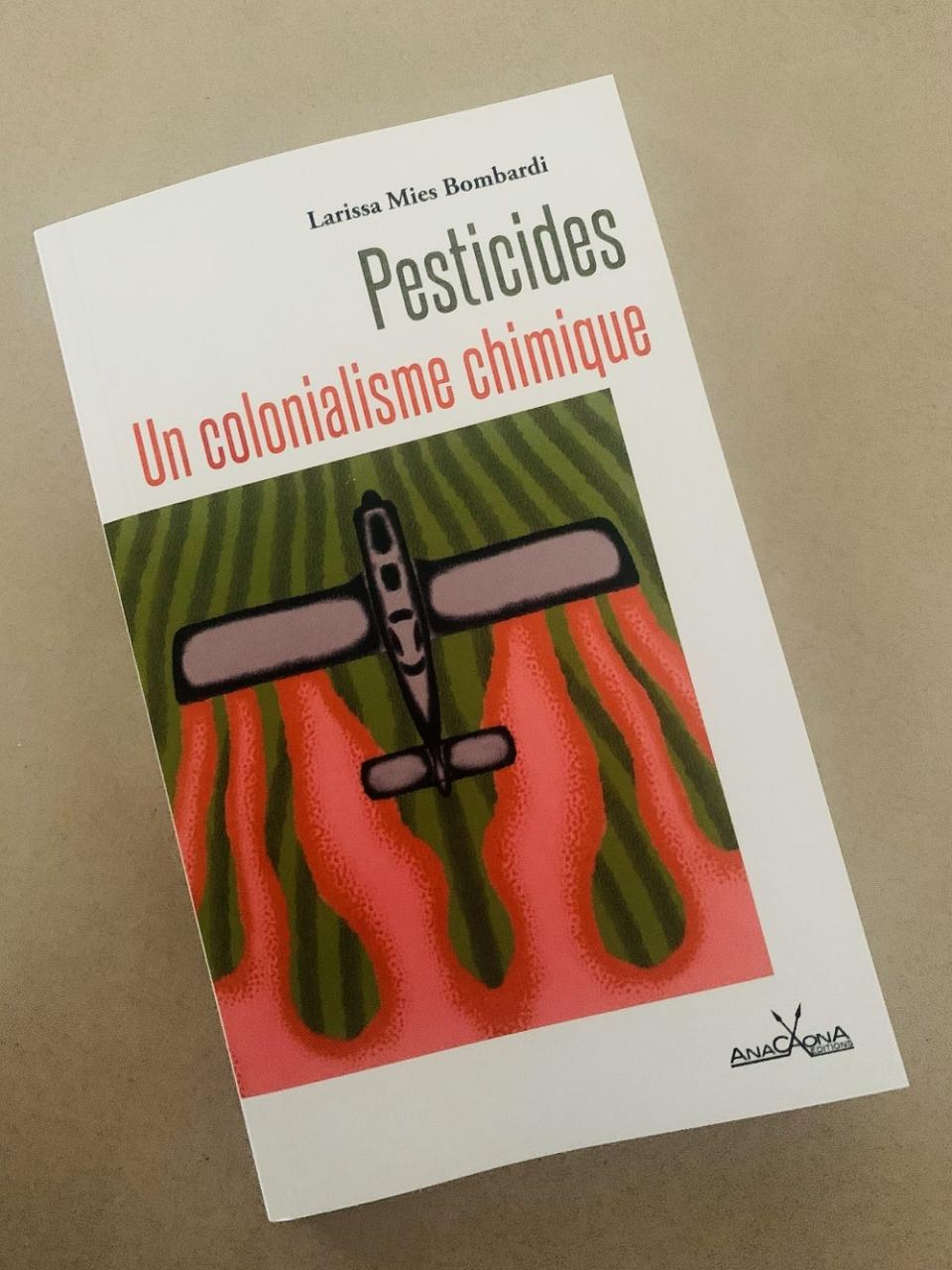
Depuis son retour au pouvoir en 2023, Lula et son gouvernement ont-ils réellement changé leur fusil d’épaule en matière de politique agricole et environnementale ?
Pour l’instant, nous n’avons pas de données concernant une éventuelle décroissance de l’usage des pesticides sous Lula. Il n’a pas freiné pleinement l’approbation des nouveaux pesticides et beaucoup ont été validés récemment par les autorités sanitaires du pays. En termes de volumes, les données ne sont pas encore disponibles.
Toutefois, le ministère du Développement, le ministère de la Santé et le ministère du Développement agraire sont aujourd’hui engagés sur la voie de la réduction des pesticides. Lula a par exemple remis sur la table le programme national d’alimentation bio, afin que les écoles s’approvisionnent via des petites exploitations agricoles, et d’autres programmes ainsi orientés sur le bio ou l’agroécologie. Ce sont des initiatives importantes, il faut le reconnaître.
Quel regard portez-vous sur la France et la Belgique, où vous vivez, et leurs politiques agricoles face aux pesticides ?
J’observe avec beaucoup de préoccupations ce qui se passe dans les deux pays, comme le renouvellement récent de l’autorisation en France du glyphosate, mais aussi en Europe, notamment le pas en arrière de l’Union européenne sur le Green Deal. Évidemment, le lobbyisme, présent au Brésil, existe ici aussi et je suis également très inquiète de voir l’agrobusiness européen travailler main dans la main avec les grandes multinationales chimiques pour faire pression afin d’affaiblir les législations environnementales. C’est très mauvais pour le continent européen mais aussi pour le reste du monde.
Dans votre livre, vous défendez qu’il ne peut y avoir d’agroécologie sans féminisme. C’est-à-dire ?
Déjà, les femmes sont affectées différemment par les pesticides. Physiquement dans un premier temps, car elles ont plus de graisse dans le corps et que justement certains pesticides se fixent sur les graisses et provoquent par exemple des fausses couches, entraînent des malformations fœtales. L’autre aspect est émotionnel, car elles doivent gérer cela dans leur propre corps. Aussi, le patriarcat historique implique que ce sont les femmes qui auront la charge de s’occuper du bébé malade, d’elles-mêmes en cas de maladie, ou encore du mari souffrant, des anciens...
C’est toute une charge de la société sur leurs épaules que de s’occuper des autres. Au Brésil, les femmes sont à la tête des mouvements de dénonciation, surtout dans le cadre des mouvements sociaux. Elles ont mesuré l’importance qu’ont leur petit verger ou leur potager dans leur sécurité alimentaire, et pas que dans mon pays, face à cette grande industrie. Au Brésil, elles échangent leurs graines et leurs connaissances dans un réseau qui ne cesse de croître, brandissant ainsi l’étendard qui dit que sans féminisme, il n’y a pas d’agroécologie. L’agroécologie n’est pas qu’une gestion de la terre, mais aussi une volonté de plus d’égalité. C’est la justice inscrite dans la terre.
Voilà trois ans que vous avez quitté le Brésil suite à des menaces de mort venues de l’extrême droite. Mais depuis, le président Lula est revenu au pouvoir. Pourquoi ne pas être rentrée au pays ?
Malgré ce renouveau politique, la violence de l’agrobusiness n’a pas disparu au Brésil. Il faut comprendre que cette violence agraire est structurelle dans mon pays. Toutefois, Lula a créé dans ce sens un ministère qui protège les défenseurs de l’environnement et des mouvements sociaux [le ministère des Droits humains, ndlr].
C’est grâce à cela que je peux retourner au Brésil brièvement, mais toujours sous protection policière. Je n’ai plus jamais été menacée depuis mon arrivée en Belgique. Je pense que le fait d’être venue en Europe et d’avoir tissé un réseau, notamment avec d’autres chercheurs, me protège.
Quelle forme vont prendre votre engagement et vos recherches sur les pesticides dans les prochains mois ?
Depuis deux ans, nous nous réunissons avec des personnes originaires du Brésil et d’Europe pour créer une charte réglementaire des pesticides à l’échelle internationale, sous l’égide des Nations unies. Nous ignorons encore quelle sera la forme de ce texte, s’il sera nouveau ou s’ajoutera aux conventions existantes.
Dans tous les cas, nous voulons un texte solide et l’Onu en est capable, mais il faut qu’au moins un pays membre des Nations unies en soit à l’initiative. Dans notre groupe, nous aimerions que ce soit le Brésil de Lula qui initie cela.
Cette alliance a été lancée en mars 2023 à New York et il y a déjà eu deux réunions avec Marcos A. Orellana, le rapporteur spécial de l’Onu sur les substances toxiques et les droits humains. Il a été très enthousiaste et optimiste au sujet de notre proposition. De plus, nous lançons en mai, à Bâle (Suisse), un livre sur ce thème pendant le forum mondial de l’eau. Puis nous irons en juin au Brésil, et ensuite à Bruxelles en octobre, pour des colloques sur l’importance d’un cadre réglementaire international régissant l’utilisation des pesticides.
Après ces années de travail sur les pesticides dans le pays qui en consomme le plus au monde, parvenez-vous à garder le moral ?
Oui, car il y a des améliorations. Au Brésil, par exemple, la pulvérisation par avion des pesticides a été interdite dans un premier État, le Ceará. Cette interdiction, qui en appelle d’autres, a été possible grâce à la coordination des mouvements sociaux regroupant paysans et paysannes, église progressiste, politiques et universitaires.
On peut aussi parler de la marche des Margaritas, ces femmes qui se réunissent par milliers tous les quatre ans à Brasília autour de l’agriculture. Et également de leur présence grandissante au sein du Mouvement des sans-terre. Au final, ces avancées procurent beaucoup d’espoir.
Recueilli par Guy Pichard








