Le 15 mars 2017, le parlement néo-zélandais a accordé le statut de personne juridique au fleuve Whanganui, qui se trouve sur le territoire d’une communauté maori, désignée comme son représentant légal. Dans la foulée, le 20 mars 2017, la haute cour de l’État himalayen de l’Uttarakhand, en Inde, a décrété que le Gange et la Yamuna, où les hindous pratiquent des ablutions, seraient désormais considérés comme des « entités vivantes ayant le statut de personne morale » et les droits correspondants.
Ces décisions ont montré l’actualité de "Les Arbres doivent-ils pouvoir plaider" [1], cet article d’un professeur de droit de l’Université de Californie du Sud, Christopher Stone, qui, dès 1972, avait proposé de faire de la nature un sujet de droit, en donnant à des entités naturelles – en l’occurrence des arbres – la possibilité de plaider en justice par l’intermédiaire de représentants. L’article, s’il a paru scandaleux à certains, a cependant eu un retentissement durable.
En 1971, l’affaire fondatrice de Walt Disney contre les séquoias
À la fin des années 1960, la société Walt Disney projeta d’installer une station de sports d’hiver dans une vallée de Californie du Sud, nommée Mineral King et célèbre pour ses séquoias. Le Sierra Club, association de protection de la nature fondée à la fin du XIXe siècle par l’écrivain John Muir s’opposa au projet et engagea une action en justice. En septembre 1970, la cour d’appel de Californie rejeta la demande du Sierra Club au motif qu’il n’avait pas d’intérêt à agir : il ne pouvait pas arguer d’un préjudice personnel. L’affaire devait venir en délibéré devant la Cour suprême des États-Unis à la fin 1971.
C’est là qu’intervient l’idée de Stone : sans doute les membres du Sierra Club ne sont-ils pas personnellement atteints par le projet de Walt Disney. Mais les arbres, eux, sont menacés de disparaître. Si leur cause pouvait être personnellement plaidée par un représentant désigné, ils pourraient avoir gain de cause, et le projet serait rejeté. L’article, montrant que cette idée était cohérente et pouvait être mise en oeuvre, fut rapidement écrit et accepté par la Southern California Law Review à temps pour que les juges de la Cour suprême puissent en avoir connaissance avant même sa publication en 1972.
L’appel du Sierra Club fut finalement rejeté (par quatre voix et deux abstentions), mais une minorité de trois juges fut d’avis contraire et, parmi ceux-ci, le juge Douglas, défenseur connu de la protection de la nature, se rallia aux arguments de Stone qu’il cita dans son opinion dissidente. L’affaire, disait-il, au lieu d’être désignée comme Sierra Club v. Morton (Morton était le secrétaire d’État à l’Intérieur de l’époque), devrait être rebaptisée « Mineral King v. Morton », ce qui reviendrait à conférer aux objets environnementaux un droit d’agir en justice pour leur propre compte. Pourquoi, continuait-il, ne pas ouvrir les tribunaux états-uniens aux « rivières, aux lacs, aux estuaires,
aux plages, aux crêtes montagneuses, aux bosquets d’arbres, aux marais et même à l’air » ?
S’ils perdirent cette fois là, ceux qui s’opposaient au projet l’emportèrent finalement : découragée par les retards entraînés par les poursuites judiciaires, la société Walt Disney abandonna son projet et, en 1978, le Congrès intégra la Mineral King Valley dans le Sequoia National Park.
Représenter les entités naturelle au tribunal
Pour répondre à l’objection selon laquelle les objets naturels, comme les arbres, ne peuvent pas plaider parce qu’ils ne peuvent pas parler, il suffit à Stone d’invoquer le précédent humain des « incapables », qui peuvent être dotés d’un tuteur capable de faire valoir leurs droits. Le même argument se trouve, en éthique animale et environnementale, à propos de ce qu’on appelle les « cas marginaux » : si nous reconnaissons une dignité morale à des êtres humains très diminués, pourquoi ne l’accordons-nous pas à des animaux ? Enfin, Stone distingue entre les deux façons de défendre les arbres menacés, soit en représentant directement les arbres, soit en ayant une conception suffisamment souple des intérêts du Sierra Club (prenant en considération les intérêts moraux, pas seulement économiques).
L’éthique environnementale distingue semblablement deux façons d’accorder de la considération morale aux entités naturelles : l’une qui respecte leur valeur intrinsèque (ce qui en fait des fins en soi, pas de simples instruments), l’autre qui a une conception suffisamment large des intérêts humains pour inclure des intérêts pour la nature qui n’en entraînent pas l’instrumentalisation destructive, comme le sont les intérêts esthétique, scientifique, ou religieux.
Christopher Stone, dans son article, souhaite une reconnaissance légale pour les associations de protection de la nature dans les actions en justice contre les dégradations environnementales. Mais il s’agit que les entités naturelles soient représentées au tribunal, en ayant les associations comme représentantes, alors que la loi française admet le droit des associations à faire valoir leurs intérêts propres – ceux d’un collectif d’humains – dans l’affaire. Cela suffit-il pour protéger la nature ?
Pour que l’on puisse dire d’un être qu’il est un sujet de droit, il faut, selon Stone, premièrement, qu’il puisse engager des actions en justice en son nom, deuxièmement, qu’au cours d’un procès, les dommages qu’il a subis ou infligés soient pris en compte indépendamment de toute autre considération, troisièmement, enfin, que, si des réparations ont été obtenues, il en soit lui-même bénéficiaire (que les dommages ou les amendes soient payés sur un fonds spécialement affecté au sujet de droit). C’est autour de ces trois critères que Stone a construit son article. La reconnaissance du préjudice écologique pur, dans la jurisprudence et la législation françaises, n’est-elle pas une façon de satisfaire au deuxième et au troisième critères, sans admettre formellement le premier (qui fait explicitement de l’entité naturelle un sujet de droit) ?
En France, le préjudice écologique reconnu dans l’affaire Erika
Le préjudice écologique pur – c’est-à-dire « l’atteinte à des éléments non appropriés, tels les oiseaux mazoutés, ou à des processus comme le fonctionnement d’un écosystème » – a été consacré dans le cadre de l’affaire Erika (ce navire pétrolier dont le naufrage avait entraîné une catastrophe écologique sans précédent, endommageant des espaces et des êtres non appropriés), à l’occasion d’un jugement de la Cour d’appel. Aux trois chefs de préjudices concernant directement les humains – matériel, économique et moral –, ce jugement en a ajouté un quatrième, le « préjudice écologique pur résultant d’une atteinte aux actifs environnementaux non marchands ».
Marie-Angèle Hermitte qui, en France, a proposé que l’on fasse de la biodiversité un sujet de droit, fait ressortir les « incohérences liées à la volonté de reconnaître le préjudice causé à la nature et à ses composants, sans lui reconnaître la qualité de sujet de droit » : elles tiennent à la confusion possible entre préjudice moral et préjudice écologique pur. C’est la position défendue par Stone : même si les évolutions du droit, liées à une attention croissante aux questions environnementales, intègrent de plus en plus un rapport à l’environnement qui n’est plus considéré comme une simple chose, seule la qualification explicite de la nature comme sujet de droit permettra, en donnant un sens différent aux éléments déjà existants de la législation, d’assurer une protection effective. En cela, la qualification juridique d’entités naturelles n’est pas seulement une procédure technique, elle a aussi une signification symbolique, qui modifierait la lecture des textes et conduirait au changement de mentalité que Stone évoquait devant ses étudiants.
Personnalité juridique des fleuves en Nouvelle-Zélande et en Inde
On n’en est pas encore là. Mais on ne s’en tient plus au seul rejet de principe où la proposition de Stone pouvait être qualifiée de « bouffonnerie juridique » et de « parodie de justice ». En effet, la Bolivie a adopté, en 2010, une « Loi sur les droits de la Terre-Mère » ; en 2008, l’Équateur a fait expressément de la nature un sujet de droit, en inscrivant, dans sa Constitution, là aussi les droits de la Terre Mère : la nature, ou Pacha Mama, où se reproduit et se réalise la vie, a droit au respect absolu de son existence et au maintien et à la régénération de ses cycles vitaux, de ses fonctions et de ses processus évolutifs. Toute personne, communauté, peuple ou nation, pourra exiger de l’autorité publique le respect des droits de la nature (article 72). À cela s’ajoute la consécration de la personnalité juridique des fleuves Whanganui en Nouvelle-Zélande, du Gange et de la Yamuna par un état himalayen du nord de l’Inde.
Si l’attribution de la personnalité juridique n’est qu’un artifice technique, celui-ci est plus facilement accepté là où ne règne pas le dualisme occidental, la séparation tranchée entre l’homme et la nature. Aussi l’attribution d’une personnalité juridique au fleuve Whanganui est-elle indissociable de la reconnaissance de la culture des Maoris, et de la lutte qu’ils ont menée pour sa défense depuis l’arrivée des colons britanniques en Nouvelle- Zélande à la fin du XIXe siècle. C’est bien ce qu’a admis le ministre de la Justice néo-zélandais : Cela marque la fin du plus long litige de l’histoire […] Cette législation est une reconnaissance de la connexion profondément spirituelle entre l’iwi – la tribu – whanganui et son fleuve ancestral. De la même façon, la Constitution équatorienne a pour premier objet de reconnaître les droits des peuples amérindiens.
Peut-on aller plus loin et proposer que soient représentés « des écosystèmes, c’est-à-dire des rapports d’un certain type entre des êtres localisés dans des espaces plus ou moins vastes, des milieux de vie donc » ? Stone, dans son article, prend souvent l’exemple de rivières. Qu’il ait semblé être pris au mot par les Maoris de Nouvelle-Zélande invite à examiner ce que devient sa proposition, une fois transposée au niveau mondial.
Adoptée par les Nations-Unies, en 1982, la Charte mondiale de la nature affirme que « toute forme de vie est unique et mérite d’être respectée quelle que soit son utilité pour l’homme », et proclame « des principes de conservation, au regard desquels tout acte de l’homme affectant la nature, doit être guidé et jugé ». En 1992, Maurice Strong, secrétaire général du Sommet de la Terre à Rio, a présenté un projet de Charte de la Terre, qui a rallié un certain nombre de soutiens, dont celui de Mikhaïl Gorbatchev et de la fondation Green Cross International qu’il présidait. Le texte final a été approuvé lors d’une réunion de la commission de la Charte de la Terre dans les locaux de l’Unesco à Paris, en mars 2000, et officiellement lancé le 29 juin 2000 au cours d’une cérémonie au Palais de la Paix à La Haye.
Cependant, ces textes n’ont pas de valeur contraignante. Ils peuvent tout au plus servir de référence à des textes juridiques – traités, législations diverses. Pour obtenir ces modifications, des individus, des associations se sont mobilisés à travers le monde et regroupés autour de la promotion des droits de la nature. Aux États-Unis, notamment, 150 ordonnances locales ont été rédigées par les défenseurs des droits de la nature, le Community Environmental Legal Defense Fund (CELDF). Grâce à celui-ci, en 2014, un écosystème s’est défendu devant une cour de Pennsylvanie pour dénoncer la violation de ses droits par une industrie extractive. Des actions judiciaires semblables ont été menées au nom d’un bassin versant (celui du Little Mahoning dans le canton de Grant, qui se portait plaignant contre l’utilisation de la technique de fracturation hydraulique par une compagnie de gaz), ou de celle d’une source (Cristal Spring dans le canton de Highland, pour les mêmes raisons). Ce qui paraissait impensable en 1972 est-il devenu réalité ?
Catherine Larrère
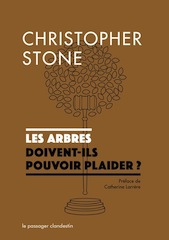
Les Arbres doivent-ils pouvoir plaider, Christopher Stone, préface de Catherine Larrère, Le Passager Clandestin.








