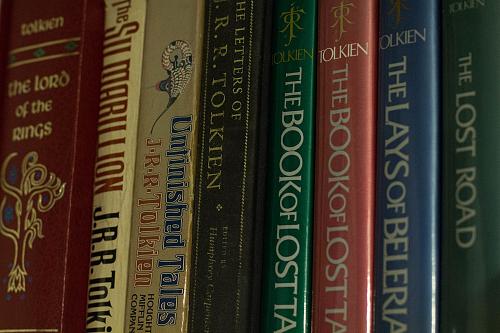10 h 45. Café, thé, brioche aux pépites de chocolat… La table du petit-déjeuner est prête. Kader, 17 ans, est le premier levé. Le nez dans sa tasse, l’adolescent originaire de Côte d’Ivoire reste mutique. Sauf lorsqu’on lui parle de football :« Lionel Messi est mon joueur préféré. » Et qu’en est-il de Mbappé ? « Je ne l’aime pas trop. » Cet après-midi, Kader a rendez-vous au stade pour jouer avec ses camarades. « J’occupe un peu toutes les positions », dit-il d’une voix timide. Tous ne sont pas des mordus de ballon.
Bouquin sous le bras, Abel prévoit de lire une bonne partie de la journée : « Tous les jours, je lis le même livre. Mon conte préféré, c’est celui du Petit Chaperon rouge. » Pour perfectionner son français, le jeune Ivoirien ne quitte pas son manuel de grammaire. Chaque mot inconnu, il le cherche. Abel dit être en train de « vivre son rêve », en allant à l’école en France. Ici, à la Maison de Sevran, la plupart des habitants sont scolarisés. Quand il ne lit pas, Abel pédale. « Le vélo, c’est la seule façon pour moi de me vider la tête. »
Au total, dix enfants exilés dits « mineurs non accompagnés », arrivés en France sans leurs parents, sont accueillis à la Maison de Sevran en raison d’une vulnérabilité médicale. À quelques encablures, une deuxième infrastructure héberge le même nombre d’adolescents. Né entre 2020 et 2021, le projet est cogéré par les associations Utopia 56 et Médecins sans frontières. « On privilégie les jeunes qui vont présenter une grosse fragilité somatique ou psychique », explique Chloé, responsable d’hébergement pour l’Île-de-France. Deux nouveaux jeunes sont attendus dans la journée.
Les mineurs étrangers ont connu des parcours de vie complexes marqués par des situations de ruptures et de violences. « C’est pourquoi, lorsqu’ils arrivent en France, une partie d’entre eux souffrent de troubles psychiques ; pour la plupart, des syndromes psychotraumatiques et des dépressions », indique le rapport « La santé mentale des mineurs non accompagnés – Effets des ruptures de la violence et de l’exclusion » rédigé par Médecins sans frontières et le Comité pour la santé des exilés (publié en novembre 2021).
Un pilulier et des médicaments préparés à l’avance
En France, le processus fixé pour les mineurs non accompagnés est le suivant : tout d’abord, ils et elles doivent se présenter au centre d’évaluation de leur département. Si leur prise en charge est refusée par l’Aide sociale à l’enfance (ASE), ces jeunes ont la possibilité de faire un recours de minorité devant le tribunal pour enfants. Durée estimée : entre 6 et 18 mois. Pendant ce laps de temps, elles et ils n’ont pas de statut, pas de droits, pas d’aides. Que ce soit sur le volet juridique ou médical, l’équipe de la maison de Sevran les accompagne au quotidien.
La liste des rendez-vous de la semaine est inscrite sur un tableau Velleda, posé sur le comptoir de la cuisine. Quand l’infirmière n’est pas là, les mineurs ont accès à un tiroir à leur nom. À l’intérieur, un pilulier et des médicaments préparés à l’avance. De quels maux souffrent-ils ? « Je ne peux pas vous en parler », coupe Chloé. Si les jeunes acceptent de bavarder sur leur quotidien, revenir sur des sujets en lien avec leurs traumatismes est déconseillé.
Au total, 50 % des enfants exilés non accompagnés souffrent de troubles réactionnels à la précarité, selon le rapport cité plus haut. « Même pour ceux qui ont déjà connu la précarité au pays, cela peut être très violent. Lorsqu’ils arrivent en France, ils se retrouvent seuls, c’est une précarité marquée par un isolement très fort », analyse Julie Arçuby, psychologue à la maison de Médecins sans frontières à Marseille.
Cette structure accueille 18 mineurs en recours de minorité, avec deux places d’urgence supplémentaires. Dans le cadre d’une situation médico-administrative compliquée, ce type d’hébergement temporaire leur permet de souffler un peu. Nombreux sont ceux qui se plaignent de troubles du sommeil. « Du jour au lendemain, ils sont coupés des adultes qui avaient la charge de prendre soin de leurs besoins vitaux. Tant qu’ils ne sont pas dans une situation sécurisée, leur tête va continuer à tourner », explique la psychologue.
À la violence qu’ils ont subie dans leur pays d’origine et sur la route migratoire, s’ajoute celle du rejet et la remise en question de leur identité à leur arrivée en France. La plupart alternent entre périodes de répit et de précarité. « Ce système vient répéter des ruptures, liées à la discontinuité des parcours de vie en France, qui met à mal leur capacité à créer des liens stables avec l’environnement dans lesquels ils vivent », ajoute Julie Arçuby. Or, cette discontinuité entame la confiance qu’ils peuvent avoir envers les adultes, créant encore plus de solitude et d’isolement.
Une approche transculturelle
Pour mieux accompagner ces jeunes, Julie Arçuby valorise une approche transculturelle. Sa particularité : prendre en considération la culture des patients. Exemple avec le vaudou, répandu dans des pays d’Afrique de l’Ouest : « Pour certaines personnes, cette pratique a des implications dans la vie réelle. Si les soignants ne connaissent pas ces problèmes, le risque est de rendre un diagnostic erroné. »
L’approche transculturelle est également privilégiée à la Maison de Solenn – la maison des adolescents de l’hôpital Cochin à Paris. « Il s’agit de prendre les éléments du contexte au sérieux. C’est important d’avoir des connaissances sur le pays d’origine des jeunes », décrit Marie-Rose Moro, pédopsychiatre et directrice depuis 2008 de la structure spécialisée qui reçoit 3500 patientes et patients par an. Parmi eux, une petite centaine sont des mineurs non accompagnés pris en charge par l’ASE ou par des associations.
« La prise en charge des mineurs non accompagnés est différente pour plusieurs raisons : ils souffrent de traumatismes multiples et complexes que l’on voit plus rarement chez d’autres adolescents. À cela, s’ajoute la question de la langue et des représentations », précise Marie-Rose Moro.
À la Maison de Solenn, les consultations engagent un psychiatre, un psychologue, un interprète et l’éducateur du mineur. Au-delà de la barrière de la langue, l’absence des parents constitue une difficulté en plus. « On essaie par exemple d’appeler les parents si on a leurs coordonnées, ou de les rechercher. C’est impressionnant l’énergie que les équipes déploient. Il faut imaginer des stratégies multiples », assure la directrice.

Elle se souvient d’un enfant afghan qui avait grandi dans les camps de réfugiés en Iran. Toute la famille avait décidé qu’il devait partir, car c’était un adolescent brillant. « C’est ce qu’on appelle un enfant mandaté », précise Marie-Rose Moro. Il part donc en Allemagne avec son cousin dont il perdra la trace là-bas. « À partir de ce moment-là, il n’ose plus contacter sa mère, de peur d’être considéré comme indigne. » Quand la spécialiste le rencontre, le jeune homme dit avoir envie de se jeter dans la Seine. « Au final, je l’ai aidé à recontacter sa mère, qui lui a confié qu’elle l’aimait. Ça lui a fait beaucoup de bien et il a repris son chemin. »
Quand les patients ont dû mal à se livrer, la Maison de Solenn propose la technique des trois objets. L’adolescent doit apporter un objet qui représente le passé, un autre le présent et le dernier le futur. À partir de là, il faut refaire le récit. Pour les plus jeunes enfants, les jeux sont utilisés comme médium lors des consultations.
« Dans mon travail avec les enfants, je dois ramener du jeu, c’est-à-dire de l’imaginaire face à une réalité qui fait effraction », témoigne Louise Roux, psychologue clinicienne au centre d’accueil, de soins et de soutien du Comité pour la santé des exilés (Comede) Loire. Le dispositif de soins repose ici sur une équipe pluridisciplinaire composée de psychologues, médecins généralistes, psychiatre, accueillante sociale, infirmier et juriste. Le Comede propose un soutien médical, psychologique, social et juridique.
Le jeu face à « une réalité qui fait effraction »
Au centre de soin du Comede de Saint-Étienne, Louise Roux prend en charge des enfants et adolescents en consultation individuelle ou en entretiens familiaux. En parallèle, elle travaille sur le lien parents-bébé. Systématiquement, la psychologue contacte par téléphone un interprète professionnel quand le jeune ou l’enfant rencontré ne parle pas français. Depuis le mois de juin, Louise Roux a vu 58 patients. Guinée, Angola, Albanie, Ukraine… Les enfants sont originaires de différents pays.
À travers des consultations hebdomadaires d’une heure, la psychologue propose un espace où les jeunes patients se « réinventent en tant qu’enfant ». Elle explique que les enfants exilés peuvent développer des troubles lors des étapes de leur développement, tout comme ceux n’ayant pas connu la migration. Néanmoins, compte tenu de l’exil vécu et des facteurs environnementaux, il est important de repérer les éventuels signes d’expression du trauma, afin de proposer un accompagnement adapté.
« Les symptômes peuvent se manifester par une perte de l’envie de jouer, des attitudes d’agrippement, d’évitement phobique ou de comportements régressifs », décrit Louise Roux. Au-delà de six ans, le trauma peut se traduire par une sidération psychique, des comportements agressifs, des cauchemars répétitifs… Une forme d’hypervigilance et d’hypermaturité chez les enfants plus âgés peut être observée, dans un souci constant par rapport à la situation de leur famille.
« Le climat d’insécurité matérielle et psychique dans lequel vivent parfois ces enfants durant des années et le non-respect de leurs droits fondamentaux, droit d’être protégé, soigné, de vivre en famille, peuvent provoquer des effets traumatiques à long terme, insiste Louise Roux. Les effets de ce traumatisme sont très variables d’un enfant à l’autre et dépendent de sa résilience, de la dynamique familiale et de la place qu’il occupe au sein de la famille et dans la société. »
Afin de pouvoir penser un événement traumatique, le temps a son importance. Louise Roux donne l’exemple des enfants ukrainiens qu’elle reçoit. Ils ne parlent pas de la guerre, car celle-ci n’est pas terminée : « Pour les enfants qui ont leur père au front, le traumatisme est en train de se vivre. »
Audrey Parmentier
Photo : © Louis Witter