Le droit du travail est une matière vivante, lieu de tous les antagonismes sociaux et politiques. Accusé par le patronat, ses experts et de nombreux éditorialistes d’entraver les petites entreprises et de ruiner la compétitivité des grandes, il est devenu presque impossible aujourd’hui d’évoquer ses vertus – protéger les salariés, lutter contre la concurrence déloyale. Suranné, trop contraignant, il serait responsable de l’assèchement du marché du travail et sa « réforme », urgente, pourrait seule remédier au chômage et à la crise économique.
Aux sophismes des « réformateurs » répondent des actes. La réalité de l’emploi change, et se dégrade. Depuis le début des années 1990, on assiste à la montée en puissance des contrats précaires (CDD, intérim), qui menace la stabilité des droits et limite la possibilité, pour les jeunes, de s’autonomiser. En 2019, 87 % des embauches se sont faites en CDD et, même si le CDI reste la norme (75 %), on ne peut qu’observer la part grandissante des contrats précaires (12 %). Le micro-entrepreneuriat, lui aussi, progresse à marche forcée. Il a battu des records en 2019, avec une hausse de 25 % des inscriptions. Dernier grand changement : l’essor des plateformes. Souvent filiales de sociétés étrangères, exonérées du paiement de l’impôt grâce à la mansuétude de nos gouvernements, elles organisent un faux travail indépendant. Nonobstant quelques réjouissantes décisions de requalification dans plusieurs pays européens, c’est un désastre pour des milliers de vies humaines, vouées à une activité de tâcheron. Partout, on lève des armées d’esclaves qui besognent nuit et jour avec leurs propres outils, sans assurance sociale digne de ce nom, sans salaire minimum, sans plage de repos, sans représentation collective, bref dans une solitude totale et une précarité insupportable.
Une révolution est en marche : le désarmement des travailleurs
Ceux qui vantent la « liberté » contre les « carcans » du droit n’entendent ni « libérer le travail » ni le « réformer », mais priver de protection des hommes et femmes et les placer dans un état de subordination et de dépendance économique. Ce mouvement de fond, amorcé en Occident avec l’élection de Margaret Thatcher, s’est accéléré, en France, au cours des mandats de Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Comme il n’était pas possible de dégrader un système de droits centenaire en un clin d’œil (le niveau de protection en France était plus élevé que dans d’autres pays européens) et qu’il n’aurait été ni habile ni opportun d’en assumer politiquement la responsabilité, on a procédé par touches successives, parfois invisibles.
C’est seulement lorsqu’on y est personnellement confronté qu’on découvre la gravité des mesures prises, et qu’on mesure l’amputation des droits qu’elles induisent. Il n’est pas question d’évoquer l’intégralité des changements opérés – ici dans une ordonnance, là dans un décret. Mais je voudrais, à partir de mon expérience d’avocate spécialisée en droit du travail, esquisser un aperçu rétrospectif, sur une douzaine d’années seulement, afin de montrer que, à travers la modification apparemment décousue de différents paramètres, une révolution est en marche : le désarmement des travailleurs.
Le Front populaire avait imposé le délégué du personnel, Ambroise Croizat les comités d’entreprises (CE) en 1946, et Jean Auroux les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en 1982. Quatre mois après son élection, le 23 septembre 2017, Emmanuel Macron fusionnait par voie d’ordonnance ces instances représentatives du personnel (IRP) dans le comité social et économique (CSE) qui devenait obligatoire dans toutes les entreprises le 31 décembre 2019. Des impératifs de « simplification » auraient justifié cette fusion. Mais, en pratique, on constate surtout qu’elle a entraîné une diminution considérable du nombre de sièges, un allégement des attributions qu’avaient les délégués du personnel et la destruction des prérogatives des salariés concernant la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail.
Si on examine les différents seuils d’élections du CSE, ce sont 27 à 50 % des sièges qui auraient disparu. Certains syndicats ont dénoncé la perte de 200 000 mandats d’élus sur l’ensemble du territoire. Les nouvelles dispositions prévoient en effet 11 élus au lieu de 16 dans l’ancien dispositif pour les entreprises de 300 à 399 salariés, 14 au lieu de 20 pour les entreprises de plus de 700 salariés, 25 au lieu de 37 au-delà de 3000 personnes. Il est vain d’objecter que la baisse ne touche pas les petites entreprises (11 à 50 salariés) : les syndicats y sont très faibles, les candidats très rares aux élections. Avec un cynisme certain, on a ôté des sièges là où des salariés se présentent, pour en créer là où personne ne candidate ! Quant au nombre d’heures de délégation – c’est-à-dire le temps passé à remplir son mandat, payé comme un travail effectif –, s’il reste globalement stable, il diminue dans les entreprises de 50 à 175 salariés qui, avec celles de moins de 50 travailleurs, représentent l’essentiel du tissu économique du pays. Mal connus, ces chiffres disent pourtant que les contre-pouvoirs sont durablement malmenés, avec un objectif clair : vouer toute opposition à l’échec.
Dans les années 2000, un véritable droit à la santé avait émergé
À cette même fin, on a rogné les attributions des représentants. Si le CSE exerce désormais les fonctions des anciens CHSCT, la commission dite « Santé, sécurité et conditions de travail » (SSCT) n’est maintenue que dans les entreprises de plus 300 salariés – 50 avant la réforme – ou dans les installations nucléaires et entreprises classées « Seveso ». Quand elle continue à exister, cette commission n’a plus ni budget, ni capacité d’initiative – elle pouvait, par exemple, ester en justice – et ne jouera donc qu’un rôle de conseil auprès du CSE. Ces nouvelles instances n’ont, en tout état de cause, plus grand-chose à voir avec les CHSCT, dont les élus avaient acquis autonomie et expertise.
Dans les années 2000, un véritable droit à la santé avait émergé avec la reconnaissance par la Cour de cassation d’une obligation de résultat : les représentants des salariés s’étaient alors emparés de leurs prérogatives pour améliorer leurs conditions de travail face au sacro-saint pouvoir de direction. Et les juges du travail s’étaient également saisis de ce droit à la santé pour rappeler aux entreprises leur responsabilité morale, juridique ou financière et, aussi souvent que possible, les amener à mettre en place une politique de prévention digne de ce nom et seule à même de leur éviter des condamnations.
La réforme des IRP attaque donc le droit des travailleurs à se mêler des questions de santé collective alors même qu’une énième réforme de la médecine du travail pourrait la priver un peu plus de ses moyens d’action. En cours de discussion, la proposition de loi « Renforcer la prévention en santé au travail » prévoit de remplacer parfois les médecins du travail par de simples infirmiers. Elle permettrait à l’employeur de rencontrer le salarié avant le médecin du travail, après une maladie ou un accident du travail, avec un risque de pression et, à terme, une augmentation des licenciements pour inaptitude. Surtout, en créant un « passeport prévention » qui recenserait toutes les formations suivies en santé et sécurité au travail, ce texte tend à transférer au salarié la responsabilité qui incombait hier à l’employeur.
En cas de « plan de sauvegarde de l’emploi » (PSE), par ailleurs, les consultations du CHSCT et du comité d’entreprise – ainsi que les expertises auxquelles ces instances pouvaient recourir – se révélaient complémentaires : au CE revenait d’analyser les motifs du plan et les mesures d’accompagnement des salariés licenciés ; au CHSCT, de veiller aux conditions de travail et de santé de ceux qui conservaient leurs emplois. Depuis la mise en place du CSE, ses élus doivent tout à la fois apprécier les impacts du PSE sur ceux qui restent et les enjeux économiques, financiers ou techniques qui justifieraient ce plan.
Les ordonnances Macron ont ainsi compliqué la tâche des représentants du personnel alors que, dans le même temps, elles simplifient la mise en œuvre des licenciements collectifs : d’une part, le motif économique s’appréciant désormais au niveau national et non plus international, une filiale française a la possibilité de conduire un « plan de sauvegarde de l’emploi » quand bien même son groupe se porterait très bien ; d’autre part, les offres de reclassement peuvent être diffusées sur l’intranet de l’entreprise, il n’est plus obligatoire de les proposer sous forme écrite et individuelle. Des règles « assouplies » après que, de toute façon, on avait atténué la portée de leur contrôle : depuis la loi du 13 juin 2014, les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) homologuent les PSE au plus tard vingt et un jours après la demande patronale ; le juge judiciaire ne peut alors plus s’en mêler.
Les prud’hommes représentent le dernier lieu où justice peut être rendue quand tout a échoué
Pour être efficace, l’entreprise de démolition des droits collectifs nécessite également de tenir à distance des salariés les juridictions du travail – en compliquant l’accès aux prétoires – mais encore de contrôler les décisions rendues en encadrant l’office de juges présentés depuis quelques années comme des fossoyeurs de la libre entreprise. La juridiction prud’homale subit pareille accusation alors que, depuis des décennies, son fonctionnement paritaire garantit des décisions mesurées : en pratique, pour qu’un patron soit condamné, il faut qu’un de ses pairs au moins ait considéré qu’il le méritait !
Connu de tous, le conseil des prud’hommes juge les litiges individuels nés de l’exécution du contrat de travail ou de sa rupture, qu’il s’agisse de la contestation d’un licenciement, d’une discrimination syndicale, raciale ou sexiste, d’un harcèlement ou encore d’un rappel de salaire. Lieu de résolution des conflits individuels – même si la dimension collective n’est pas exclue, au travers d’actions sérielles ou de l’intervention des syndicats dans certains dossiers –, les prud’hommes représentent pour des millions de salariés le dernier lieu où justice peut être rendue quand tout a échoué, où l’humiliation peut être lavée et la dignité retrouvée. Pourtant, depuis 2007, tous les gouvernements ont entendu les affaiblir. D’abord, en réduisant leur nombre. Menée tambour battant, la réforme de la carte judiciaire de Nicolas Sarkozy et de sa ministre Rachida Dati a conduit à supprimer 61 conseils sur 271 (soit plus d’un quart). Une vingtaine d’autres seraient dans le collimateur du ministère de la Justice, ce qui signifierait la disparition du tiers des juridictions depuis 2007. Pour justifier ces fermetures, on évoque souvent la réduction de l’activité.
Mais cette diminution du nombre de recours tient notamment aux dispositions prises pour les contrarier. Jusqu’en 2015, il suffisait de remplir un formulaire, court, simple : le renseigner n’impliquait pas le concours d’un avocat. Les demandes pouvaient être modifiées à tout moment. Le greffe se chargeait d’envoyer les convocations ou de notifier le jugement une fois rendu et, entre les deux, la procédure ne nécessitait pas obligatoirement de conclusions écrites des parties. Sous l’impulsion d’Emmanuel Macron, alors ministre de l’Économie de François Hollande, la loi du 6 août 2015 a modifié cette procédure en imposant au demandeur des démarches aussi inutiles que décourageantes. Long d’une dizaine de pages, le formulaire doit désormais comporter un exposé des motifs de la requête, un bordereau des pièces, la numérotation de celles-ci et l’obligation pour le demandeur de communiquer le tout à l’employeur.
Alors que, dans 93 % des dossiers, le justiciable qui forme le recours a subi un licenciement, on le traite sur le plan procédural comme un propriétaire qui donne congé à son locataire ou un banquier qui poursuit un mauvais payeur plutôt que comme une personne se défendant d’une décision illégitime : il est ainsi sommé de justifier sa démarche en formulant des arguments de fait et de droit, ainsi que de produire les pièces à leur appui, tandis que l’auteur de la décision qui l’a privé d’emploi restera passif durant de longs mois à contempler le chômeur se débattre…
Il y avait certes à redire au fonctionnement de la juridiction prud’homale, notamment au regard des faibles moyens qui lui sont attribués, mais une réforme conçue pour l’améliorer aurait dû considérer que l’employeur est le seul responsable du procès, en sorte que c’est à lui qu’il revient, en bonne logique, d’exposer en premier ses motifs et de communiquer ses preuves. Que cette voie n’ait pas été explorée suffit à démontrer que l’objectif n’était pas l’égalité des chances (c’est le titre de la loi qui modifie la procédure !) mais l’empêchement d’agir. Et les résultats ne se sont pas fait attendre : dans toute la France, les demandes aux prud’hommes reculent nettement, avec une baisse de 50 % en 2017 par rapport à la même période en 2016.
Impunité organisée
Sans changer le fond du droit, il est aussi aisé de limiter le volume d’instances engagées en réduisant la durée du droit d’action, c’est-à-dire le temps pendant lequel il est possible de recourir au juge. En 2017, le législateur l’a porté de trois à six ans pour les délits, et de dix à vingt ans pour les crimes. En droit du travail, c’est l’inverse : entre 2008 et 2017, la période pour contester un licenciement est passé de trente ans à douze mois. En outre, à la différence d’une administration ou d’un organisme social qui notifie une décision faisant grief, l’employeur n’a pas l’obligation de rappeler le délai d’action dans la lettre de licenciement, sauf s’il s’agit d’un licenciement économique (dont on sait qu’ils sont peu contestés). Un traitement de faveur que rien ne justifie.
Le magistère exercé par le juge des prud’hommes a en revanche été fortement encadré par une autre ordonnance, du 22 septembre 2017, relative à « la prévisibilité et la sécurité des relations de travail ». Déplorant des condamnations d’employeurs aussi imprévisibles que lourdes (ce que rien, en fait, n’établissait…), le gouvernement a mis en place un barème : quand la loi prévoyait une indemnisation minimale du salarié sans aucun plafond, le nouveau dispositif interdit aux juges de dépasser certains montants, fixés au regard de la seule ancienneté, sans réelle considération du préjudice subi. Partant, on a substitué à la précarité réelle et objective des travailleurs une précarité supposée, celle du pauvre entrepreneur qui encourrait une faillite du fait de l’irresponsabilité supposée du juge ! Mieux vaut rire d’un instrument qui organise l’impunité d’une des deux parties au détriment de la plus faible.
Le barème a ainsi mécaniquement abouti à décourager les salariés aux revenus modestes et à l’ancienneté réduite, qui représentent pourtant la majorité des travailleurs... Avec une rémunération de l’ordre du salaire médian (1800 euros) et une ancienneté de moins de cinq ans, l’enjeu du procès devient théorique car les montants maximaux prévus ne permettent pas de réparer le préjudice subi (pour un an, deux mois de salaire ; pour deux ans, trois mois et demi ; trois ans, quatre mois ; quatre ans, cinq mois ; cinq ans, six mois). Associé à la complexification de la saisine de la juridiction, l’instauration du barème a donc contribué à faire s’effondrer le nombre de dossiers aux prud’hommes et à ériger le recours à cette juridiction en privilège réservé aux cadres bien payés. Prétendre fonder une réforme sur l’idée de condamnations trop lourdes qui nuiraient à l’emploi est une bouffonnerie qui dissimule bien mal l’objectif réel : désarmer les travailleurs.
Conduite en 2017, toujours au nom de l’efficacité et de la célérité, la réforme de l’appel aura aussi contribué à ce désarmement, en complexifiant les actes à accomplir et en multipliant l’élimination de milliers de dossiers sans décision au fond par l’organisation de chausse-trappes. Entre 2017 et 2018, plus de 27 000 justiciables ont ainsi été privés de leur droit à l’appel, victimes d’un véritable déni de justice. Les voies de recours des parties ont été enserrées dans des délais très courts alors qu’aucun moyen supplémentaire n’était dégagé pour juger les dossiers. Ceux-ci, constitués en moins de six mois pour être considérés recevables, ne peuvent ainsi être audiencés avant deux ans, voire parfois trois. Et, comble de l’indignité, ce délai subi par les parties pourra devenir un motif de péremption. En effet, si aucune convocation n’intervient dans un délai de deux ans après le dernier acte de procédure, le dossier sera déclaré non jugeable au motif que les parties s’en seraient désintéressées trop longtemps. Autrement dit : l’État organise la pénurie de personnel (greffiers et magistrats) et en fait payer le prix au justiciable en l’accusant d’encombrer les armoires tout en se désintéressant de son dossier.
Dématérialiser toujours plus : les gestionnaires en rêvaient, le Covid l’a fait
La crise sanitaire a mis encore un peu plus en évidence le manque de considération du pouvoir pour la justice du travail. Durant le premier confinement, la justice prud’homale a baissé le rideau, comme un commerce non essentiel. Elle n’a repris son activité normale qu’en septembre 2020, et cet arrêt de six mois a achevé d’emboliser les juridictions sociales. À Nanterre, on convoque actuellement les dossiers en 2023, voire en 2024. Rien n’a été prévu ou mis en place pour favoriser la résorption des retards. Réduire encore le nombre de juges en audience, favoriser les dépôts de dossiers sans présence des avocats ni des parties, et dématérialiser toujours plus : les gestionnaires en rêvaient, le Covid l’a fait.
La baisse du nombre de dossiers aux prud’hommes invoquée pour « justifier » le mauvais traitement qui leur est réservé procède enfin de la disparition progressive des licenciements. Les ruptures conventionnelles tendent en effet à s’y substituer. Instaurées en 2008, elles dispensent les employeurs d’énoncer un motif valable de rupture unilatérale et, de ce fait, donnent difficilement lieu à un contentieux, sauf démonstration d’un vice du consentement. Entre 2010 et 2018, le nombre de dossiers traités par les conseils de prud’hommes est passé de 217 791 à 107 980. On peut s’en réjouir comme l’a fait Mme Pénicaud, lorsqu’elle était ministre du Travail, en y voyant le signe d’un recul des conflits. Ou considérer que les droits deviennent formels quand les salariés sont de moins en moins nombreux à s’en emparer pour les faire respecter.
Les réformes successives ne sont pas gravées dans le marbre
Le combat est inégal ; il se joue sur tous les fronts comme en coulisses, et le patronat peut toujours compter sur les think tanks (qu’il finance) et leurs relais médiatiques. On se souvient de David Pujadas faisant claquer sur sa table, au JT de 20 heures, un Code du travail jugé trop épais. Quelques mois avant l’adoption de la loi « travail », Terra Nova coédite (avec Odile Jacob) Réformer le Code du travail : le livre déplore la « prolifération de textes légaux » et soutient un « droit réglementaire ne s’imposant que de façon supplétive ». En mai 2016, l’Institut Montaigne coédite Un autre droit du travail est possible. L’ouvrage dénonce une législation « envahissante [qui] laisse peu de place aux autres acteurs » et entend « faire primer l’accord d’entreprise ». Comme le relèvera Le Monde diplomatique, les grands médias s’empressent alors « de faire connaître ces diverses nuances du même gris. Les auteurs de Terra Nova passent sur France Inter, France Culture, France Info, Arte, La Chaîne info (LCI) et BFM TV, qui invitera également ceux de l’Institut Montaigne. La promotion médiatique du livre de [Montaigne] est également assurée par La Croix, Le Monde, Le Parisien, La Tribune et Les Échos. En comparaison, à la même période, le groupe de recherche pour un autre Code du travail (GR-PACT), initiative d’une vingtaine d’universitaires ayant entrepris de démontrer qu’il serait possible de faire plus court et plus protecteur, bénéficie d’une exposition réduite (L’Humanité, France 24). »
Parmi ceux qui aujourd’hui rappellent que c’est à l’État et au législateur de reprendre la main pour résister aux mirages du tout-contractuel, le juriste Emmanuel Dockès a en effet proposé, avec quelques collègues, un nouveau Code du travail pour promouvoir les droits au sein des entreprises et le travail humain dans le respect et la dignité : le collectif GR-PACT propose notamment de rétablir largement le principe de faveur qui prévoyait, jusqu’à sa remise en cause par la loi « travail », qu’une convention ou un accord ne puisse comporter que des stipulations plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur. Dans cet « autre Code du travail », expliquent ses auteurs, « l’adaptation de la loi par convention collective ne [devrait être] admise qu’à titre exceptionnel, sous conditions de contre-parties claires et prédéfinies par la loi. Une convention d’entreprise ne [pourrait] plus déroger à une convention collective de branche, sauf si celle-ci le prévoit expressément. Et les avantages négociés dans les contrats individuels de travail ne peuvent plus être réduits sans l’accord du salarié, même par convention collective ».
Certes, l’arme du droit ne peut pas tout et n’est rien sans la colère et le combat. Les réformes successives ne sont pas gravées dans le marbre et chaque révolution technologique ou industrielle compte ses morts et ses blessés avant d’admettre que le tribut à payer pour les générations futures est trop lourd et qu’il faut sortir de l’aveuglement. C’est ce qui s’est fait, dans les pires moments de l’Histoire : au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans une Europe dévastée et ruinée, quelques fous ont écrit la Déclaration universelle des droits de l’homme et d’autres se réunissaient à Philadelphie, sous l’égide de l’Organisation internationale du travail, pour rappeler que la justice sociale est un facteur de paix et dire que le travail n’est pas une marchandise.
Rachel Saada, avocate, spécialiste en droit du travail, droit de la sécurité sociale et de la protection sociale.
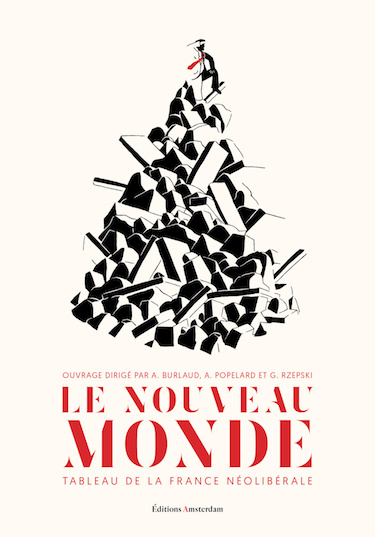
Le Nouveau Monde, Éditions Amsterdam, Septembre 2021.








