« L’urgence vitale face au désastre ranime une impérieuse nécessité : celle de se battre pour d’autres mondes. » C’est ainsi que la quarantaine d’auteurs du livre collectif On ne dissout pas un soulèvement (Seuil, 2023) résume en introduction la démarche des Soulèvements de la Terre. Alors qu’une nouvelle mobilisation se profile ce week-end (17 et 18 juin), dans la vallée de la Maurienne, en opposition au projet ferroviaire du Lyon-Turin, le mouvement reste plus que jamais dans le collimateur de la répression gouvernementale. Sans que cela entame la détermination de la centaine de milliers de soutiens qui ont signé la déclaration commune en réponse à la menace de dissolution brandie par Gérald Darmanin, au printemps. Nous avons voulu discuter de tout cela avec Jérôme Baschet, l’une des voix de ce livre collectif.

basta! : Comment réagissez-vous à la vague d’interpellations qui a frappé plusieurs militants écologistes, le 5 juin, soupçonnés d’avoir participé à une action contre le cimentier Lafarge ? Avons-nous franchi un cap supplémentaire dans la criminalisation des mouvements écologistes ?
Jérôme Baschet : Disons que les faits s’accumulent. La manifestation du 25 mars à Sainte-Soline a fait face à une violence policière extrême : 5000 grenades tirées en deux heures, avec des personnes mutilées et des blessés graves, tout cela pour défendre un simple « trou », où il n’y avait rien qui puisse être dégradé, pas même des bâches en plastique. Ensuite, il y a eu la menace de dissolution des Soulèvements de la Terre, brandie par Gérald Darmanin. On assiste aussi à un usage totalement inapproprié, et irresponsable, du terme d’« écoterrorisme », dont le pouvoir abuse comme d’une étiquette infamante pour tenter de discréditer le mouvement.
Cela relève clairement d’une propension à criminaliser la contestation sociale, comme on le voit aussi avec la vague d’arrestations coordonnées, au niveau national, ce lundi 5 juin, ou encore contre des militants antifascistes italiens venus participer à un hommage à Clément Méric. Donc, oui, l’actuel gouvernement semble prêt à franchir de nouveaux seuils.
Faut-il s’attendre à un durcissement de l’affrontement entre les luttes écologistes et le pouvoir ?
Cela me semble clair, et ce pour une raison simple : les effets du dérèglement climatique sont déjà dramatiques, et nous n’en sommes pourtant qu’au début. En 2040, dans tous les scénarios du Giec, la température globale moyenne aura augmenté de 1,5° ou 1,6° par rapport à l’ère préindustrielle, contre 1,2° de hausse aujourd’hui. Cela signifie plus de 2° d’augmentation dans un pays comme la France, sans parler des +4° à l’horizon 2100 sur lesquels même le gouvernement table désormais. Cela peut paraître abstrait, mais nous connaissons désormais toutes les dimensions éminemment concrètes qu’impliquent de tels chiffres : dans 15 ans, les tempêtes et les inondations, comme les sécheresses et les mégafeux, déjà insupportables, auront été démultipliés par rapport à ce que l’on connaît déjà, avec des conséquences de tous ordres et notamment des conflits de plus en plus virulents sur l’usage de l’eau.
Pour de multiples raisons, les difficultés de l’actuel système économique s’accentueront, de même que les critiques à son encontre et le besoin vital d’un changement profond. Cela ne concerne pas seulement la crise climatique et écologique. Si l’on veut prendre la mesure de l’inquiétude des cercles dirigeants mondiaux, il suffit de lire les nombreux rapports préparés par diverses institutions systémiques, comme « L’âge du désordre » (Deutsche Bank) en septembre 2020 ou le rapport sur les risques globaux de Davos 2023.
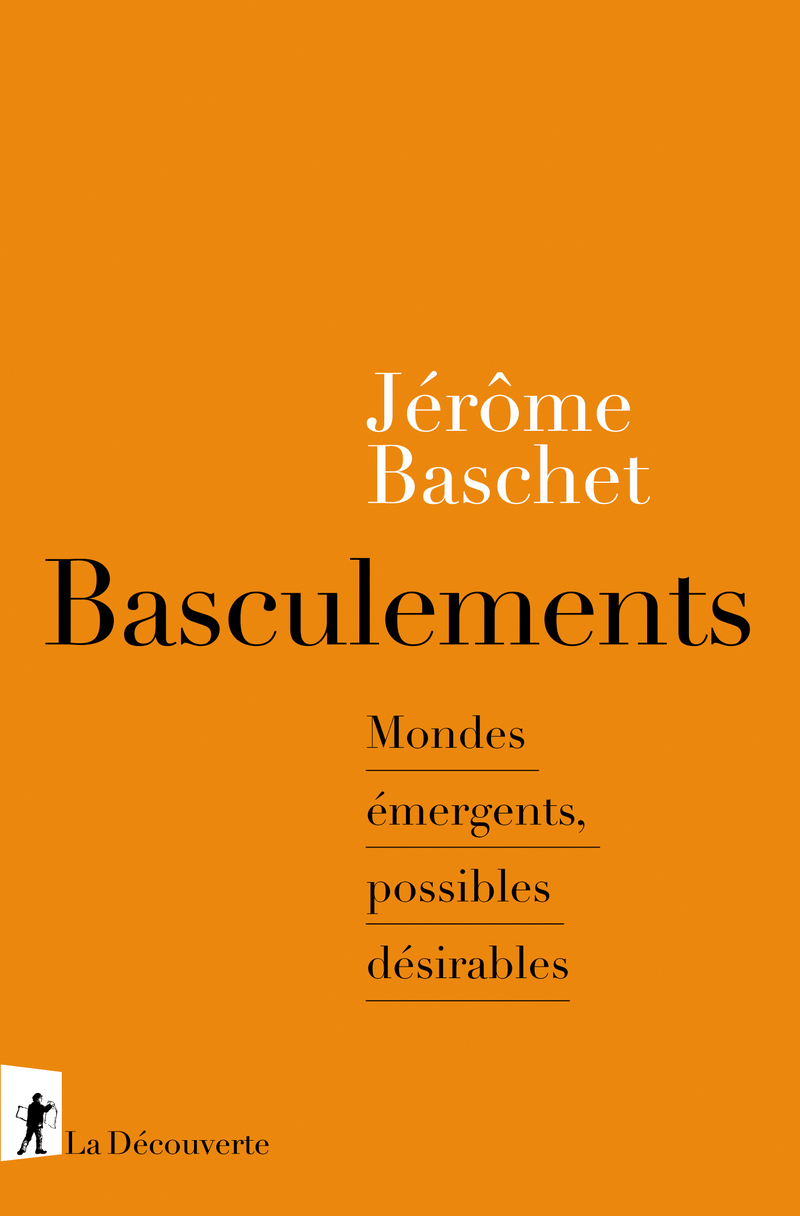
Ils anticipent des difficultés à maintenir la croissance mondiale, à garantir une rentabilité du capital aussi favorable que durant l’âge d’or de la mondialisation néolibérale, à faire face à une perte de légitimité des régimes représentatifs et à contrôler une colère sociale de plus en plus ample et imprévisible. Face à un système dont les facteurs de crise s’accumulent, on peut comprendre que les cercles dirigeants mondiaux misent sur le renforcement massif des techniques de contrôle et se préparent méthodiquement à un recours de plus en plus brutal à la répression pour assurer la défense de leurs intérêts.
Dans le cas des Soulèvements de la Terre, cela ne traduit-il pas également une certaine inquiétude vis-à-vis de la portée du mouvement ? Une note du service central du renseignement territorial le présentait comme « un acteur majeur de la contestation écologique radicale »…
Cette note fait un éloge paradoxal des Soulèvements de la Terre, en lui reconnaissant également une grande « inventivité », un « fort rayonnement » et une remarquable capacité d’organisation. Malgré ce bel effort de lucidité, la vision policière du monde n’en bute pas moins sur d’évidentes limites. Elle projette notamment sur le mouvement une structuration hiérarchique, ne pouvant s’empêcher de fantasmer quelques chefs et une cellule centrale qui embrigaderaient une frange de la jeunesse au service de ses intentions occultes et malveillantes. Selon le rédacteur de la note, les enjeux écologiques ne sauraient être qu’un prétexte à des agissements dont la violence et la destruction seraient la véritable raison d’être. Cela conduit à ne rien comprendre à la logique du mouvement, puisque c’est au contraire de là qu’il faut partir, de cette révolte face à la dévastation du monde.
Ce qui est sûr, c’est qu’en deux ans et demi d’existence, les Soulèvements de la Terre ont réussi à créer une dynamique remarquable, dont la lutte contre les mégabassines a été l’un des principaux points de cristallisation. Je vois au moins trois caractéristiques du mouvement qui peuvent concourir à sa réussite : d’abord, il s’inscrit dans la continuité des luttes territoriales contre les grands projets destructeurs, par exemple avec les mobilisations contre l’autoroute Toulouse-Castres, contre le contournement de Rouen, ou contre la ligne à grande vitesse Lyon-Turin. Mais les Soulèvements de la Terre ajoutent un maillage de toutes ces luttes à l’échelle nationale, ce qui permet d’en renforcer l’écho et d’apporter à chacune un soutien plus large.
Le souci d’un ancrage territorial des luttes est déjà fort de plusieurs décennies d’expérience, mais les Soulèvements témoignent d’une nouvelle étape qui entend surmonter un trop grand morcellement des forces. Le mouvement assume un besoin d’organisation et de coordination à une échelle plus ample, sans rien perdre de la singularité des expériences locales. Il transforme aussi la temporalité de ces luttes, en structurant les actions en saisons successives, annoncées tous les six mois, ce qui permet de contrecarrer les tendances « immédiatistes » de l’époque pour mieux s’inscrire dans la durée, avec des effets cumulatifs remarquables.
Ensuite, les Soulèvements de la Terre déploient un travail de composition permettant de lier des milieux et des formes de lutte différentes, issus par exemple de l’activisme du mouvement climat, des luttes contre les grands projets, du syndicalisme paysan ou encore des courants autonomes. La jonction avec la Confédération paysanne est particulièrement importante, et l’une des forces des Soulèvements de la Terre est de lier les luttes territoriales à la question foncière, avec le souci d’un mouvement concret de reprise des terres pour les arracher aux grandes exploitations agro-industrielles et favoriser au contraire un véritable essor de l’agriculture paysanne.
Enfin, le troisième élément tient au fait d’assumer des modes d’action plus « offensifs ». Après la vague des grandes marches pour le climat, et alors que le recours à des actions purement symboliques montre ses limites aux yeux d’une partie de la jeunesse, les Soulèvements de la Terre offrent une option plus radicale, en proposant d’agir directement pour bloquer autant que possible l’expansion des infrastructures et activités « écocidaires ».
Ce registre plus « offensif » n’est-il pas justement ce qui prête le flanc à la recrudescence de la répression policière ?
Il faut d’abord souligner que les Soulèvements de la Terre déploient des modes d’action multiples, et non un seul. Ils multiplient les actions à la fois déterminées et festives, comme on a pu le voir, par exemple, lors de la manifestation sur le tracé de l’autoroute contestée entre Toulouse et Castres, avec une course parodique de « bolides », tous plus lents les uns que les autres. Ou encore lors de la mobilisation contre le contournement autoroutier de Rouen, dans la forêt de Bord, avec le cloutage des arbres pour en empêcher l’abattage, ainsi qu’avec la création de mares pour que s’y reproduisent des espèces protégées, ce que le philosophe Antoine Chopot a qualifié de « première action naturaliste de masse ».
Il n’en reste pas moins que le recours à des actes plus offensifs est assumé. La notion de « désarmement » a alors été mise au point, pour désigner une action visant à rendre inopérante une « arme de destruction massive » comme le béton, qui contribue pour une large part aux émissions de CO2 et à l’artificialisation des sols. Ce terme, plus que celui de « sabotage », a l’avantage de mettre en avant la justification d’un tel geste, qui n’est pas de détruire, mais d’empêcher une destruction.
Ce faisant, il aide aussi à défaire la catégorie « violence », dont le gouvernement et la plupart des médias contribuent à faire un tout homogène qui permet de fâcheux amalgames. La notion de désarmement permet de signifier que la première violence est celle d’un système productif qui expose des milliards d’êtres vivants à des pollutions mortifères et aux multiples conséquences du chaos climatique.
La pratique du désarmement ne peut être dissociée d’une bataille du sens, qui implique de toujours fonder la légitimité des actions menées et de la faire comprendre. Ces actes de désarmement restent largement proportionnés et sont menés à basse intensité, utilisant des outils simples comme des cutters ou des clés à molette - et non, par exemple, des explosifs qui sont plus directement associés à l’imaginaire du sabotage.
Et puis, la supposée « violence » que le gouvernement tente d’imputer aux Soulèvements de la Terre ne vise jamais les personnes, ce qui n’est pas le cas des « activistes » du complexe agro-industriel qui n’hésitent pas à s’en prendre physiquement aux défenseurs de l’environnement, à menacer tel maire de séquestration ou à déboulonner les roues des voitures des journalistes qui mettent en cause leurs pratiques.
Quel est le véritable enjeu de cette lutte, aujourd’hui ?
Il faut repartir, une fois encore, de l’urgence climatique et écologique. La climatologue Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du Giec – et qui n’est pas réputée pour être une activiste d’ultragauche – soulignait l’extrême gravité de la situation, lors d’une soirée de soutien aux Soulèvements de la Terre, le 12 avril dernier. « Où est le vrai danger ? » demandait-elle : dans une contestation radicale qui dérange, ou bien dans l’inaction climatique – ce qu’elle a nommé « l’inadéquation des réponses institutionnelles et politiques » ?
Il est clair que l’action des États, sans être inexistante, est complètement insuffisante, ne serait-ce que pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris (2015). Dans une telle situation d’urgence vitale, dès lors que les pouvoirs institués sont incapables de se dissocier des intérêts privés à l’origine de la catastrophe, il devient légitime, et même impérieux d’invoquer un état de nécessité supérieure pour agir.
Il y a un devoir d’inacceptation et d’insubordination. Cela suppose d’assumer la perspective d’une confrontation à la fois plus offensive dans ses modes opératoires, et plus générale dans sa nature même. Il va de soi que l’ennemi n’est pas tel ou tel gouvernant ni tel ou tel ultrariche, mais bien plutôt le réseau des quelques centaines d’entreprises transnationales, banques et fonds d’investissement qui dominent l’économie mondiale. Il n’est pas difficile non plus d’identifier dans le productivisme compulsif du système capitaliste, mû par un impératif d’accumulation illimitée et tenu par une obligation de croissance exponentielle, la cause fondamentale de la catastrophe écologique et climatique.
Le propre de la nouvelle période géologique dans laquelle nous avons basculé, qu’on l’appelle « Anthropocène » ou « Capitalocène », c’est la dégradation accélérée de l’habitabilité de la Terre, qui met en péril de nombreuses espèces vivantes, y compris l’espèce humaine. Une nouvelle ligne de front émerge alors : elle oppose, d’un côté, le monde de l’Économie qui, pour se perpétuer, détruit cette habitabilité, et de l’autre, les forces qui luttent pour que la préservation de celle-ci prime sur les impératifs économiques. Cela ne fait pas disparaître les rapports de classe noués à l’intérieur du régime de production, mais cela met en avant un autre antagonisme majeur, touchant au rapport même à la production.
Vous recensez plusieurs territoires en lutte, catégorisés sous la notion d’ « espaces libérés ». La lutte contre les mégabassines en fait-elle partie ?
Ces « espaces libérés » désignent la multitude de lieux collectifs et de territoires où s’expérimentent d’autres formes de vie, qui tentent de s’extraire des logiques marchandes et étatiques. Ils ne prétendent pas en être entièrement libérés ; mais du moins luttent-ils pour s’arracher à leurs contraintes mortifères et pour esquisser dès maintenant d’autres mondes plus joyeux et plus désirables. Il faut les concevoir moins comme des îlots préservés au milieu de la tempête que comme des espaces de combat. Leur échelle peut être modeste, par exemple s’agissant de lieux associatifs pratiquant l’entraide et ébauchant des pratiques du commun, comme dans le cas des cantines de quartier.
Le choix courageux des diplômés bifurqueurs ou déserteurs, agronomes, informaticiens ou autres, peut également être considéré comme une amorce d’espace libéré. Tout ce qui permet de nous « décapitaliser », c’est-à-dire de défaire en nous l’emprise des manières de vivre et des subjectivités façonnées par le monde de l’économie, est bon à prendre. Ces espaces libérés peuvent aussi prendre des dimensions plus conséquentes, comme à la Zad de Notre-Dame-des-Landes, au quartier libre des Lentillères, à Dijon, avec des expériences coopératives comme celle de Longo Maï ou, plus nettement encore, avec l’autonomie zapatiste.
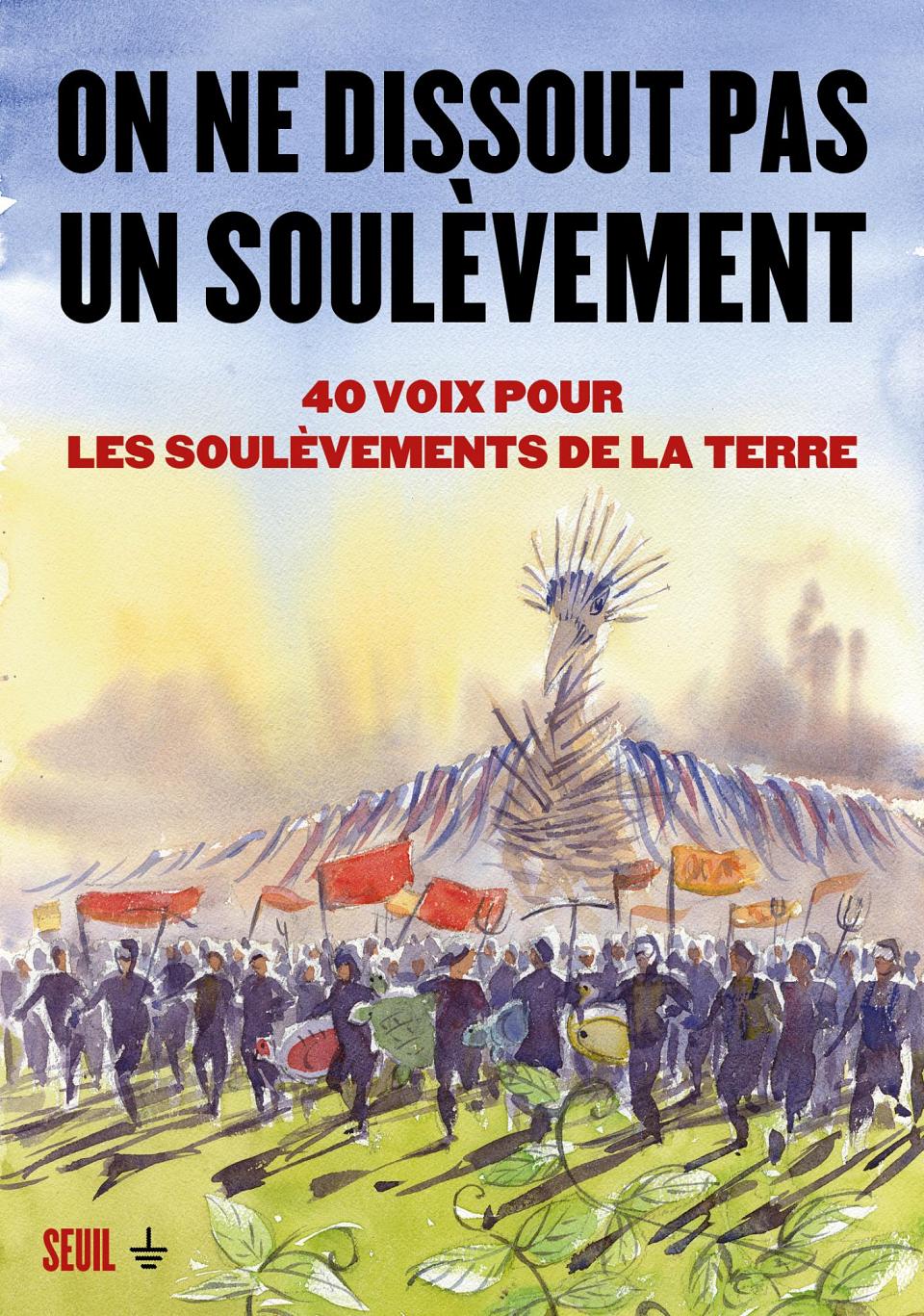
Pour autant, dans le cas de la lutte contre les mégabassines, je ne suis pas sûr qu’il s’agisse de créer de nouveaux espaces libérés – même si toute mobilisation collective crée aussi de nouvelles relations entre les personnes, comme ce fut le cas sur les ronds-points des Gilets jaunes. Il n’a jamais été question de créer une Zad à Sainte-Soline, contrairement aux affirmations de Gérald Darmanin, qui n’a brandi cette supposée « menace » que pour fanfaronner qu’il en avait empêché la réalisation. Je dirais plutôt que la lutte contre les mégabassines, comme les autres mobilisations des Soulèvements de la Terre, relève d’une stratégie de blocage, puisqu’il s’agit d’entraver matériellement l’expansion des infrastructures et la croissance continue de la production.
La proposition stratégique que j’ai développée dans Basculements suppose la combinaison de ces deux registres d’actions, avec d’une part une dynamique continue d’affirmation des espaces libérés, et d’autre part, l’intensification de la conflictualité tendant à un blocage généralisé de l’économie.
Les formes de blocage gagneraient d’ailleurs à être envisagées dans toutes leurs modalités possibles : blocage de la production par la grève, interruption des flux de circulation, entrave aux grands projets d’infrastructure et désarmement des installations productives, mais aussi blocage de la reproduction – avec la grève scolaire ou avec les ingénieurs bifurqueurs qui ne veulent plus collaborer à la « reproduction » du monde de la destruction. Mais il ne s’agit certainement pas d’opposer les deux registres d’action. Au contraire, plus on dispose d’espaces libérés, plus peut croître la capacité de blocage ; et plus les blocages s’étendent, plus ils favorisent l’émergence des espaces libérés.
Diriez-vous que les Soulèvements de la Terre participent, d’une certaine façon, à reconfigurer la grande ambition révolutionnaire ?
Le recours au terme « révolution » est en partie piégé et reste toujours sujet à débat. En tout état de cause, il s’agit de donner corps à la possibilité d’un monde postcapitaliste, débarrassé des dominations patriarcales et coloniales. Mais cette perspective d’émancipation ne peut plus être pensée sous sa forme classique, élaborée sur la base des anciennes conceptions de la modernité : la croyance dans le progrès et l’inéluctable essor des forces productives ; l’idée d’une voie historique unique dont le monde occidental serait le modèle et l’avant-garde ; ou encore l’ontologie naturaliste qui dissocie les humains de la nature et les érige en maîtres et possesseurs de ses ressources.
Repenser aujourd’hui une perspective d’émancipation crédible – à la fois non productiviste, non naturaliste, non eurocentrique et probablement non étatique – implique à la fois une profonde critique des expériences historiques, une révolution anthropologique et l’émergence de régimes d’historicité inédits. Cela implique également d’accepter qu’il n’y a pas une seule voie pour sortir du capitaliste, mais qu’il s’agit de construire « un monde où il y ait place pour de nombreux mondes », comme disent les zapatistes.
Les Soulèvements de la Terre me semblent s’inscrire dans cette perspective, comme de nombreux autres mouvements à travers le monde. Le nom même du mouvement met en avant un acteur non humain et, de ce fait, 100 000 personnes ont ainsi clamé ensemble : « Nous sommes la Terre qui se soulève » ! La lutte ne peut plus se concevoir comme seulement humaine. Dans un contexte inédit de dévastation des conditions de vie sur cette planète, c’est la communauté terrestre qui est appelée à se soulever pour empêcher sa destruction, sous les eaux glacées du calcul égoïste ou, plutôt désormais, sous l’effet du souffle brûlant de la quantification marchande.
Recueilli par Barnabé Binctin
Photo de une : Manifestation à Sainte-Soline le 25 mars 2023/© Soulèvements de la Terre








