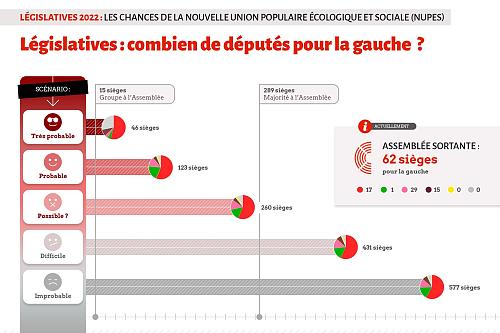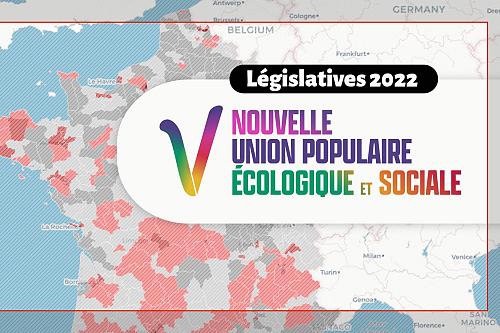Basta! : Vous avez écrit, après l’élection présidentielle états-unienne, que Donald Trump et ses alliés d’extrême-droite en Europe « prospéraient dans le vide » laissé par la gauche. Comment en est-on arrivé là ?
Owen Jones : Après la victoire de Trump, tout le monde a cherché une explication. Certains ont évoqué un phénomène de retour de bâton du vote blanc, « white-lash » (le retour de bâton réactionnaire des « petits blancs », NdT) contre la lutte des Afro-Américains, des femmes et des LGBT pour l’égalité et la dignité. D’autres ont parlé de la souffrance économique des millions de travailleurs blancs qui ont vu leurs industries dépecées au fil du temps. Il y a aussi le fait que les électeurs démocrates, notamment les jeunes et les Afro-Américains, se sont faiblement mobilisés. Bien entendu, la misogynie a joué un rôle dans la défaite de Hillary Clinton. Mais cette défaite est surtout due à l’échec du Parti démocrate : il n’a pas su représenter des millions d’Américains des classes populaires, et s’est asservi aux intérêts de ceux qui financent les campagnes électorales.

Nous en sommes arrivés à ce résultat absurde qu’un ploutocrate comme Trump, qui s’est immédiatement entouré d’autres ploutocrates de Goldman Sachs pour gouverner, a réussi à se faire élire en présentant Hilary Clinton comme la candidate de l’establishment et de Wall Street ! La victoire de Trump s’explique par une combinaison de facteurs, mais il a clairement bénéficié d’un fort mouvement en sa faveur parmi les Américains les moins fortunés par rapport à l’élection de 2012. C’est ce qui lui a permis de remporter la victoire au niveau du collège électoral. Car il faut rappeler qu’il a perdu le vote réel (un écart de deux millions de voix en faveur de Clinton, ndlr).
Cette analyse vaut-elle aussi pour l’Europe ?
L’échec de la gauche est de ne pas avoir de message clair qui parle aux gens, notamment les petites gens, et qui les inspire. Les mouvements populistes de droite comblent ce vide. En France, de nombreuses localités qui votaient communiste votent désormais pour le Front national. On voit la même chose en Grande-Bretagne. Dans mon premier livre, Chavs, j’ai raconté comment le Labour a cessé de parler de classes. Ils parlent encore un peu des problèmes des femmes et des LGBT, mais plus du tout de classe sociale. D’où le danger qu’une droite populiste suffisamment maligne s’approprie ce langage de classe à son profit, en dénonçant la manière dont les classes populaires seraient prétendument démonisées et abandonnées par les « bobos » des grandes villes, qui mépriseraient leur patriotisme et laisseraient détruire leur mode de vie par la mondialisation et l’immigration. C’est ce à quoi on assiste partout aujourd’hui.
Aux États-Unis, certains démocrates estiment que c’est parce que leur parti s’est trop intéressé aux minorités qu’il a perdu. Mais c’est une fausse dichotomie. Les classes populaires sont intrinsèquement diverses. Les femmes, les minorités ethniques, les LGBT, et ainsi de suite, font partie des classes populaires. La social-démocratie européenne et les démocrates aux États-Unis n’ont pas su représenter les intérêts des classes populaires dans leur diversité. Ce faisant ils ont rendu la tâche plus facile à la droite populiste qui dit que la gauche ne s’intéresse qu’aux minorités et pas aux travailleurs blancs. Si la gauche avait porté un message de justice économique, les choses seraient différentes. Elle a échoué à le faire.
Cet échec tient-il seulement au fait qu’une grande partie de la gauche s’est convertie au néolibéralisme ?
Pas seulement. La social-démocratie est en crise dans toute l’Europe. En Grande-Bretagne, le Brexit a mis en lumière de profondes divisions au sein de l’électorat traditionnel du Labour. Certains électeurs voulaient passionnément quitter l’Union européenne, d’autres passionnément rester. Comment garder ces gens ensemble ? Il existe aussi une question générationnelle : les générations plus âgées, dans nos sociétés vieillissantes, sont de plus en plus enclines à soutenir les partis de droite, et la gauche n’a pas grand chose à leur dire. La classe industrielle, base traditionnelle de la social-démocratie, est en déclin. Une partie croissante des classes populaires travaille dans les services. Le nombre de diplômés universitaires vivant dans des grandes villes augmente également. Les perspectives et les priorités de ces couches sociales sont ainsi différentes, et de plus en plus divergentes. Cela fait beaucoup de crises existentielles pour la gauche.
Est-il possible, dans ces conditions, de réconcilier la gauche avec elle-même ? Nous en avons l’exemple en France avec les candidatures concurrentes de Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, qui renvoient malgré tout à des lignes de fracture bien réelles.
Il faut revenir à ce qui nous unit. Et beaucoup de choses nous unissent. Par exemple, rappeler qui est responsable de la crise économique et à qui on en a fait payer les conséquences. Ou encore le service public et la résistance à la privatisation, la justice fiscale, l’investissement dans l’économie réelle, les droits des travailleurs.
En ce qui concerne les présidentielles françaises, ce sera évidemment aux électeurs de décider. J’ai rencontré des représentants de Benoît Hamon et de Jean-Luc Mélenchon. Si la gauche reste divisée et qu’il y un second tour entre Macron et Le Pen, ou entre Fillon et Le Pen, ils auront des comptes à rendre. Ils devront expliquer comment nous en sommes arrivés à ce second tour, qui était parfaitement évitable. La France pourrait se retrouver avec une présidence Le Pen, qui serait un désastre absolu pour toute l’Europe, le pire sans doute depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ou au mieux avec une présidence Macron, qui attaquerait beaucoup de droits et d’acquis sociaux.
Il s’agit d’être un peu flexible, au lieu de donner dans le sectarisme. Benoît Hamon n’est pas François Hollande. Certes, il est issu de l’establishment du parti socialiste, mais c’est aussi le cas de Jean-Luc Mélenchon. Il est toujours exagéré d’invoquer Hitler et les nazis, mais je rappelle tout de même que s’ils ont remporté les élections légilsatives de 1932, c’est parce que socialistes et communistes ne sont pas parvenus à se mettre d’accord. Certes, il existait des raisons sérieuses à ce désaccord, comme le souvenir de l’assassinat de Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht, mais ils ont tout de même permis à Hitler d’arriver au pouvoir. Ensuite les nazis les ont tous tués sans discrimination.
Comment redonner de l’élan à la gauche, qui se replie souvent sur une position moraliste face à l’extrême-droite ?
L’un de nos problèmes fondamentaux est la disparition d’une vision optimiste. La gauche apparaît le plus souvent comme défensive : contre la privatisation, contre le Tafta (le traité de libre-échange Europe-États-Unis, ndlr), contre la casse sociale. Je ne cite pas fréquemment Ronald Reagan, mais même si ses politiques consistaient à donner toujours plus aux riches, son discours était toujours résolument optimiste, comme dans sa célèbre campagne « Morning in America ». Il parlait de l’avenir formidable que les gens auraient tous ensemble. Par contraste, la gauche – y compris moi-même – est souvent un peu déprimante.
C’est pour cela que l’idée d’un revenu universel mise en avant par Benoît Hamon m’a intéressé. Nous avons besoin d’idées qui soient aussi des visions, et qui parlent aussi aux jeunes. Les jeunes ont souffert de manière disproportionnée des politiques mises en place ces dernières années. Le soutien dont le Front national bénéficie parmi les jeunes Français est horrifiant. Il n’a pas d’équivalent dans les autres pays européens.
Bref, nous avons besoin d’une vision optimiste et inspirée, plutôt que de rester toujours sur la défensive. Les gens veulent se sentir bien. Qu’a dit Trump ? Make America great again, « Rendre l’Amérique à nouveau grande et formidable ». Qu’ont dit les militants du Brexit ? Take back control, « Reprendre le contrôle ». Ce sont des slogans valorisants, optimistes, qui parlent aux gens de la rue.
Mais n’est-ce pas exactement ce qu’Obama a fait ? Cela n’a pas empêché la victoire de Trump...
Certes, il y a une différence entre les slogans et la substance. Dans ce cas la substance a été décevante. Mais au moins il a remporté deux fois les élections présidentielles, contre la plupart des prédictions. Je ne propose pas d’imiter les politiques mises en œuvre par Reagan ou même par Obama, mais il faut tirer les leçons de leurs victoires. Ce qu’Obama, Trump et le Brexit ont en commun, c’est la rhétorique de l’émancipation et du possible. La droite est souvent très forte pour jouer sur le désir des gens de se sentir bien, d’être satisfaits d’eux-mêmes, même si cela implique d’en appeler aux instincts les plus basiques. C’est aussi ce qui a toujours fait la force du néolibéralisme. Personne n’a jamais fait campagne avec pour slogan de réduire les impôts pour les riches et de donner encore plus d’argent aux multinationales : le slogan était celui de l’émancipation des individus pour qu’ils réalisent leur plein potentiel, libérés de l’État et de l’assistanat…
Vous travaillez actuellement à votre prochain livre, Politics of Hope (« Politique de l’espoir »), qui sera publié simultanément dans plusieurs pays européens. Où est aujourd’hui cette « politique de l’espoir » ?
Je voyage beaucoup, je vais à la rencontre d’experts et de militants pour découvrir des expériences qui fonctionnent, des idées intéressantes, de nouvelles manières de s’organiser et d’amener le changement. La gauche est actuellement sur la défensive, pour ne pas dire en retraite. Nous avons besoin de repartir à l’offensive, de réfléchir à la vision positive dont nous sommes porteurs. C’est le sujet de mon livre.
Quels sont les grands chantiers de la gauche aujourd’hui ?
Par où commencer ? Il faut organiser les travailleurs précaires et s’attaquer à l’enjeu du travail indépendant : les gens aiment la liberté qui l’accompagne, mais pas l’absence de sécurité. Nous devons essayer de regagner les personnes âgées. Et retisser une large coalition allant des ouvriers âgés dans les petites villes aux diplômés des métropoles. La question du réchauffement climatique peut jouer un rôle central dans cette optique. Bien sûr, c’est d’abord une crise existentielle pour l’humanité. Mais c’est aussi une opportunité, si l’on regarde des pays comme l’Allemagne.
Par contraste avec la Grande-Bretagne où le Labour a laissé l’industrie disparaître, l’Allemagne a mis au point une stratégie active pour développer les énergies renouvelables et continuer à créer des emplois décents dans le secteur industriel. Le réchauffement climatique est souvent présenté comme une question abstraite, scientifique, un peu ennuyeuse. En réalité, c’est une question très concrète, quotidienne, qui concerne nos emplois, nos modes de vie, nos logements. Pourquoi ne pas isoler des millions de logements en France et en Europe ? Tout l’enjeu est de montrer comment cet objectif touche la vie des gens.
Vous suivez de près l’expérience de Podemos et des municipalités remportées par la gauche en Espagne. Le niveau local est-il le seul où la gauche remporte encore des victoires aujourd’hui ?
L’expérience de l’Espagne montre effectivement qu’il est possible de transformer les villes et le niveau local en pôles d’alternatives. La gauche espagnole a montré que c’était possible. Elle utilise le pouvoir dont elle dispose du mieux qu’elle peut pour montrer qu’une autre société est possible. C’est important parce que la politique part souvent du local, du quotidien. Ensuite, tout dépend du contexte institutionnel de chaque pays. La Grande-Bretagne est encore extrêmement centralisée mis à part la dévolution de certaines compétences à l’Écosse et au Pays de Galles. Les collectivités locales n’ont aucun pouvoir, si ce n’est de répercuter les coupes budgétaires décidées au niveau central.
Parlons de la Grande-Bretagne. Où en est le Labour ? Le Brexit peut-il encore être transformé en une opportunité positive ?
Le Brexit a été un désastre. Le sujet n’a jamais été l’Union européenne, mais l’immigration. Le référendum a déclenché une vague de xénophobie et de racisme qui a massivement aidé les conservateurs. Le Labour est en crise pour les raisons structurelles que j’ai dites, mais aussi à cause des nombreuses défaillances de Jeremy Corbyn et de son équipe, qui ont fait toutes les erreurs stratégiques et de communication imaginables. Ils ont donc laissé le champ libre à la vague actuelle de réaction.
En ce qui concerne le Brexit, maintenant que les gens ont voté, nous n’avons pas d’autre choix que de chercher à nous tirer au mieux de la situation telle qu’elle est, en militant pour une sortie de l’Union qui donne la priorité à l’emploi et au niveau de vie, et qui préserve les droits des citoyens de l’UE résidant en Grande-Bretagne.
Est-il possible de créer une alternative à l’austérité et au néolibéralisme au seul niveau national ?
Nous avons besoin d’un mouvement international, parce que les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont globaux. Je ne pense pas cela possible dans un seul pays. Bien sûr, si la France avait un gouvernement progressiste, elle ne serait pas soumise aussi facilement au même chantage que la Grèce, qui ne pesait que quelques pourcents de l’économie de l’Eurozone. Mais elle ne pourrait pas réussir toute seule. Bien sûr que nous avons besoin d’un mouvement international.
Propos recueillis par Olivier Petitjean
Photo : Manifestation des Insoumis, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, pour la VIe République à Paris le 18 mars 2017 / CC JF Henane