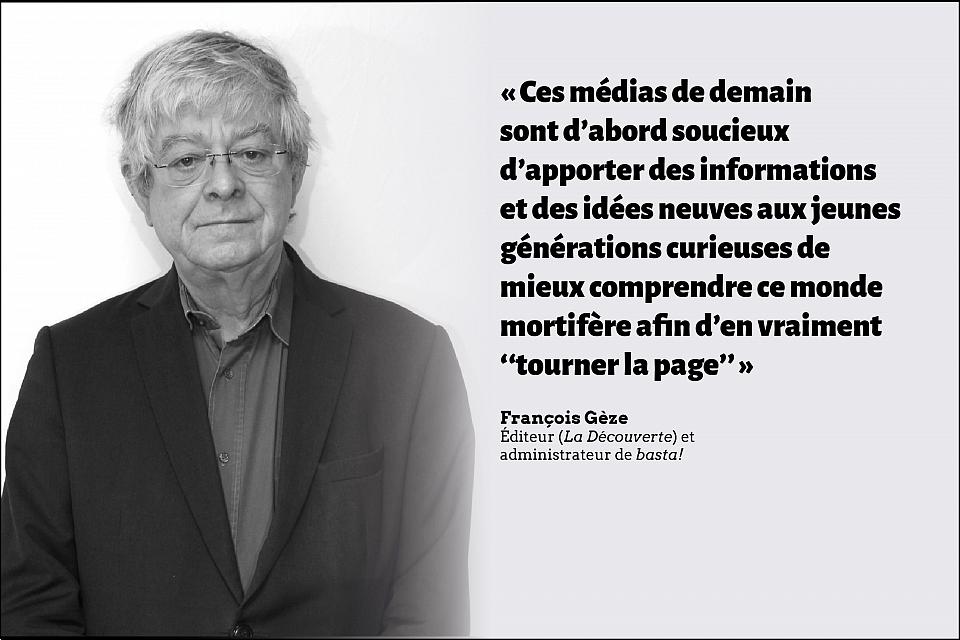Le lancement à l’initiative de Basta! de la revue de presse hebdomadaire gratuite « Chez les indés », pour rendre compte des parutions les plus pertinentes des médias indépendants, vient assurément à point nommé. Je voudrais donner ici quelques raisons de cette conviction, à partir de mon expérience d’éditeur de livres de non-fiction, partageant de très longue date l’engagement critique aux origines de Basta!. Le foisonnement de médias indépendants ou « alternatifs » que l’on observe en France (mais ailleurs aussi) depuis quelques années répond en effet à une demande accrue d’une « autre information », qui coïncide avec une demande accrue de livres de « sciences sociales critiques », écrits aussi bien par des universitaires que par des journalistes.
Le boom des livres de sciences sociales critiques
C’est en 2018 que j’ai pu constater empiriquement, à partir des ventes des livres de La Découverte, une très nette augmentation des ventes moyennes de ces titres « critiques » (y compris des plus difficiles), qu’il s’agisse de nouveautés ou de livres du fonds. Intrigué, j’ai réalisé une petite enquête auprès de responsables de rayons de sciences humaines de grandes et moyennes librairies, en province comme à Paris : tous m’ont confirmé ce « boom » des livres de sciences sociales critiques, parfois spectaculaire (jusqu’à + 50 % à + 70 % d’une année sur l’autre). Et quand je leur demandais qui étaient les acheteurs, ils m’ont majoritairement répondu : les jeunes « éduqué.e.s » de 20-30 ans, qui leur disaient qu’ils voulaient mieux comprendre ce monde inacceptable dans lequel ils devaient vivre pour le changer plus efficacement !
D’où la demande particulièrement forte pour les livres traitant du combat écologique, des luttes féministes et antiracistes, des modèles économiques alternatifs, etc. La croissance de cette demande s’est depuis ralentie, mais elle se maintient à un niveau élevé. Un retournement somme toute spectaculaire, contrastant avec la morosité plus ou moins résignée des jeunes générations précédentes moins curieuses de pensée critique, depuis les années 1980.
Ce constat est évidemment encourageant, mais il crée de nouveaux enjeux à relever, pour les éditeurs de livres comme pour ceux des nouveaux médias indépendants qui défendent les mêmes idées, afin qu’elles atteignent plus efficacement ces « nouveaux lecteurs ». Paradoxalement, la tâche est sans doute plus facile pour le livre que pour la presse, pour plusieurs raisons.
L’épineuse question des chaînes de diffusion
La principale tient sans doute aux différences dans les chaînes de diffusion. Alors que le rôle des kiosques et maisons de la presse n’a cessé de se réduire au cours des dernières décennies, du fait de la baisse continue des ventes de périodiques imprimés et de la concurrence croissante de l’offre numérique d’information (et de divertissement), le réseau français de librairie, grâce à la loi sur le prix unique du livre, est resté très dynamique. Du coup, les éditeurs de livres de sciences sociales critiques peuvent bénéficier du rôle de « filtre » efficacement assuré par les libraires dit de « premier niveau » (environ un millier en France), tout particulièrement par leurs responsables de rayons de sciences humaines, souvent très soucieux de mettre en avant les livres « critiques » qui paraissent et qu’ils connaissent de mieux en mieux.
Ces lanceurs d’alerte sont très écoutés de leurs jeunes clients et peuvent être à l’origine de succès spectaculaires (comme les livres de Naomi Klein hier ou ceux aujourd’hui de Mona Chollet, Sorcières et Réinventer l’amour), alors relayés par le plus vaste réseau de libraires de « deuxième niveau ». Les éditeurs de médias alternatifs (périodiques imprimés, sites web d’information, chaînes YouTube, radios numériques et podcasts, etc.) ne bénéficient pas d’un tel réseau de relais crédibles et indépendants et doivent alors recourir notamment aux « réseaux sociaux », dont on sait l’efficacité aléatoire, d’autant plus que les plus puissants d’entre eux sont aux mains des GAFAM [acronyme de Google (Alphabet), Amazon, Facebook (Meta), Apple, Microsoft, ndlr] fort peu soucieux de promouvoir l’information indépendante.
Les contraintes de la révolution numérique
Une autre différence majeure tient aux effets de la « révolution numérique ». Depuis une bonne quinzaine d’années, les éditeurs de livres ont systématiquement développé l’offre de versions numériques de leurs nouveautés, mais leur part relative dans les achats est restée en France – comme dans beaucoup de pays – très minoritaire (de 3 % à 15 % selon les genres). Tout simplement parce qu’il est en général plus agréable et facile de lire un livre imprimé – en particulier d’information ou de sciences sociales – que sa version sur écran. Tandis que l’explosion du Web depuis un quart de siècle, puis celle des smartphones depuis une dizaine d’années ont rendu accessible une offre gigantesque de « formats courts » (textes comme vidéos ou audios) bien mieux adaptés que le livre « traditionnel » (certes toujours nécessaire) à ces nouveaux supports.
Cela a obligé tous les offreurs de contenus numériques, ceux d’information indépendante comme les autres, à inventer de nouvelles formes de commercialisation (« modèles économiques », comme on dit chez les start-ups) et de médiation (CRM, pour « gestion de la relation client », & compagnie) pour parvenir à se faire connaître. Une évolution très loin d’être stabilisée, alors que la traditionnelle « chaîne du livre » a pu s’adapter bien plus facilement à la fameuse révolution numérique.
La concentration capitalistique
Troisième facteur important, enfin, celui de la concentration capitalistique. Depuis les années 1960, elle existe dans le livre comme dans la presse, mais avec des différences notables. Dans l’édition de livres, elle a conduit à la constitution de grands groupes (comme aujourd’hui Hachette, Éditis, Madrigall, Médias-Participations ou Albin Michel), mais qui n’ont jamais cessé d’être des « fédérations de PME » aux publics et aux sensibilités très variées, tant la gestation d’un livre implique le plus souvent une maturation longue, où la relation entre l’auteur et son éditeur reste centrale.
Les actionnaires de ces groupes savent ainsi qu’un équilibre doit être préservé entre leurs objectifs de rentabilité à court terme et ceux de la rentabilité à long terme ; et s’ils privilégient la première au détriment de la seconde, ils ne peuvent alors empêcher que la création éditoriale novatrice trouve refuge dans de petites structures indépendantes relativement faciles à créer et où naissent souvent des best-sellers inattendus. Dans tous les cas, la temporalité longue du livre comme la diversité incontournable des auteurs interdisent de transformer des « marques » éditoriales en simple relais d’objectifs idéologico-politiques. Depuis des décennies, tous les actionnaires qui ont tenté de le faire ont régulièrement échoué.
C’est évidemment beaucoup moins le cas dans les grands groupes de presse, car les créateurs « producteurs de valeur » n’y sont pas les auteurs d’ouvrages, très nombreux et divers et dont les niveaux de rémunération sont très variables selon l’audience de leurs livres, mais les journalistes, nécessairement salariés selon des grilles à peu près établies et dépendant d’abord de l’audience de leur journal. De ce fait, le rapport de ces derniers à leur employeur et à sa ligne éditoriale est assez radicalement différent de celui des auteurs de livres, lesquels peuvent facilement changer d’éditeur.
Dès lors, en France comme ailleurs, la tentation constante des actionnaires de grands groupes de presse a souvent été de les utiliser comme des outils d’influence au bénéfice de leurs intérêts propres. Au point que le droit social de la presse a dû introduire la notion de « clause de conscience » permettant à un journaliste de quitter son journal dans des conditions financières convenables en cas de changement d’actionnaire aux motivations plus idéologiques qu’économiques.
L’« idéologisation » des médias privés
Depuis, la baisse des ventes de la presse écrite provoquée notamment par la crise de confiance des lecteurs induite par cette « idéologisation » des médias privés, conjuguée à l’éclatement de l’offre audiovisuelle, évolutions accentuées par la concurrence de l’offre numérique et le tournant néolibéral des années 1980, a entraîné une très sérieuse « crise de la presse » – dont l’effondrement régulier de l’audience d’Europe 1 ou de celle des « news magazine » issus des Trente Glorieuses (L’Express, Le Point, L’Obs, Marianne...) offre un exemple saisissant. D’où, paradoxalement, une accentuation de l’une des causes de cette crise, à savoir l’idéologisation capitalistique, mais aussi l’émergence depuis les années 2000 de très nombreux « médias libres », à l’initiative de journalistes ne se reconnaissant plus dans ces « médias du passé » (écrits ou audiovisuels) restant « mainstream » par inertie.
Ces « médias de demain » sont d’abord soucieux d’apporter des informations et des idées neuves (et radicales) aux jeunes générations (et aux moins jeunes qui n’ont pas renoncé aux engagements émancipateurs de leur jeunesse) curieuses de mieux comprendre ce monde mortifère de l’idéologie encore dominante, afin d’en vraiment « tourner la page ». Mais à la différence de ce que nous connaissons dans le monde du livre, où la qualité de certaines traditions interprofessionnelles reste un atout, ces nouveaux médias doivent inventer à nouveaux frais de nouvelles formes de médiations.
L’idée de la revue de presse hebdomadaire « Chez les indés », visant à « renforcer la visibilité de la presse indépendante », va à l’évidence dans ce sens. Il me paraît essentiel de la promouvoir, précisément parce que la compétence et la rigueur des journalistes de Basta!, déjà à l’origine du « Portail des médias libres », leur donnent la crédibilité indispensable pour sélectionner les contenus les plus nécessaires publiés par les « indés ».
François Gèze (éditeur, administrateur de Basta!)
Pour s’inscrire à la newsletter « Chez les indés », c’est par ici.