Basta! : Une forme de rigueur ou d’austérité budgétaire est censée être pratiquée depuis au moins vingt ans : gel du point d’indice des fonctionnaires, sous-investissements et privatisations d’infrastructures publiques, déliquescence de l’hôpital, enseignants et chercheurs sous-payés, etc. Pourtant, dans le même temps, la dette ne cesse d’augmenter. La question est donc : où va l’argent ? « Où sont passés nos milliards » comme s’interroge le titre de votre livre ?
Lucie Castets : Je n’utilise pas le terme d’austérité, car en réalité, les budgets ne diminuent pas, ils augmentent même un peu. L’indicateur intéressant, c’est le niveau de dépenses publiques par rapport au PIB : depuis 2012, il reste assez stable, autour de 57 %. Comme le PIB augmente un peu chaque année, cela signifie que la dépense publique augmente également un peu, en volume. Pour autant, la part dédiée au financement des services publics, elle, n’a pas augmenté. Cela veut donc dire que l’on finance autre chose, et notamment les aides aux entreprises. Parmi les pays de l’OCDE, nous sommes aujourd’hui l’un de ceux qui soutiennent le plus, financièrement, leur économie marchande. Nous sommes à peu près à 185 milliards d’euros par an de subventions et d’aides type crédit d’impôt. C’est cette dépense publique qui a explosé ces dernières années : entre 1979 et aujourd’hui, elle est passée de 3,1 % à 6,2 % du PIB.
Or il a été largement démontré qu’une partie de ces aides ne sont en réalité pas efficaces, et ne permettent pas d’atteindre les objectifs assignés, par exemple en matière de création d’emplois. C’est le cas notamment du CICE, un crédit d’impôt qui a ensuite été transformé en exonération pérenne de cotisations : si on rapporte le coût pour la collectivité au nombre d’emplois créés, il aurait été, par exemple, beaucoup moins onéreux de créer des emplois de fonctionnaires bien rémunérés ! C’est aussi le cas du crédit impôt recherche, qui coûte plusieurs milliards d’euros par an, et qui bénéficie de façon très disproportionnée aux plus grosses entreprises, qui auraient probablement effectué les mêmes dépenses, avec ou sans ce crédit.
N’est-ce pas également le rôle de l’État que d’accompagner l’activité économique et la création de richesses ?
Je ne dis pas que toute aide aux entreprises est mauvaise par nature. Ce que je veux, c’est mettre cette question au cœur des débats, alors qu’on entend à longueur de journée que les services publics ou la protection sociale coûtent trop cher… Au contraire, l’évolution des dépenses publiques est plutôt favorable aux entreprises, et défavorable aux ménages et aux services publics. C’est important de le dire. Ensuite, bien sûr, il faut flécher les dépenses là où elles sont les plus efficaces possibles, en fonction d’objectifs qu’on devrait délibérer collectivement. Depuis 2017, on a un président de la République qui ne cesse de nous dire qu’il ira chercher les solutions là où elles sont bonnes, mais force est de constater qu’il est pour le moins ambivalent au regard des expertises qui démontrent l’inefficacité de ces mesures… En réalité, Emmanuel Macron a immédiatement été le président des entreprises, en assumant l’idée qu’il fallait mener une politique de l’offre, et qu’il y aurait du « ruissellement ». Raison pour laquelle il est beaucoup moins prompt à remettre en cause les aides aux entreprises.
Il ne faut pas sous-estimer non plus le poids de ces entreprises, qui sont extrêmement puissantes pour peser sur l’élaboration de la réglementation. Pour l’avoir vu de mes propres yeux, je sais combien le chantage sur l’emploi et les menaces sur les conséquences économiques effraient vite les décideurs politiques. Ce que j’aimerais, c’est pouvoir organiser des discussions plus sereines sur ces sujets, autour de la rationalisation des aides aux entreprises, mais aussi de l’utilité collective des services publics. J’aimerais ainsi entendre des entrepreneurs dire combien ils ont besoin de services publics performants, parce que ce n’est pas bon pour eux quand la population est mal soignée ou mal formée, ou quand les infrastructures de transport sont désuètes – et je me place là dans une perspective purement économique, en termes d’efficacité. Le Medef, on ne l’a entendu qu’au tout dernier moment dire « attention, ne coupez pas trop l’immigration, parce qu’on a des filières entières de notre économie qui reposent sur des travailleurs migrants ». S’ils ne le disent pas plus tôt, c’est probablement pour des raisons idéologiques.
Pourquoi choisissez-vous de mettre cette question des services publics au cœur de la bataille politique pour la gauche ?
En fait, il me semble que la question s’est posée dans l’autre sens : c’est parce que je m’étais engagée sur ce sujet-là, avec le collectif Nos services publics, que je suis arrivée dans le paysage politique cet été. Depuis, je continue naturellement de porter ce combat sur la scène publique. Sur le fond, c’est un sujet fondamental : quand on est de gauche, on croit au fait qu’il faut un accès universel à des droits équitables, qu’il faut que tout le monde puisse avoir les mêmes chances dans la vie quels que soient sa condition sociale, son milieu d’origine ou son lieu de naissance. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
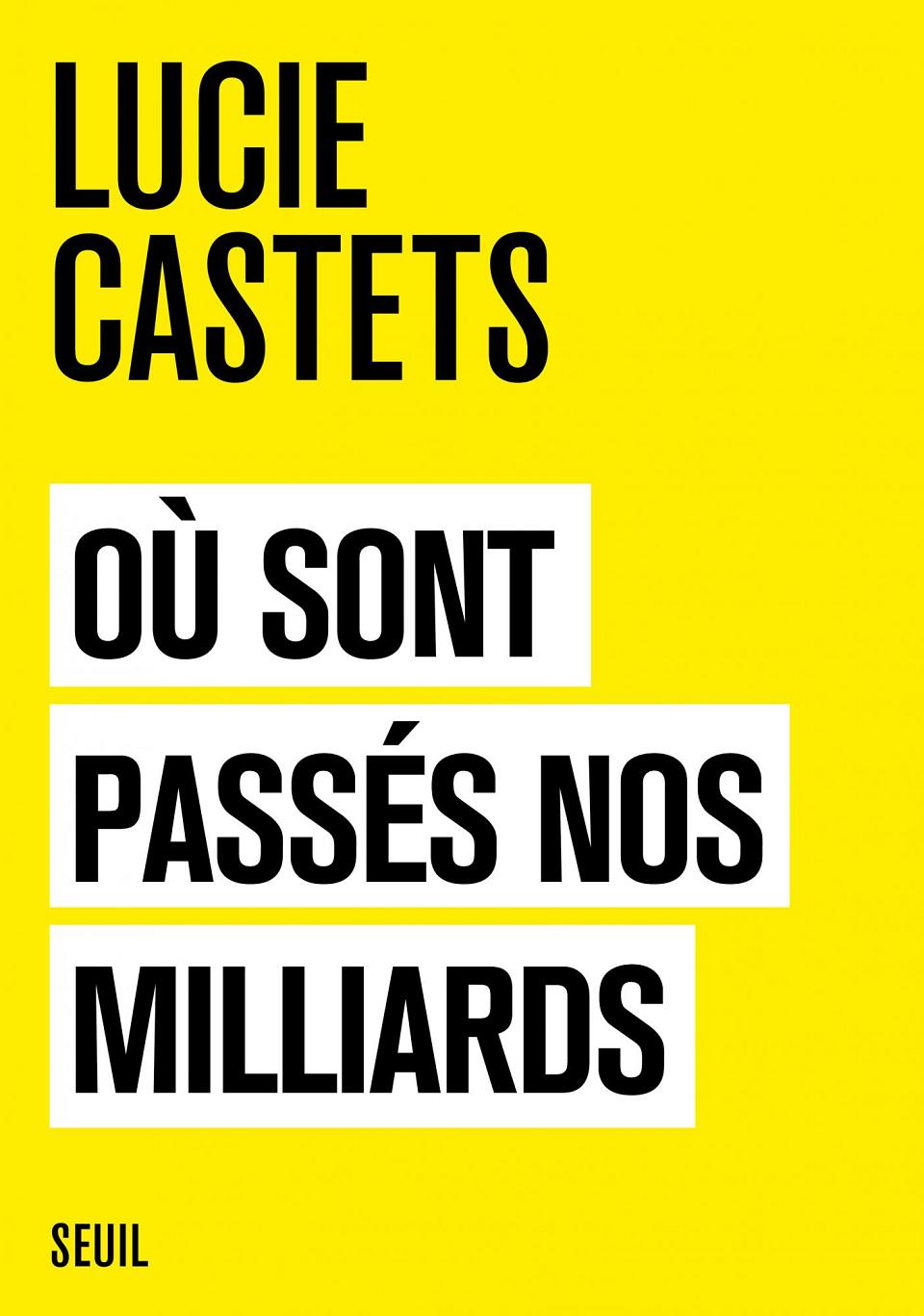
Faire des services publics un pilier de notre pacte social, c’est un dénominateur commun des partis de gauche. Et puis, c’est aussi un enjeu de stratégie électorale, au sens noble du terme : plein de gens ne votent plus à gauche, ou votent pour le Rassemblement national, parce qu’ils ont l’impression que la puissance publique les abandonne. Ce n’est pas une impression illégitime, à mon sens. C’est aussi par les services publics que l’on peut démontrer que la politique peut encore améliorer quelque chose dans la vie des gens. Mais ce sujet devrait transcender les clivages politiques, car en réalité, tout le monde a intérêt à avoir des services publics performants et très développés.
Comment faire rêver les Français et les Françaises avec les services publics ? Ce discours-là n’est pas nouveau à gauche, mais on a l’impression qu’il peine parfois à mobiliser ou à susciter de l’enthousiasme…
Il ne faut pas être dans une posture nostalgique et anachronique, dans le « c’était mieux avant », en proposant uniquement de restaurer les services publics tels qu’on les a connus. On ne peut pas se contenter de dire qu’il faut remettre des bureaux de poste et des profs devant nos élèves, il faut expliquer comment on améliore cela, en même temps qu’on le restaure. Parce que le périmètre des services publics doit être un objet mouvant. Les services publics sont là pour accompagner la société et ses évolutions, on peut en inventer de nouveaux. Si on prend l’éducation, je pense par exemple qu’il faut non seulement dire qu’il faut un prof devant chaque élève, mais aussi qu’il est très important de parler de projet pédagogique et de raconter comment on améliore l’éducation au quotidien, au service d’un projet de société qui dépasse les enjeux d’employabilité, par exemple.

Pour « faire rêver » comme vous dites, on a besoin d’expliquer concrètement tout ce que ces services publics peuvent apporter : on connaît tous plein de personnes qui considèrent que l’école et certains profs ont changé leur vie. Et ça, ça fait appel à des expériences individuelles qui font écho à un projet de société. Aujourd’hui, on attise beaucoup les relents identitaires et les passions tristes. Je crois qu’on peut apporter des formes d’identités positives avec les services publics. Les Français sont fiers d’avoir eu un hôpital public qui a été, pendant des décennies, l’un des plus efficaces au monde ! Voilà une fierté française, accueillante et ouverte à tous, qui fait beaucoup plus rêver.
François Ruffin a lancé une campagne intitulée « Notre France qui protège et qui partage », qui peut faire écho à cet enjeu des services publics. Partagez-vous avec lui ce constat d’une France scindée entre « la France des bourgs et la France des tours » ? Et les services publics sont-ils précisément l’un des outils pour panser cette fracture ?
Je ne partage pas vraiment cette idée que les problématiques se poseraient de façon si différente entre la France des bourgs et la France des tours. Je pense au contraire que les services publics illustrent un certain nombre de points communs dans les expériences vécues entre les populations rurales et les populations périphériques. Quel est le premier désert médical de France ? C’est la Seine-Saint-Denis, où les transports publics sont également très lacunaires et le sous-investissement criant dans l’éducation supérieur. Par ailleurs, il ne faudrait pas oublier les outre-mer, qui ont accès à encore moins de services publics.
Il y a bien sûr des particularités, mais je ne tiens pas à construire un discours qui oppose des catégories de population. Il faut parler à tout le monde, de même qu’il ne faut pas abandonner les électeurs du RN au motif qu’on les considèrerait trop racistes, et qu’ils seraient « perdus », que ce serait trop tard pour les rattraper. Dans son travail sur l’électorat RN du sud-est de la France, Félicien Faury montre bien qu’on ne peut pas dissocier la question du racisme de l’expérience vécue par les gens : le fait de se sentir exclu des services publics peut renforcer une racialisation du discours, en créant des concurrences de précarité qui conduise à vouloir trouver des boucs émissaires. Les enjeux de racisme et de services publics sont poreux.
« La France est un pays d’électeurs de gauche qui s’ignorent », avez-vous défendu auprès de nos confrères de « Reporterre ». Ce n’est pas vraiment ce que laissent entendre les résultats des dernières élections...
J’admets que c’est contestable, mais cela ouvre un débat intéressant. Cette phrase m’a été inspirée par la lecture du livre de Vincent Tiberj, La Droitisation française, mythe et réalités (PUF, 2024). Il y explique que le déterminant du vote est passé du domaine socio-économique à un domaine plus « culturel », au sens large – notamment à travers la question identitaire, justement. Si on arrivait à renouer avec un vote s’alignant plutôt sur les intérêts économiques et sociaux, alors la gauche peut vraiment l’emporter. Parce qu’en réalité, dans les classes populaires, personne n’a intérêt à ce que la droite ou l’extrême droite soit au pouvoir si l’on considère leurs programmes sur l’économie ou sur les services publics.
Le rôle de la gauche, c’est notamment de pouvoir offrir un discours suffisamment fort et cohérent sur les enjeux économiques. C’est pour ça que j’ai écrit ce livre, pour montrer que la gauche est plus sérieuse que la droite sur ce terrain. Et pour parler à tous ces gens qui ont l’impression qu’on ne leur parle plus. Je raconte l’exemple de ce boulanger qui s’esclaffe quand je lui dis qu’on veut mettre le Smic à 1600 euros, en me répondant qu’il ne veut pas mettre son patron en difficulté. Il faut réussir à expliquer qu’en fait, son patron est en difficulté parce que les impôts ne sont pas suffisamment bien répartis entre les petites, moyennes et grandes entreprises. Il faut pouvoir tenir un discours cohérent sur la façon dont on va rectifier ce système fiscal pour financer un Smic à 1600 euros.
Vous continuez à militer pour l’union de la gauche en vue de la prochaine présidentielle, en appelant tous les partis à se réunir autour d’une table, le 2 juillet prochain. Pour l’heure, la France insoumise et Place publique, le mouvement de Raphaël Glucksmann, ont fait savoir qu’ils n’envisageaient pas d’y participer… Vous croyez encore à la possibilité de réunir tout le monde ?
La porte reste ouverte. Je ne sais pas si ça marchera, mais c’est notre responsabilité collective que d’essayer. La meilleure option pour que la gauche arrive au second tour, c’est qu’elle soit unie. Cela dépendra de la dynamique qu’on arrivera à créer, si l’on parvient à ouvrir un espace politique qui parle aux électeurs de gauche – et j’insiste sur ce fait de bien chercher à parler aux électeurs. Peut-être alors que le nombre de participants autour de la table continuera de s’élargir. Un représentant du PCF vient de répondre à son tour qu’il y participerait. Que les insoumis ne donnent pas une réponse positive d’emblée, ce n’est pas vraiment une surprise, ils ont dit depuis plusieurs mois qu’ils comptaient présenter un candidat.
Mais après les précédents échecs aux présidentielles de 2017 et de 2022, puis les expériences pour le moins éphémères de la Nupes et du Nouveau front populaire (NFP) qui n’ont guère duré au-delà des élections législatives, ne craignez-vous pas une forme de lassitude de la part du peuple de gauche ?
Possible, mais on peut aussi retourner votre propos dans l’autre sens : à chaque fois, l’union a été accueillie avec une immense ferveur, qui traduit toute l’attente de ce peuple de gauche. Il y a une véritable aspiration à cela. Au lendemain des élections européennes, il y avait peu de gens – y compris moi – à croire possible de refaire un front uni type NFP, et pourtant… J’ai été très marquée cet été par tous ces électeurs de gauche qui s’impliquaient dans la campagne, qui faisaient partie des comités locaux du NFP, sans pour autant être encartés dans un parti. Il existe une nouvelle génération de militants politiques transpartisans qui ne s’engagent que pour l’union de la gauche.
Cette sorte d’engouement cet été, en tant que potentielle Première ministre du NFP, était liée non pas à ma personne, mais au fait que j’ai représenté à ce moment-là la possibilité de transcender les clivages entre partis. Aujourd’hui, je me sens une forme de responsabilité à l’égard de tous ces gens qui m’ont soutenue tout l’été, et qui m’ont dit de ne pas lâcher. Je ne sous-estime pas l’effet de lassitude, mais je considère que c’est mon rôle de faire perdurer cette union. Parfois, on me dit que je suis naïve, mais non, je suis tout aussi cynique que les autres : l’union, c’est simplement la meilleure option pour gagner ! Je ne dis pas que ça va advenir, je dis juste qu’autrement, on perd.
Dans votre livre, vous racontez avoir vécu cet été 2024 comme « une grande lessiveuse », avec « une exposition médiatique totalement nouvelle, brutale ». Dix mois plus tard, l’expérience ne vous a donc pas dégoûtée du jeu politique ?
Bien sûr qu’il y a de la violence en politique, comme il y en a beaucoup également sur les réseaux sociaux – j’ai été très frappée de voir tout ce que les gens pouvaient écrire derrière leur écran. Mais je suis à une place particulière, je me considère comme un tiers de confiance, et je crois que c’est utile d’avoir des gens pour jouer ce rôle de lien entre les partis politiques, ainsi qu’avec la société civile organisée. Je ne suis pas dans la vie politique partisane, je n’ai pris ma carte nulle part et je n’ai pas l’intention de le faire. Je me situe entre les partis, une sorte de partenaire libre comme je l’ai toujours été.
Cet été, on m’a beaucoup décrite comme n’étant pas libre, coachée par les partis, etc. Ce n’est pas vrai du tout. J’avais ma propre équipe autour de moi, pour m’aider à préparer les différentes étapes et les déplacements. Et quand je ne suis pas d’accord avec un parti, je n’ai aucun problème à le dire : quand les insoumis ont dit qu’il fallait mettre toutes nos forces dans la destitution [de Macron], j’ai dit que je ne pensais pas que c’était l’option la plus pertinente à ce moment-là. Je les avais prévenus avant et ça s’est très bien passé. Quand le PS a décidé de ne pas censurer le gouvernement, j’ai dit que je l’aurais fait si j’avais été parlementaire. Et ça ne va pas couper les ponts entre nous pour autant. Il ne faut pas surjouer les petites contradictions qui feraient que tout éclate. L’enjeu est ailleurs.


