Les mauvaises actions ont toujours besoin de bons acteurs. En tout cas, ça aide. Le Pavillon bleu, c’est un label qui permet à des centaines de plages et de ports en France, et des milliers dans le monde, de hisser le drapeau. Lequel signifie que leurs eaux sont d’une qualité irréprochable. Quiconque achète le sésame – ce n’est pas cher, mais c’est payant – peut sans complexe lancer de grandes campagnes destinées à attirer l’estivant. Et à le garder. Mais comment dire ? Ainsi que chantait Vian, y a quelque chose qui cloche là-dedans.
Des analyses de qualité insuffisante
Que lit-on sur les nombreux dépliants publicitaires mis en ligne par le Pavillon bleu ? Par exemple : Le Pavillon bleu participe activement à l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD). En 2015, 193 États membres des Nations unies ont signé conjointement un cadre fixant 17 Objectifs de développement durable pour transformer le monde. À la fois transversaux et interdépendants, ces objectifs portent par exemple sur l’éducation, la faim et la lutte contre la pauvreté. Cela ne veut rien dire. C’est simplement déclaratif.
Le Pavillon bleu ne fait rien dans ces vastes domaines, mais tient à faire savoir qu’il est contre la faim et la pauvreté, et pour l’éducation. Il aura oublié en route qu’il est aussi contre la guerre. Est-ce que cela marche ? Bien entendu. Dans cet autre extrait, on peut lire : Un sondage de l’institut BVA montre que 67 % des Français connaissent le Pavillon bleu et qu’il pourrait inciter 81 % des Français dans leur choix de lieu de vacances ! Selon 8 Français sur 10, le Pavillon bleu est une garantie de propreté des plages et de la qualité des eaux.
On ne peut qu’admirer le travail. Qui peut se vanter d’un tel résultat ? Hélas, les choses sont un peu plus compliquées.Tout théâtre dispose d’une scène et d’une coulisse. Et le Pavillon bleu ne fait pas exception. Côté scène,on exhibe les critères qui conduisent à l’obtention du label. Ça ressemble furieusement à du blabla. On y parle beaucoup de sensibilisation à l’environnement, de respect de règles aussi dures que la nécessité de « poubelles sur la plage ou à proximité, avec des consignes de tri claires et visibles ». Ou encore, sans l’ombre d’une précision : « Propreté des plages ». On en oublierait presque que la question essentielle est celle de la qualité des eaux de baignade.
Ah ! Nous y voilà. Pour hisser le pavillon bleu, il faut « 5 analyses des eaux de baignade minimum par saison avec un maximum d’intervalle de 31 jours ». Aïe ! On n’apprend rien sur la nature des analyses, ni sur celui qui les réalise. Tout lecteur de bonne foi comprendra que c’est le Pavillon bleu qui s’en charge, et il aura tort. Il aura gravement tort. Quiconque recherche sur le site officiel du Pavillon bleu davantage d’informations ne les trouvera pas. Elles n’y sont pas. La seule chose qui transparaît est de nature publicitaire. Si une plage a le Pavillon bleu, c’est qu’on peut y plonger avec la certitude que tout a été vérifié.
Le Pavillon bleu ne fait aucune analyse. Ce sont les agences régionales de santé (ARS), publiques, qui font le job pour une structure privée, même si elle est sous la forme d’une association loi 1901. En quoi consistent donc les analyses des ARS ? Elles ne recherchent que deux bactéries pathogènes, les très connues Escherichia coli et les entérocoques. Pour un syndicat d’initiative, c’est bien le moins, car passé un certain seuil, ces bactéries s’attaquent aux intestins des humains, souvent sous forme de gastro-entérites.
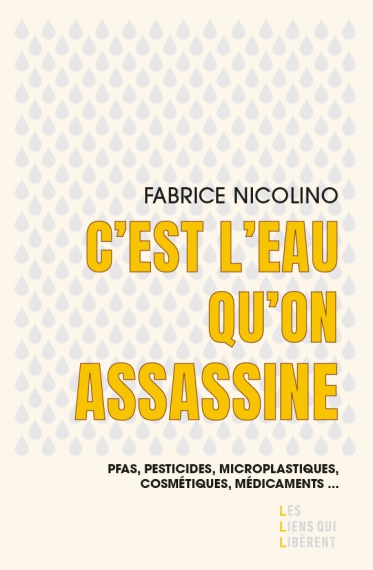
Les stations balnéaires se sont ruées sur ce label miraculeux et se montrent volontiers emphatiques. Prenons un exemple, qui les représente tous. La Baule : Les plages de La Baule, du Pouliguen et de La Turballe ainsi que le Port La Baule-Le Pouliguen sont labellisés ! Une reconnaissance internationale qui récompense les plages exemplaires en matière de respect de l’environnement, qualité des eaux de baignade, sécurité et accessibilité pour tous. Ils rejoignent la longue liste des sites déjà détenteurs du Pavillon bleu en Loire-Atlantique et dans le Morbihan. C’est bel et bien une farce à laquelle tout le monde participe. C’est si bon de croire au père Noël.
Vorace agriculture industrielle
L’agriculture industrielle est entre les mains de la FNSEA, via les chambres d’agriculture, qui gèrent les subventions publiques accordées aux survivants des anciennes fermes. Cette agriculture (nous) pompe beaucoup d’eau. Autour de 11 % du total, si l’on s’en tient aux chiffres bruts. Mais presque 60 % si l’on considère le volume d’eau non rendu aux milieux naturels et aquatiques.Le nucléaire, dont je parlerai bientôt, « restitue » dans d’exécrables conditions une grande partie de l’eau servant au refroidissement des réacteurs. Pas l’agriculture. Mais que pompe-t-elle ? Eh bien, à peu près 90 %de l’ensemble est destiné à l’irrigation. Énorme, non ? Et près de 90 % de l’irrigation se fait par aspersion par tuyaux et ces asperseurs qu’on appelle des sprinklers.
Le goutte à goutte, la micro-irrigation, l’usage économe font partie d’une mythologie qui ne résiste pas à l’examen. Mais, plus intéressant encore, l’essentiel de la surface agricole n’est pas irriguée. C’est le cas de seulement 7,3 % des terres cultivées. La tendance est à la hausse – +14,6 % entre 2010 et2020 – mais cela signifie que presque 93 % des surfaces ne sont pas irriguées. Pourquoi irrigue-t-on ? Pour réduire les risques de sécheresse et augmenter les récoltes, cela va de soi. Mais regarde avec moi : le maïs couvre 40 % de ssurfaces irriguées. La plante n’est pas la plus gourmande en eau, de loin, mais en a besoin surtout l’été,quand le débit des cours d’eau est souvent très bas. D’évidence, cette plante d’origine tropicale joue contre les écosystèmes, et appauvrit les systèmes aquatiques.
Le maïs et le blé comptent pour moitié dans l’irrigation, et il n’est pas indifférent que ces deux cultures soient entre les mains des plus gros exploitants. Ce sont les mieux lotis, et je vais te montrer à l’aide d’exemples ce que cela veut dire. D’abord, le lac de Caussade, dans le Lot-et-Garonne. La chambre d’agriculture y est tenue par la Coordination rurale, mouvement très « physique » qu’il n’est pas abusif de classer du côté du Rassemblement national. Soit un ruisseau, de Caussade, filet d’eau de 4,52 km de long, affluent de la rivière de Tolzac, elle-même affluent de la Garonne. En toute simplicité, la chambre d’agriculture et ses compères de la Coordination rurale décident de construire eux-mêmes une retenue d’eau de 920 000 m 3. Dont un barrage de 378 mètres de longueur. Illégalement, cela va presque sans dire.
On mobilise des engins, des « ingénieurs » et autres « aménageurs ». Comme l’État se couche dès qu’il est question du monde agricole, il ne tarde pas à se prosterner, malgré des décisions de justice en apparence implacables. Le « lac » est toujours là, et j’extrais volontiers d’un dossier de France Nature Environnement ces quelques mots clairs, qui sont accompagnés d’un vaste argumentaire : « Les retenues d’eau assèchent durablement le territoire. En effet, l’eau s’inscrit dans un cycle. La stocker, c’est priver les sols et les milieux aquatiques et humides de l’eau dont ils ont besoin pour se régénérer. » Le « lac » a donc sacrifié un nombre de vies incalculables, mais au profit de quoi ? Au profit de qui ? Une vingtaine d’irrigants au total. C’est ainsi qu’on détruit la nature, la diversité des formes vivantes en France : pour faire plaisir à quelques-uns. Et pour « fabriquer »en priorité du maïs.
Data centers : forage officieux dans les nappes
Je suis décidément le porteur de mauvaises nouvelles. Je ne sais pas pour toi, mais j’écris ces mots sur un ordinateur très sûrement fabriqué en Chine et, après avoir résisté trente ans – juré – au téléphone portable, j’ai depuis peu un smartphone dont je me sers fort peu. Ce qui ne change rien à l’affaire. Nous sommes tous embarqués dans un processus de numérisation du monde, dont l’intelligence artificielle est le dernier des avatars. En mars 2024, la France comptait 315 data centers. Des centres de données numériques qui poussent comme champignons, car il faut bien stocker les photos de vacances, les livres comptables, les exercices de maths pour les classes de quatrième, les e-mails, les factures, les mémos et comptes rendus, les projets, les jeux vidéo, les logiciels, les adresses. La liste ne saurait être limitative, car tout, rigoureusement tout, doit être conservé. Et c’est exponentiel.
Je ne vais pas tout passer en revue. Non. Mais, et l’eau ? Selon le journal Les Échos : Avec le développement de l’intelligence artificielle et la multiplication des échanges de données, les data centers sont en surchauffe. Pour les refroidir, les quantités d’eau nécessaires explosent. De quoi alerter sur de futurs conflits d’usage de l’eau, et inciter les entreprisesà innover. Voyons de plus près. Les data centers chauffent d’une manière qui laisse songeur. Sans l’utilisation d’eau pour constamment les refroidir, ils ne tiendraient pas deux jours. Encore faut-il trouver un gisement. D’eau. Et pas n’importe laquelle.
Il faut la purifier et en ôter les minéraux, à commencer parle calcaire, qui boucherait les circuits. Les conflits se multiplient. Aux États-Unis, il y au moins un exemple de plainte contre un data center de la ville de West Des Moines (Iowa), accusé de pomper 6 % d’une eau destinée à la population. En Espagne, le mouvement « Tu nube seca mi rio » (Ton nuage – cloud – assèche ma rivière) documente un grand nombre de faits dont on ne trouve pas trace dans l’information officielle.
Aux Pays-Bas, en pleine période de sécheresse, un rapport planqué dans les piles révèle qu’un seul data center de Microsoft a utilisé de quatre à sept fois plus d’eau que prétendu par l’industriel.En France, chut. Parlons de murmures. Le site Reporterre a obtenu des confidences que je qualifierai de spectaculaires. Le fin connaisseur de l’eau Jean-Luc Touly, à propos du data center construit par Amazonà Wissous (Essonne), interroge : « Sur les 400 pages de l’étude d’impact, on ne trouve rien sur la consommation d’eau. Quelle quantité d’eau sera utilisée ? Pour faire quoi ? »
L’urbaniste Cécile Diguet, qui connaît fort bien – hélas – le sujet, ajoute : On est conscients que la consommation d’eau est un sujet énorme. On sait que les opérateurs de data centers font des forages dans les nappes, plus ou moins déclarés. On voit que, en Île-de-France, il y a des nappes de plus en plus fragilisées, notamment dans l’Essonne. Mais personne n’a encore creusé la question à ma connaissance. C’est assez limpide, si je puis oser ce mot. L’industrie crée l’irréparable, soutenue par des politiciens incultes, indifférents, surtout désireux de ne pas apparaître comme des obstacles à la marche triomphale de l’intelligence artificielle.


