L’ancien Premier ministre Gabriel Attal, devenu chef du groupe macroniste à l’Assemblée nationale, a déposé fin 2024 une proposition de loi « visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents ». Elle se veut une réponse aux violences urbaines générées par la mort de Nahel Merzouk, 17 ans, tué par un policier le 27 juin 2023.
La loi a été promulguée le 23 juin. Mais avant ça, cinq de ses articles ont été censurés par le Conseil constitutionnel, dont celui instaurant une procédure de comparution immédiate pour les mineurs à partir de 16 ans, et celui allongeant la durée de la détention provisoire pour les mineurs de plus de 16 ans. Les gardiens de la Constitution ont considéré que ces dispositions ne respectaient pas le principe d’adaptation de la réponse pénale à la situation particulière des mineurs.
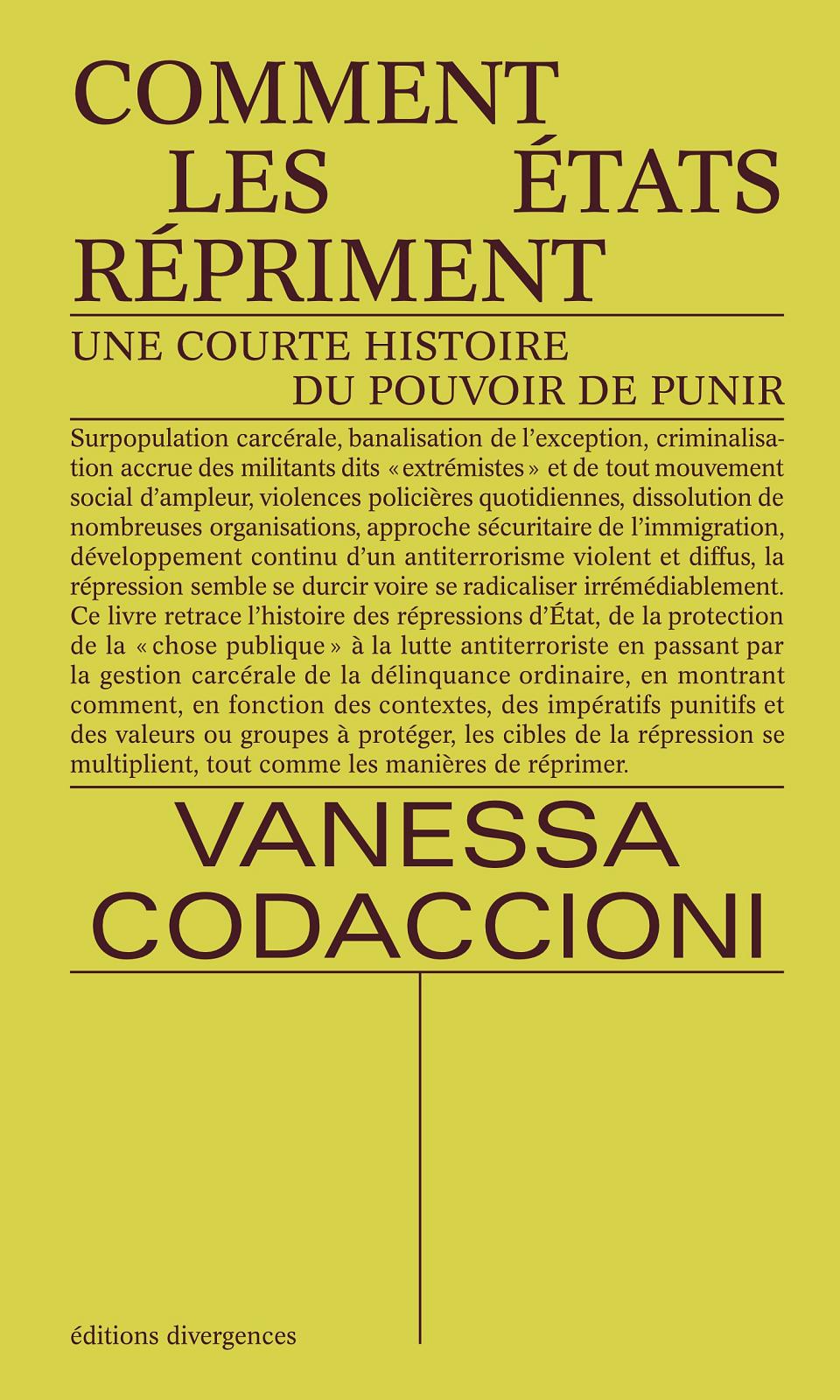
Vanessa Codaccioni, professeure de science politique à l’université Paris VIII, est spécialiste de la justice d’exception. Dans son dernier ouvrage Comment les États répriment. Une courte histoire du pouvoir de punir (Divergences, 2025), elle analyse l’évolution contemporaine des dispositifs répressifs et punitifs en Europe occidentale. Elle revient notamment sur la question de la répression des jeunes « délinquants », et sur la place toujours plus importante des dispositifs antiterroristes dans l’ensemble de l’appareil répressif et judiciaire.
Basta! : D’où vient, selon vous, la loi de Gabriel Attal sur la justice des mineurs ?
Vanessa Codaccioni : Cette loi découle d’une gestion stigmatisante, dépolitisante et criminalisante des mobilisations des jeunes qui se battent pour que leurs morts comptent. Mais aussi d’une tradition qui refuse d’évoquer les causes sociales de la criminalité et de la délinquance, pour au contraire insister sur deux choses : la punition et la responsabilisation. Il y a toujours eu un discours très dur sur les parents, particulièrement présent dans les cas de révoltes urbaines.
En 2005, les parents étaient considérés comme responsables de ces révoltes. Il y avait des discours tout à fait racistes sur la polygamie des familles qui engendrait de la violence chez les enfants. Les familles sont jugées responsables de ce que font leurs enfants sur le plan sécuritaire.
C’est ça qu’exprime la loi Attal. Elle illustre aussi une vision très à droite de ce qu’est l’enfance et de la minorité. Par exemple, depuis quelques années, la droite et l’extrême droite veulent revenir sur l’excuse de minorité. C’est-à-dire à juger des enfants comme des adultes.
Dans votre ouvrage Comment les États répriment. Une courte histoire du pouvoir de punir, vous parlez d’un « paradigme sécuritaire » qui a émergé en France dans les années 1970. De quoi s’agit-il ?
Ses cibles sont les personnes des classes populaires et en particulier les jeunes. On retrouve une association entre délinquance, immigration et criminalité. Ce qui compte c’est la protection des biens : empêcher les vols et les cambriolages. Dans ce contexte-là, les institutions prioritairement mobilisées sont la police et la justice.
La police procède à des contrôles d’identité et place massivement en garde à vue. Puis la justice enferme et condamne, souvent par le biais de petits procès très rapides, comme les comparutions immédiates. Le tout, au nom de la sécurité de toutes et de tous, et du droit à la propriété.
C’est un paradigme dans lequel on vit toujours et auquel s’est superposé, depuis le 11 septembre 2001, le paradigme antiterroriste. Ici, on ne réprime plus des actes de délinquance, de criminalité ou de terrorisme, on essaie de les empêcher, de manière préventive.
Les acteurs centraux sont ceux de l’administration, comme les préfets ou les services de renseignement.
Des dispositifs d’exception sont mis en place et durent dans le temps. On peut penser à l’état d’urgence qui a été mis en place au moment des attentats du Bataclan. Il devait durer quinze jours, il a duré deux ans, avant d’être intégré dans notre droit commun [en 2017 dans la loi « renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme », ndlr]. La vie des citoyennes et des citoyens est mise en avant pour justifier des mesures répressives et punitives.
N’est-ce pas justement le rôle de l’État de protéger ses citoyens face au terrorisme et à la délinquance ?
Il ne faut pas nier qu’il y a de la criminalité, de la délinquance et des attentats, en France et ailleurs. Mais il faut aussi s’intéresser à comment les autorités les appréhendent. Il y a des questions qui ne sont jamais posées comme : qu’est-ce qui les favorise ? Qu’est-ce qu’il faudrait mettre en place de non répressif pour que ça ne se reproduise pas ? Qu’est-ce qui ne marche pas dans notre société pour que tel ou tel crime soit commis ?
Par exemple, on sait que les vols sont plus commis par des individus très précaires. Plutôt que de prendre en compte ces conditions sociales, on va dénoncer la « culture de l’excuse » et mettre en place plus de répression. Il y aussi une exploitation politique et médiatique de ces délits et de ces crimes pour susciter la peur et un sentiment d’insécurité. Et tout cela paye financièrement et politiquement.
Vous développez une approche historique de la répression par l’État. L’État français est-il plus répressif aujourd’hui, malgré des dépénalisations de la deuxième partie du XXe siècle aussi importantes que celle de l’IVG ou de l’homosexualité ?
Il y a eu au contraire très peu de dépénalisations. On fait plutôt face à un mouvement de pénalisation d’un ensemble croissant de comportements et de discours. C’est par exemple le cas des délits routiers qui ont massivement envoyé des gens en prison. C’est aussi le cas de la législation sur la drogue qui s’est particulièrement durcie dans les années 1970.
Par ailleurs, se demander si l’État réprime plus qu’avant nous oblige à comparer des périodes historiques qui n’ont rien à voir les unes avec les autres. C’est un piège.
On n’envoie plus l’armée tirer sur une foule, on ne torture plus les colonisés dans les prisons pour qu’ils passent aux aveux. Mais la répression est toujours là. Elle prend des formes beaucoup plus invisibles, qui vont susciter moins d’indignation.
Je pense à la garde à vue, qui s’est massifiée, ou aux comparutions immédiates, un phénomène de masse qui touche des individus précaires, souvent seuls et peu soutenus au tribunal. Il y a aussi les amendes forfaitaires qui ont été mises en place en 2016 dans les quartiers populaires ou dans des quartiers de gentrification, qui visent à punir par la police, et non par la justice, des jeunes qui se retrouvent endettés.
L’État ne réprime plus que par les procès, mais aussi par des amendes. Plus uniquement par la justice, mais aussi par l’administration et les services de renseignement. Par le biais de ces services et de la lutte antiterroriste, tout un chacun peut être surveillé et inquiété.
Les militants politiques subissent-ils aussi cette transformation ?
Jusqu’aux années 1980, on a traité les militantes et les militants comme des ennemis politiques. Ils étaient réprimés par une police politique et accusés de crimes et délits politiques par une justice politique. On reconnaissait la motivation politique de leur passage à l’acte.
Lorsque la gauche arrive au pouvoir en 1981, elle a la volonté que tout le monde soit traité de la même manière face à la justice. Les militants sont alors traités de deux façons : soit comme des criminels ou des délinquants de droit commun, soit comme des terroristes.
On peut penser à la surveillance, aux inculpations pour « association de malfaiteurs » contre des militants, parfois assorties d’« en lien avec une entreprise terroriste ». Ou encore aux mesures comme les interdictions de paraître [interdiction de se rendre dans un ou plusieurs lieux déterminés, ndlr], les périmètres de sécurité, alors qu’elles ont été mises en place pour lutter contre le terrorisme.
Il n’y a pas que les militants qui sont réprimés par des dispositifs antiterroristes. L’Assemblée nationale a adopté en avril une proposition de loi « visant à sortir la France du piège du narcotrafic ». Cette loi, elle aussi en partie censurée par le Conseil constitutionnel, contient plusieurs dispositions qui s’inspirent de dispositifs antiterroristes…
Les gouvernements n’inventent rien en matière de répression et de sécurité. Soit ils imitent ce qui se fait ailleurs, soit ils mobilisent ce qui existe déjà et ce qui est considéré comme ayant marché. Aujourd’hui, la lutte antiterroriste inspire toutes les formes de répression et de punitivité.
C’est le cas dans la répression des militants en lutte, mais aussi d’autres formes de criminalité comme le narcotrafic. Si on regarde les dispositions de cette loi contre le narcotrafic, on retrouve des éléments de ce qui existe déjà en matière de criminalité ou de délinquance ordinaires, mais surtout des dispositifs de l’antiterrorisme, comme la création d’un parquet national ou des dispositions donnant plus de pouvoirs à l’administration. Cette loi illustre très bien comment l’antiterrorisme cannibalise l’ensemble de l’appareil répressif.


